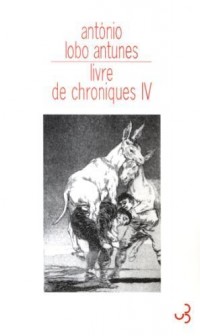Livre de chroniques : Tome 4
Ce quatrième livre de chroniques, écrites régulièrement pour un journal portugais entre 2003 et en 2005, s'inscrit très logiquement dans la continuation des précédents, par les thèmes et l'écriture.
Le temps ayant fait son oeuvre, il montre aussi une certaine évolution : la tonalité en est dans l'ensemble plus mélancolique, et l'attention portée au métier d'écrivain et à la confection des livres de l'auteur beaucoup plus présente.
Ces soixante-neuf textes de quatre pages chacun sont écrits au fil de la plume selon l'inspiration du moment. Hormis une vingtaine de ce qu'on peut qualifier de petites nouvelles, où le récit est purement fictif et la narration assumée par un personnage, et quelques hommages rendus, à sa façon chaleureuse et personnelle, à quelques grandes figures des lettres et des arts portugais, les autres chroniques sont des récits où l'écrivain parle de lui, au passé ou au présent, de sa famille, de certains de ses amis, d'anonymes qu'il observe et qui l'émeuvent. Si certaines chroniques ont une parfaite unité, d'autres mélangent parfois les thèmes et les époques : " au lieu d'écrire je mets à parler à la dérive : j'attrape n'importe quelle ombre à ma portée, comme elle vient, et je la mets là, sur le papier ", dit l'auteur dans l'une d'entre elles où, après avoir évoqué la maladie de son ami l'éditeur Christian Bourgois, puis les cercueils réservés à son unité en Afrique, il se souvient brusquement du puits de la maison de ses parents, revient à Paris et termine sur l'image du cercueil, dans le présent de Lisbonne, après avoir fait un détour par un moment joyeux en Italie. Dans ce cas, on voit donc défiler les pensées de l'auteur, comme elles lui viennent. Mais la variété s'étend à l'ensemble des textes qui compose ce volume. On peut distinguer principalement trois types de chroniques : - celles où l'écrivain met en scène des personnages rencontrés ou inventés, anonymes ou non. Les thèmes les plus souvent traités sont ceux que l'on retrouve dans certaines de ses précédentes chroniques et dans ses derniers romans : la maladie, la mort, la solitude, les rapports difficiles entre hommes et femmes, souvent présentés dans une atmosphère vespérale ou nocturne. Ils sont à l'occasion traités avec beaucoup d'humour, voire de cocasserie dans des textes fictifs, où l'on assiste à des séparations, des ruptures, des malentendus conjugaux et même des meurtres, et où la fantaisie de l'écrivain fait merveille (" Chronique amoureuse " ou " Comment je suis mort de tes mains "). Mais c'est la gravité qui l'emporte, avec une affectueuse sympathie mêlée à l'occasion d'un peu d'ironie, lorsqu'il évoque la vie monotone et étriquée de petites gens, souvent âgées, souvent des femmes, qui vivent tristement leur solitude, seules ou à deux, et trouvent une maigre compensation dans de petites choses très dérisoires. L'auteur affirme d'ailleurs à plusieurs reprises son attirance pour les banlieues lointaines, pour les quartiers populaires, pour les choses " laides et bon marché ", et dit préférer " les gens qui font la queue à l'arrêt de bus à ceux qui voyagent seuls dans leurs voitures ", les premiers lui semblant plus authentiques ; il se montre par ailleurs impitoyable envers les bourgeois mondains, les mauvais romanciers et les intellectuels de café, dont il fait de réjouissantes caricatures. En revanche, l'accent devient plus grave lorsqu'il décrit la détresse de quelqu'un, et pathétique lorsqu'il aborde la maladie et la mort, rencontrées à l'hôpital chez un enfant cancéreux de cinq ans (" Un pied se balançant, nu, en-dehors du drap "), chez un jeune homme de trente-quatre (" Il n'y a pas plus pauvre que les morts "), chez un soldat qui saute sur une mine (" 078902630RH+ "). - celles où il parle de sa famille et de lui-même : António Lobo Antunes a toujours évoqué avec tendresse et nostalgie certains lieux de son enfance et certaines figures familiales. Il en va de même ici pour la maison de ses grands-parents maternels, dans le cadre grandiose de la Serra da Estrela, pour la maison de ses parents dans le quartier lisboète de Benfica, pour celle de Praia das Maçãs, au bord de la mer, encore que ses sentiments soient plus mêlés dans ce dernier cas. Avec ses frères, ses filles et sa première épouse, dont il parle avec beaucoup d'affection, et une ou deux tantes évoquées avec tendresse, ses grands-parents sont à nouveau convoqués, eux aussi, ainsi que des aïeux connus uniquement par des photos qui lentement s'effacent ou par des objets qui leur ont survécu, en l'occurrence une pendule et une montre à gousset. Le thème du temps qui passe est alors abordé avec une certaine angoisse, car il pèse de plus en plus sur l'écrivain vieillissant, qui consacre d'ailleurs deux chroniques entières à la présence palpable de la mort. Elle l'est plus encore lorsque l'écrivain évoque la figure de son père, dont nous voyons la santé se détériorer au fil des chroniques, la dernière, " Règlements de compte ", écrite après le décès de ce dernier, présentant plutôt une sorte de réconciliation émue post-mortem avec un homme dont il fait par ailleurs un portrait assez sévère. Moins sévère peut-être que celui consacré à sa mère, entièrement fait de distance et d'incompréhension. L'écrivain affirme à plusieurs reprises qu'il s'est construit tout seul, et, sur un ton mi-figue mi-raisin, reconnaît à ses parents le mérite de ne pas l'avoir " comblé d'amour ni d'attentions, ce qui aurait tué en [lui] l'artiste ". On peut, à ce propos, rapprocher l'affectueuse dédicace de l'ouvrage à l'un de ses oncles de la non dédicace du roman Il me faut aimer une pierre, qui traitait essentiellement de l'absence de communication au sein des familles (" Il y avait sur cette page une dédicace à mes parents. Elle y est encore "). - celles où il parle de son métier d'écrivain : Lobo Antunes se présente volontiers comme un être solitaire, rêveur, peu causant, préférant observer que parler, qui a su conserver l'esprit de l'enfance et a toujours vécu " dans un étonnement perpétuel ". Il reconnaît aussi, non sans ironie, être plusieurs à la fois, avec des personnalités contradictoires. Il montre au passage son attirance pour les jolies femmes, et dit son horreur de certaines institutions : l'école, l'armée, l'hôpital psychiatrique, la dictature, dont il moque la Jeunesse Portugaise, ridicule copie des Jeunesses Hitlériennes, et dont il dénonce la violence de son odieuse police politique. Cela dans le cadre d'une guerre vécue dans la douleur, qui ne cesse de revenir à sa mémoire comme un vomissement et pèse sur sa conscience. Il évoque avec émotion et pudeur des moments heureux vécus avec Zé, la mère de ses filles Maria José et Joana, à Lisbonne, en Afrique, à Lisbonne, et le lieu où elle repose. Il se montre écrivant à Lisbonne, dans divers lieux, et aussi en voyage, dans un train français, dans un hôtel allemand, en Roumanie, de retour d'Italie. Ecrivant et observant ; observant pour écrire, semble-t-il, car il semble ne vivre que pour écrire. Et l'écriture à elle seule nourrit un grand nombre de ses chroniques. Il use de différentes métaphores pour décrire cette activité dévorante : tantôt il est un chiffonnier qui découvre dans ce que jettent les gens des " restes, des fragments, des émotions tronquées ", que sa tête et sa main travaillent ensuite " avec une patience d'orfèvre " ; tantôt il est un chien de berger, un chasseur à l'affût, un mineur, un sourcier qui trouve, sous le magma, ce qui lui permet de " pénétrer, ne serait-ce qu'un petit peu, au coeur de la vie ", car son objectif est de " donner à voir l'essence des choses " ; il est enfin un mécanicien, qui travaille avec des phrases-fils de fer, des adjectifs-vis, des stylos-clefs anglaises. L'inspiration, en effet, n'existe pas, selon lui : seuls comptent le métier et la méthode. Humble et orgueilleux à la fois, car il se compte au rang des vrai créateurs, il se sent porteur encore de nombreux livres, et craint seulement de ne pas avoir le temps de les écrire.