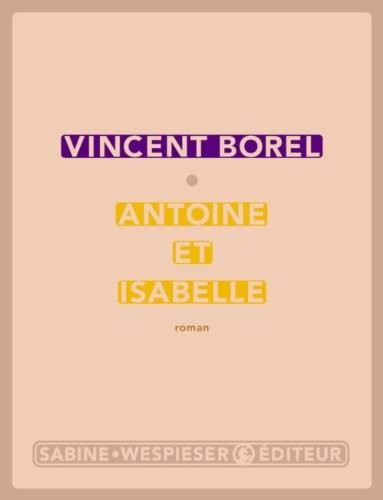Antoine et Isabelle
Quand ils se rencontrent à Barcelone en 1925, Antonio et Isabel ont en commun une belle jeunesse et le désir de se construire une vie libre et neuve, à l’image des utopies du temps. Isabel, dont la famille a fui la misère de l’Andalousie, travaille dans un atelier de couture. Antonio, lui, a gravi les échelons au grand hôtel Oriente : affecté au service d’étage, il met à profit ce poste privilégié pour observer les grands de ce monde. Et c’est là, avec ses camarades de rang, qu’il se forge les convictions politiques qui vont infléchir son destin. Il ne jouit que peu de temps en effet de sa nouvelle situation d’homme marié, bientôt père de deux petites filles. L’engagement du côté de la jeune République espagnole a tôt fait de l’entraîner à marche forcée dans le tourbillon de l’histoire : le départ précipité en France avec la troupe en déroute, les retrouvailles avec sa famille dans un camp de réfugiés près de Gap, la Résistance et le maquis, l’arrestation par les Allemands et puis l’extradition dans un camp nazi, tels sont les épisodes de la vie d’un homme somme toute ordinaire auxquels s’attache l’auteur en consacrant une part importante de son livre au portrait de l’individu vaillant et opiniâtre que fut son grand-père. Vincent Borel, en effet, dans un prologue écrit à la première personne, ne cache pas son intention : rendre justice à ceux qui, en s’installant en France, devinrent Antoine et Isabelle. Mais en s’appropriant la mémoire des siens, le romancier prend la pleine mesure de la nécessité pour la littérature de témoigner. C’est ainsi que, se démarquant de la saga familiale, il entreprend d’inscrire le destin de ses proches dans l’épopée du vingtième siècle. L’histoire exemplaire de ses grands-parents, et ce dès le début du livre, il la met en regard avec celle non moins exemplaire d’une famille d’industriels lyonnais qui firent dans la tourmente de l’histoire de tout autres choix. L’écrivain mêle ici avec brio plusieurs registres narratifs : le « je » du prologue, s’indignant devant quelques héritiers des beaux quartiers de leur discours flirtant avec le révisionnisme (conversation ici relatée et qui mit en branle la machine romanesque), reprend la plume au moment de conclure pour consigner, en guise de réfutation, le témoignage brut qu’Antoine rapporta de Mauthausen. Dans l’intervalle, il aura imposé une verve épique pour tisser en parallèle le destin des siens, gens de peu, en opposition avec celui des nantis lyonnais. Car de cet Edmond Gillet aperçu par Antonio quand il était dans la claque à l’opéra de Barcelone, et de sa famille, le romancier retrace brillamment les tribulations : donnant chair et corps au monde des possédants, il s’immisce dans les mariages arrangés et les alliances stratégiques, dépeint avec une ironie certaine la fibre sociale des dames du beau monde, accompagne les capitaines d’industrie dans la course aux brevets, suit les sautes souvent fatales des cours de la bourse, bref retrace l’histoire du monde capitaliste en marche vers la deuxième guerre mondiale. Et rend ainsi lisibles les décisions qui furent prises au moment où la guerre éclata. Il s’agit bel et bien de sauver un empire, et on est loin des idéaux de la Résistance. Le tour de force de Vincent Borel dans ce grand et virtuose roman mêlant destins individuels et histoire collective est l’intelligence de ses personnages : ballotés par le vent de l’histoire, chacun ici a fait des choix que le romancier ne s’arroge pas le droit de juger. Il s’agirait plutôt de dire haut et fort le pouvoir des mots pour comprendre le monde.