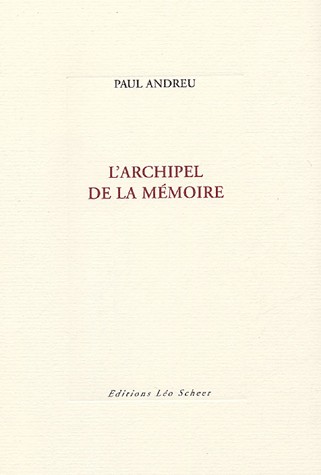L'Archipel de la mémoire
Le « je » de Paul Andreu n’est pas un je-Narcisse. Sa pupille s’attarde bien au contraire tout autour de lui-même, cherchant à cerner le mystère du réel mouvant qui l’entoure, les hoquets de la fuite du temps.
Les cadres familiers, la prégnance de la nature, la rumeur de la ville, la récurrence de motifs lancinants (le rythme ponctué de la pluie ou le chant des oiseaux), la déambulation du corps... un travail de description minutieux au sein d’une langue subtile, progressant par touches chromatiques, nuançant les effets pour dévoiler les traits d’une subjectivité à l’affût des sensations, du bruissement du réel.
Une subjectivité sans complaisance aux prises avec le temps, plus exactement le battement entre temps subjectif et objectif : « L’après-midi sera long, la nuit sera désespérante, mais le temps à la fin passera. Il passera sans poids, sans goût, sans souvenir, il n’existera plus, il n’aura jamais existé. Il suffira d’attendre, il suffira de bloquer l’espoir tenace et les regrets, de les empêcher de couler dans les veines, de n’avoir plus de veines, plus de vie, rien ».
Mais la prose n’est pas monochrome et ne s’adonne pas à la noirceur, choisissant bien au contraire un contre-chant lumineux : « Mais il y a peut-être aussi une autre langue, faite de bruits doux, à peine audibles, qui fait s’évanouir la peur, chasse l’angoisse et nous fait un semblant de bonheur, une autre langue que nous comprenons et qu’il nous arrive parfois de parler ».
Car la vie passe par la nomination tâtonnante, sans cesse recommencée. La mémoire est cet archipel indécidable et capricieux, aux reliefs changeants selon le point de vue adopté...