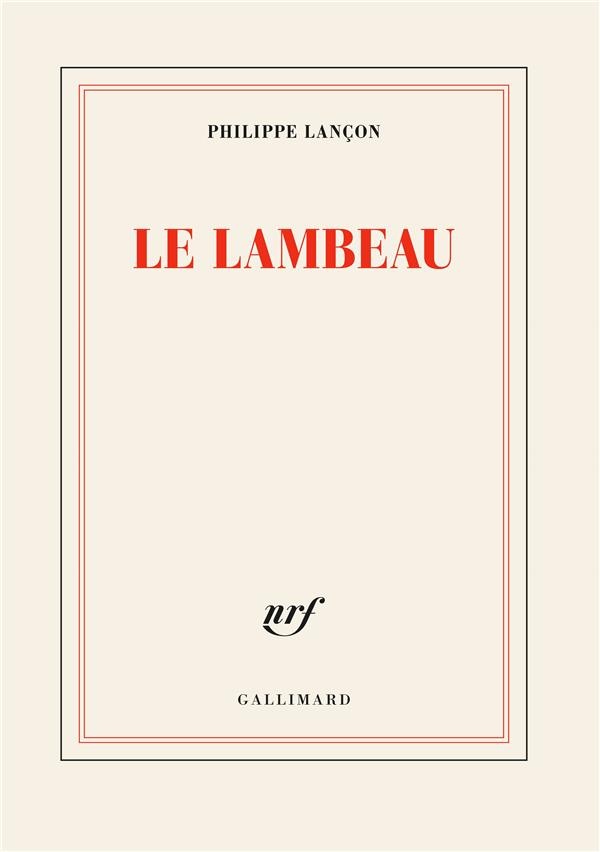Le lambeau
Le 6 janvier 2015, Philippe Lançon assiste à la représentation de La Nuit des Rois de Shakespeare dans un petit théâtre d'Ivry. Il a pris ses billets pour les Etats-Unis où il donnera des cours de littérature à Princeton et rejoindra sa nouvelle compagne. Le lendemain matin, Houellebecq est interviewé sur France Inter pour la parution de Soumission ; Lançon, qui a écrit un papier élogieux dans Libé, écoute en faisant sa gymnastique sur un tapis qu'il a rapporté d'Irak en 1991, deux jours avant les bombardements américains. S'il n'était pas rentré, il serait devenu reporter de guerre et non journaliste littéraire.
A la conférence de Charlie Hebdo, tout le monde parle de Houellebecq, puis des banlieues.
Tignous dit que l'Etat les a abandonnées et a fabriqué des islamistes et des délinquants. Bernard Maris s'insurge. Lançon montre un livre de jazz à Cabu, quand les tueurs arrivent.
Philippe Lançon ne cherche pas à expliquer l'attentat. Il écrit sans pathos, sans complaisance pour lui-même, ce qui n'empêche pas l'émotion et la profondeur (sur la mémoire, la perception d'une vie). L'avant et le pendant sont d'une très grande intensité, la scène de l'attaque est extrêmement saisissante. Dans ce livre de survie, Philippe Lançon s'attache à décrire sa vie qui bascule, lui qui, défiguré, reçoit « une blessure de guerre » dans un pays « en paix ».
La presse en parle
Défiguré lors de l’attentat contre Charlie Hebdo, l’auteur tente de maintenir un lien avec le monde des vivants. Mais les ponts sont coupés. Décrivant cette béance, Lançon hisse chaque évocation intime au niveau d’une méditation universelle sur notre temps, nos aveuglements : sa plume nous en met plein la gueule ; son visage défait exhibe tout ce que nous ne voulons pas regarder en face ; sa lucidité est une fidélité à l’enfant qu’il fut ; ses souvenirs d’enfance ressemblent déjà à nos souvenirs de guerre. Un brûlant journal de deuil.
Jean Birnbaum, Le Monde
Extrait
CHAPITRE 1
La Nuit des rois
La veille de l’attentat, je suis allé au théâtre avec Nina. Nous allions voir aux Quartiers d’Ivry, en banlieue parisienne, La Nuit des rois, une pièce de Shakespeare que je ne connaissais pas ou dont je ne me souvenais pas. Le metteur en scène était un ami de Nina. Je ne le connaissais pas et j’ignorais tout de son travail. Nina avait insisté pour que je l’accompagne. Elle était heureuse de s’entremettre entre deux personnes qu’elle aimait, un metteur en scène et un journaliste. J’y allais les mains dans les poches et le cœur léger. Aucun article n’était prévu – ce qui est toujours la meilleure façon de finir par en écrire un, quand c’est par enthousiasme et en quelque sorte par surprise. Dans ces cas-là, le jeune homme qui allait jadis au théâtre rencontre le journaliste qu’il est devenu. Après un moment plus ou moins long de flottement, de timidité, d’approche, le premier communique au second sa spontanéité, son incertitude, sa virginité, puis il quitte la salle pour que l’autre, stylo en main, puisse reprendre son activité et, malheureusement, son sérieux.
Je ne suis pas un spécialiste de théâtre, même si j’ai toujours aimé y aller. Je n’y ai jamais passé cinq ou six soirs par semaine, et je ne crois pas être un véritable critique. J’ai d’abord été reporter. Je suis devenu critique par hasard, je le suis resté par habitude et peut-être par insouciance. La critique m’a permis de penser – ou d’essayer de penser – ce que je voyais, et de lui donner une forme éphémère en l’écrivant. Elle est le résultat d’une expérience à la fois superficielle (je n’ai pas les références nécessaires pour établir un jugement solide sur les œuvres) et intérieure (je ne peux lire ou voir quoi que ce soit sans le passer au crible d’images, de rêveries, d’associations d’idées que rien d’extérieur à moi-même ne justifie). Je me suis senti plus libre, je crois, le jour où je l’ai compris.
La critique me permet-elle de lutter contre l’oubli ? Bien sûr que non. J’ai vu bien des spectacles et lu bien des livres dont je ne me souviens pas, même après leur avoir consacré un article, sans doute parce qu’ils n’éveillaient aucune image, aucune émotion véritable. Pire : il m’arrive souvent d’oublier que j’ai écrit dessus. Quand par hasard l’un de ces articles fantômes remonte à la surface, je suis toujours un peu effrayé, comme s’il avait été écrit par un autre qui porterait mon nom, un usurpateur. Je me demande alors si je n’ai pas écrit pour oublier le plus vite possible ce que j’avais vu ou lu, comme ces gens qui tiennent leur journal pour débarrasser quotidiennement leur mémoire de ce qu’ils ont vécu. Je me le demandais, du moins, jusqu’au 7 janvier 2015.
Pendant la représentation, j’ai sorti mon carnet. Le dernier mot que j’ai noté ce soir-là, dans le noir et de travers, est de Shakespeare : « Rien de ce qui est, n’est. » Le suivant est en espagnol, en lettres beaucoup plus grosses et tout aussi incertaines. Il a été écrit trois jours plus tard dans un autre type d’obscurité, à l’hôpital. Il est adressé à Gabriela, mon amie chilienne, la femme dont j’étais amoureux : « Hablé con el médico. Un año para recuperar. ¡ Paciencia ! » Un an pour récupérer ? Rien de ce qu’on vous dit n’est, quand vous entrez dans le monde où ce qui est ne peut plus être vraiment dit.
Je connaissais Nina depuis un peu moins de deux ans. Nous nous étions rencontrés à une fête, en été, dans le parc d’un château du Lubéron. Il m’a fallu du temps pour comprendre d’où venait la sympathie qu’elle m’inspira aussitôt. C’était une intermédiaire-née, délicate et sans chichis. Elle avait cette simplicité, cette tendresse, cette chaleur, qui portent à mélanger les amis, comme si leurs qualités, en se frottant, pouvaient s’augmenter. Elle se chauffait aux étincelles, mais elle était trop modeste pour s’en prévaloir. Elle s’effaçait presque, comme une mère discrète, sarcastique et bienveillante. Quand je la voyais, j’avais toujours l’impression d’être un oiseau de sa couvée et de rejoindre le nid d’où, par imprudence ou négligence, j’étais tombé. La tristesse ou l’inquiétude qui flottait dans son regard sombre et vif disparaissait à la première discussion. Je ne m’étais pas toujours bien comporté avec elle. Elle m’en avait voulu, avait cessé de m’en vouloir. Elle avait moins de rancœur que de générosité.