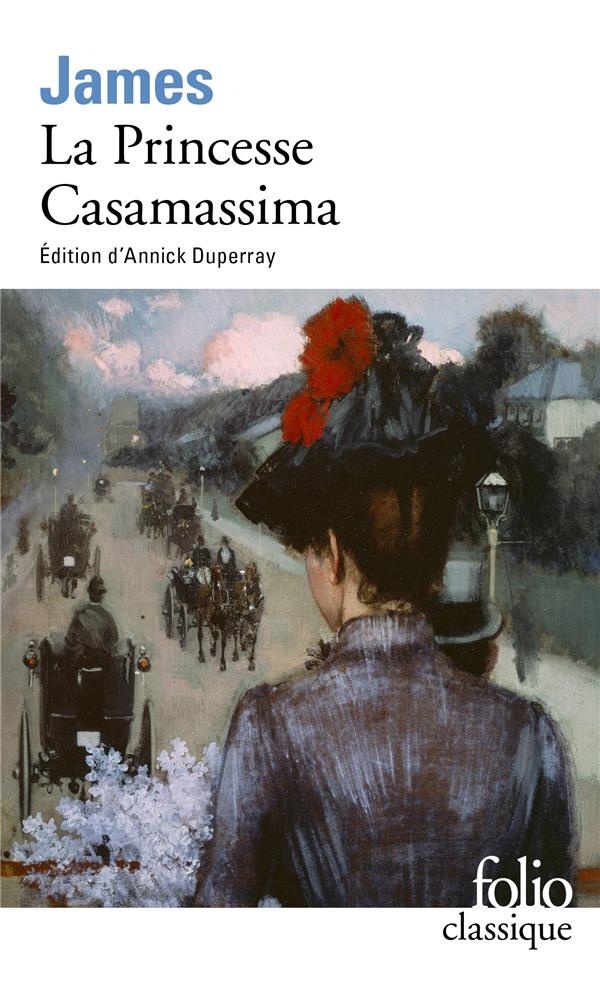La Princesse Casamassima
Londres, années 1870-1880. Hyacinth Robinson, jeune typographe engagé dans les milieux anarchistes, rencontre un soir au théâtre la belle princesse Casamassima, une aristocrate qui s’efforce de tourner le dos à son milieu d’origine, vit séparée de son mari et fréquente désormais les radicaux. Il en tombe amoureux, malgré son engagement envers son amie d’enfance. Au même moment, il se retrouve impliqué dans un complot terroriste. Séduit par la découverte d’un univers où richesse, art et beauté semblent se conjuguer, va-t-il se consacrer à son amour pour la princesse? Ou se résoudre à commettre l’assassinat politique auquel il s’est engagé?
Paru en 1886, voici le grand roman politique de Henry James : à la manière des naturalistes français, le romancier se plonge dans l’étude des milieux déshérités et des différentes idéologies sociales de son temps, afin de voir ce qui se trame «sous la vaste surface de la suffisance bourgeoise».
À la fois idéaliste et indécis, tiraillé entre ses origines, ses convictions et son amour, Hyacinth tente de s’inventer un destin. Il avance obstinément au fond d’une impasse… une arme à la main.
Extrait
— Mais certainement, dit Miss Pynsent1, je pense que je pourrai trouver l’enfant, si vous désirez le voir. Dans son émoi, elle avait envie de dire oui à toutes les suggestions de sa visiteuse, qu’elle considérait comme un haut personnage plutôt terrible. Pour aller à la recherche de l’enfant, elle sortit de son petit salon, qu’elle avait eu honte de montrer aussi en désordre, avec des « patrons » de papier étalés par‐ tout sur les meubles et le tapis jonché de rognures d’étoffe — elle sortit de ce sanctuaire — qui sentait quelque peu le renfermé — consacré à la fois aux échanges sociaux et à l’art ingénieux auquel elle avait consacré son existence et, ouvrant la porte d’entrée, parcourut du regard d’un bout à l’autre la petite rue. L’heure du thé était toute proche, et elle savait qu’en cet instant solennel Hyacinth resserrait le cercle de ses vagabondages. Elle était inquiète et impatiente, pleine d’une excitation fébrile et de contentement, ne voulant pas faire attendre Mrs. Bowerbank, encore que celle‐ci fût assise là, de tout son poids et d’un air réfléchi, comme bien décidée à y rester, et se deman‐ dant plus qu’un peu si l’objet de sa quête aurait la figure sale. Mrs. Bowerbank avait laissé entendre si catégoriquement qu’elle trouvait remarquable de la part de Miss Pynsent d’avoir pris soin de lui gratui‐ tement pendant tant d’années que l’humble coutu‐ rière, dont l’imagination prenait son essor à l’égard de tout le monde sauf d’elle‐même, et qui jamais n’avait eu conscience de sa bienveillance exemplaire, aspira soudain à paraître aussi entièrement dévouée à l’enfant qu’en avait été frappée son auguste et massive visiteuse, et sentit combien elle aimerait le voir arriver frais et candide, joli comme il l’était parfois. Miss Pynsent, dont les yeux papillotaient confusément tandis qu’elle inspectait du regard les alentours, avait le visage très empourpré, en partie à cause de l’agitation où l’avaient mise les paroles de Mrs. Bowerbank, en partie parce que, ayant offert à cette dame une goutte pour se rafraîchir après une expédition aussi longue, celle‐ci avait déclaré qu’il n’était pas question qu’elle touchât à quoi que ce fût si Miss Pynsent ne lui tenait pas compagnie. Du cheffonnier, comme elle prenait toujours bien soin de l’appeler, Amanda avait extrait une petite bouteille qui, jadis remplie d’eau de Cologne*, contenait à présent environ un quart de litre d’un liquide d’une riche couleur ambrée. Miss Pynsent était d’une santé très délicate : elle vivait de thé et de cresson et avait cette bouteille dans le chiffonnier seulement pour les grandes circonstances. Elle n’aimait pas le grog au brandy avec un morceau de sucre ou deux, mais en cette occasion, d’un genre tout à fait exceptionnel, elle s’en servit un demi‐gobelet. À ce moment de la journée, l’enfant était souvent planté devant la petite boutique de confiserie de l’autre côté de la rue, éta‐ blissement distributeur de littérature périodique en même temps que de caramels coriaces et de sucres d’orge à se casser les dents, et où des recueils de chansons et des illustrés attrayants étaient en montre derrière les petits carreaux crasseux de la vitrine. Il restait là une demi‐heure d’affilée à épeler la pre‐ mière page des romans‐feuilletons du Family Herald et du London Journal1, dont il admirait particulière‐ ment l’illustration de rigueur où l’on pouvait voir de ses yeux de nobles personnages (toujours de la plus haute naissance). Lorsqu’il avait deux sous, il n’en consacrait qu’un à l’achat d’un vieux sucre d’orge ; avec l’autre il achetait toujours une romance ornée en haut d’une vignette aux couleurs criardes. Pour le moment, toutefois, il n’était pas à son poste d’obser‐ vation, et les yeux de Miss Pynsent ne l’apercevaient nulle part.
— Dis‐moi vite, Millicent ’Enning, tu n’as pas vu le petit ? dit Miss Pynsent.
Ces paroles s’adressaient à une fillette assise sur le seuil de la maison voisine, qui tenait dans ses bras une poupée sale et dont la chevelure brun foncé, d’une luxuriance extraordinaire, était couronnée d’un chapeau de paille déchiré.
L’enfant, levant les yeux, cessa de faire sauter et de tapoter sa poupée et, après avoir fixé Miss Pynsent avec des yeux de toute évidence exagérément vides, répondit :
— Mon Dieu non, Miss Pynsent, je ne le vois jamais.
— Comme si tu n’étais pas toujours en train de faire des bêtises avec lui, petite polissonne ? répli‐ qua avec brusquerie la couturière. Il est peut‐être en train de jouer aux billes à deux pas d’ici, ou bien à saute... je ne sais quoi ? poursuivit Miss Pynsent en s’efforçant d’être suggestive.
— Il joue jamais à ces jeux, je vous assure, dit Mil‐ licent Henning d’un air mûr qu’elle accentua encore en ajoutant :
— Et je ne vois pas non plus pourquoi je devrais être traitée de polissonne.
— Eh bien, si tu veux qu’on dise du bien de toi, va donc le chercher, s’il te plaît, et dis‐lui qu’une dame est venue exprès le voir ici à l’instant même.
Miss Pynsent attendit un moment pour voir si la petite obéirait à son injonction, mais n’obtint pas satisfaction, rien de plus qu’un nouveau regard appuyé qui lui fit croire que l’obstination de l’enfant était aussi grande que la beauté, quelque peu souillée et ternie, de son insolent petit minois. Se retournant elle rentra dans la maison avec une exclamation de désespoir et sitôt qu’elle eut disparu, Millicent Hen‐ ning sauta sur ses pieds et se mit à descendre la rue en courant vers une autre qui la coupait. Je n’abuse‐ rai pas de l’innocence enfantine en disant que la hâte de cette jeune personne n’était nullement motivée par le désir de faire plaisir à Miss Pynsent, mais par une curiosité extrême quant à la visiteuse qui voulait voir Hyacinth Robinson. Elle désirait participer, ne fût‐ce qu’en imagination, à l’entrevue qui allait peut‐ être avoir lieu, et elle était animée également d’un vif regain d’amitié à l’égard du jeune garçon, dont elle s’était séparée une demi‐heure à peine auparavant avec beaucoup d’aigreur. La petite créature n’était pas d’un naturel très affectueux et il n’y avait per‐ sonne, dans son propre cercle de famille, à qui elle fût fortement attachée ; mais elle aimait à embrasser Hyacinth, lorsqu’il ne la repoussait pas en lui disant qu’elle était odieuse, comme il s’était précisément permis de le faire une demi‐heure auparavant. Elle s’était dit immédiatement (tout en se jouant de Miss Pynsent) que c’était le pire qu’il eût jamais fait. Millicent Henning n’avait que huit ans, mais elle savait qu’il y a sur terre des choses bien plus affreuses.