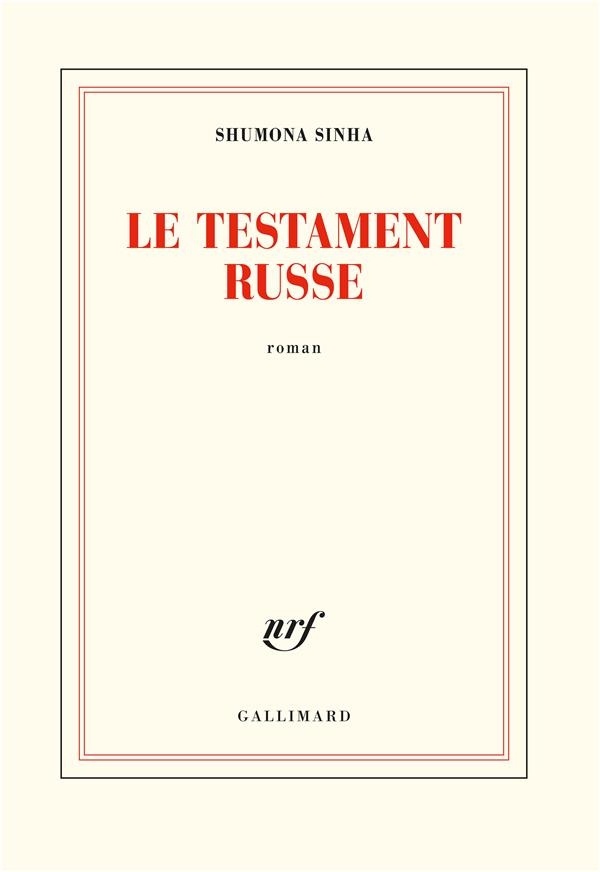Le testament russe
«Cette jeune femme d’un pays si lointain où les vaches sont plus précieuses que les femmes fait trembler ma nuit, fissurer le sol sous mes pieds et je ne sais pas si c’est de la peur ou de la joie que j’éprouve en la voyant soulever la pierre tombale.»
À Calcutta, dans les années 1980, Tania, une jeune Bengalie, détestée par sa mère et mise à l’écart par les adolescents de son âge, trouve refuge dans les livres. Elle se prend de passion pour le destin tumultueux d’un éditeur russe, fondateur des Éditions Raduga, dont la fermeture a été ordonnée en 1930. Elle retrouve la trace de sa fille Adel, octogénaire, dans une maison de retraite à Saint-Pétersbourg et décide de lui écrire.
Avec sensibilité et une poésie évocatrice, Le testament russe propose une traversée du XXe siècle en suivant ces deux femmes passionnées, chacune ayant lutté contre une forme d’oppression : celle d’une dictature sans pitié dans une Russie qui bannissait les livres et s’acharnait contre les poètes ; celle de la famille et de la tradition étouffante en Inde. Shumona Sinha, fascinée par la littérature russe, fait revivre dans ce roman les milieux littéraires des années 1920-1930. En rappelant les liens culturels et politiques entre le Bengale-Occidental et l’Union soviétique, elle offre aussi une réflexion sur la puissance de la langue maternelle et le désir pour une langue étrangère.
Extrait
Prologue
Hier encore je l’ai vu. Il a surgi sur la route dans le noir, au bord de la forêt, sa tête en biais sur son petit corps, indécis sur le chemin à poursuivre, hésitant entre traverser la rue et retourner à l’obscurité duveteuse. Les phares de mon taxi n’avaient éclairé que le côté gauche de la route, le pied des arbres et sa tête. Il a paru aussi blanc que la lumière, éclatant comme une figure de neige, les poils autour de son visage dressés, étincelants. Dans ses yeux tournoyaient les roues bleu et gris, il se demandait s’il devait avoir peur ou non.
Les petits loups apparaissent souvent sur ce trajet, lorsque je reviens de Parnas, faisant un raccourci par le parc Tchouvalovski pour regagner mon refuge à Pargolovo. Même s’il y a aussi des sangliers qui crapahutent dans les parages, je ne saurais dire deux mots sur eux. Leurs corps avachis comme des sacs de jute, leur entêtement à foncer droit devant malgré l’instinct qui crispe forcément leur flanc ne font qu’endurcir mon cœur.
Au milieu de la forêt apparaît le lac. Il s’étale, s’éloigne derrière les arbres qui ressemblent à des soldats insomniaques peinant à se tenir droit debout, puis revient tout près de la route. Le manoir en brique rouge, garni de colonnes et de clochers beiges imitant le style Art nouveau, a été construit par la ville de Saint-Pétersbourg au début des années quatre-vingt-dix pour y installer une maison de retraite.
Je revenais hier de ma séance chez le psy. La direction du foyer m’a imposé cette consultation depuis quelques mois. Ma petite-fille, qui a entrepris l’incommode responsabilité d’organiser mon tout premier voyage chez elle aux États-Unis en bravant l’administration russe, n’a pas eu d’autre choix que d’y consentir. Je ne sais pas si c’est l’exaltation du nouveau millénium qui lui a donné l’élan pour refaire ma vie, m’arracher de mon socle, de ma ville et m’envoyer à l’étranger.
J’avais commencé à asséner que si Ponce Pilate n’avait pas existé, on aurait pu éviter la Shoah, le Premier Temple aurait accepté les zélotes, le judaïsme et le christianisme auraient existé comme deux courants de la même religion. D’abord ils ont feint de m’écouter. Vieille juive russe que j’étais, j’éveillais toujours chez les gens une prudence déférente. Ils m’ont ensuite raillée non sans indulgence, croyant que je jacassais sous l’effet de l’alcool amer, traumatisée comme eux-mêmes depuis la dissolution de l’URSS. Puis, vu mon obsession pour cette idée soi-disant saugrenue, ils ont cessé de rire. Ils cessaient de parler aussi, dès qu’ils m’apercevaient.
Le foyer héberge les fantômes du passé, les somnambules qui refusent de se réveiller. La direction ignore que nous ne sommes pas amnésiques, que nous avons choisi l’oubli partiel et ponctuel pour avoir l’effet de la morphine, pour rester calfeutrés dans le ventre de ce sommeil nuit et jour. Parce que personne n’attend qu’un spectre parle. Parce que nous voulons rester vautrés contre nos rêves pour qu’on nous fiche la paix. Un rêve n’a pas besoin d’être légitime, il suffit qu’il soit suffisamment vieux pour s’infiltrer dans notre sang et nos os.
Sous les roues de la voiture les galets lisses s’étaient écrasés comme des œufs de pigeon. Je suis allée vers l’entrée de côté pour accéder à l’escalier, même si je ne risquais d’importuner personne en traversant le salon du rez-de-chaussée, vide et éteint à cette heure de la nuit. Une fois chez moi, je ne suis plus descendue, ni à l’heure des repas collectifs, ni à celle des tournées de bridge. Toute la journée d’aujourd’hui je suis restée la porte fermée. Les boîtes de biscuits et les cerises trempées dans le thé noir me sont bien utiles lors de ces moments d’internement volontaire.
Je dors peu. Les graines blanches des somnifères n’y peuvent rien, ils se dissolvent sous l’haleine moite de mes nuits. Des fenêtres-alcôves de ma suite mansardée, je regarde le lac qui n’est jamais complètement noir, même au milieu de la nuit. Les pointes de lumières sur l’autre rive ruissellent verticalement sur la surface de l’eau jusqu’à la fendre en minuscules écailles argentines au pied de la forêt.
La lettre m’attendait sur la table de chevet. Je l’ai lue et relue, et à chacune de mes lectures ma confusion est devenue plus intense. J’ignore comment cette jeune femme a pu découvrir mon existence. Je reste sidérée par sa détermination à avoir établi, à travers trois continents, les points invisibles dont la plupart avaient sombré dans l’oubli. Sa lettre, qu’elle a visiblement fait traduire en russe, a été envoyée à Boston, chez ma petite-fille, avant qu’elle ne me soit réexpédiée ici, à Saint-Pétersbourg.
Elle m’a rappelé l’histoire de cette fillette, dans un des livres que mon père avait édités, qui au lieu de ramasser les brindilles dans les bois exhumait du sable les horloges rouillées. La littérature d’enfance et de jeunesse que publiaient la plupart des éditeurs à cette époque-là avait pour vocation la propagande soviétique. Les auteurs prenaient en otage les personnages de leurs livres et les utilisaient comme des mules pour faire passer le message politique. Mais mon père n’avait jamais su rester derrière la ligne rouge, lui qui avait fondé les Éditions Raduga sans même la permission de l’autorité soviétique.
Je n’aime pas lire la lettre dans la journée : le nom de mon père y apparaît d’une telle fadeur, quasiment banal. La clarté ambiante rend les mots frêles et transparents, tandis que la nuit ils sont denses, comme distillés à travers un alambic géant. Son écriture à l’encre bleue montre qu’elle a calligraphié avec soin le nom de mon père, Lev Moisevitch Kliatchko, et je m’amuse à imaginer avec quel doux trébuchement elle aurait tenté de le prononcer devant moi. Elle parle aussi beaucoup d’elle, de son adolescence et de sa jeunesse, pour justifier son obsession à connaître la vérité sur mon père, sur la fin de sa vie. Elle écrit avoir été bouleversée de découvrir qu’il était mort de la tuberculose. L’hiver 1933. Comment lui dire que mon père a eu la chance de partir trois ans avant les procès de Moscou ? Logée dans son corps, la mort l’a grignoté de l’intérieur et la tyrannie n’a pas pu le traîner dans la disgrâce.
Cette jeune femme d’un pays si lointain où les vaches sont plus précieuses que les femmes fait trembler ma nuit, fissurer le sol sous mes pieds et je ne sais pas si c’est de la peur ou de la joie que j’éprouve en la voyant soulever la pierre tombale. Je ne sais pas encore si c’est un vulgaire sanglier qui va fouiner, enivré de la puanteur des détritus, ou si c’est un loup immobile au milieu de ma nuit.