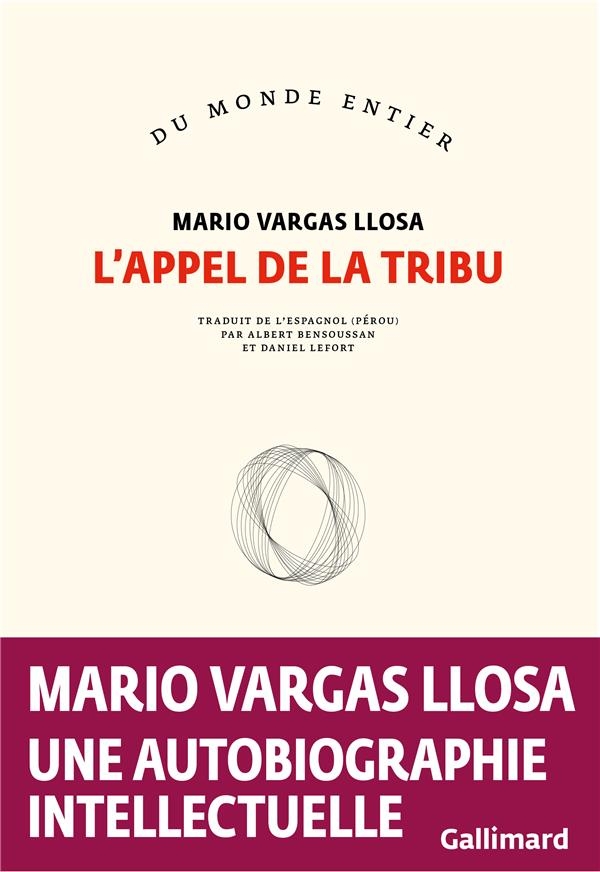L'appel de la tribu
Dans Le poisson dans l'eau (Gallimard, 1995), la première partie de son autobiographie, Mario Vargas Llosa partageait avec ses lecteurs deux périodes décisives de son existence : d'une part, les années de son enfance, de son adolescence et de sa jeunesse, entre la maison d'Arequipa où il est né en 1936 et son premier voyage en Europe, en 1958 ; d'autre part, les trois années qu'il a consacrées à parcourir le Pérou, entre 1987 et 1990, en tant que candidat présidentiel. Avec L'appel de la tribu, il reprend d'une certaine manière ce récit et nous livre une autre partie de son autobiographie. Mais à la différence de la précédente, qui proposait un récit essentiellement factuel, il offre un autoportrait intellectuel dont le but est de nous aider à mieux comprendre ses positions politiques actuelles. Ainsi, Vargas Llosa nous invite à découvrir les sept auteurs qui l'ont marqué, depuis le marxisme le plus orthodoxe vers le libéralisme, et dont il commente et analyse les oeuvres. Il s'agit d'Adam Smith, de José Ortega y Gasset, de Friedrich August von Hayek, de Sir Karl Popper, de Raymond Aron, de Sir Isaiah Berlin et de Jean-François Revel. Comme on pouvait s'y attendre d'une figure de l'envergure de Mario Vargas Llosa, l'approche est passionnée et brillante, et nous révèle de nouveaux aspects de la pensée de ces philosophes, ainsi que la trajectoire vitale et intellectuelle du grand romancier péruvien.
Extrait
Je n’aurais jamais écrit ce livre si je n’avais lu, voici plus de vingt ans, La gare de Finlande, d’Edmund Wilson. Cet essai fascinant raconte l’évolution de l’idée socialiste à partir du moment où l’historien français Jules Michelet, intrigué par une citation, se mit à apprendre l’italien afin de lire Giambattista Vico, jusqu’à l’arrivée, le 3 avril 1917, en gare de Finlande, à Saint-Pétersbourg, de Lénine, qui allait diriger la révolution russe. J’ai pensé alors à un livre sur le libéralisme qui ressemblerait à ce que le critique américain avait fait sur le socialisme : un essai qui, démarrant à la naissance d’Adam Smith dans le village écossais de Kirkcaldy en 1723, rapporterait l’évolution des idées libérales à travers ses principaux représentants, ainsi que les événements historiques et sociaux qui les répandirent dans le monde. Toutes proportions gardées, telle est l’origine lointaine de L’appel de la tribu.
En dépit des apparences, il s’agit d’un livre autobiographique qui retrace ma propre histoire intellectuelle et politique, le parcours qui m’a mené du marxisme et de l’existentialisme sartrien de ma jeunesse au libéralisme de ma maturité, en passant par la revalorisation de la démocratie que je dois à mes lectures d’écrivains tels qu’Albert Camus, George Orwell et Arthur Koestler. J’ai été poussé ensuite vers le libéralisme par certaines expériences politiques et, surtout, par les idées des sept auteurs à qui ces pages sont consacrées : Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Isaiah Berlin, Raymond Aron et Jean-François Revel.
J’ai découvert la politique au Pérou à douze ans, en octobre 1948, lors du coup d’État militaire du général Manuel Apolinario Odría qui renversa le président José Luis Bustamante y Rivero, apparenté à ma famille maternelle. C’est, je crois, pendant les huit années odriistes qu’est née chez moi la haine des dictateurs de tout poil, l’une des rares constantes de mon attitude politique. Mais je n’ai pris conscience du problème social, je veux dire conscience d’un Pérou plein d’injustices où une minorité de privilégiés exploitait abusivement l’immense majorité, qu’en lisant dans ma dernière année de lycée, en 1952, Sans patrie ni frontières de Jan Valtin. Ce livre m’a amené à m’opposer à ma famille, qui voulait que j’entre à l’Université catholique – celle des fils à papa –, en m’inscrivant à San Marcos, l’université publique, populaire et réfractaire à la dictature militaire où, j’en étais sûr, je pourrais adhérer au parti communiste. La répression odriiste l’avait presque laminé quand je suis entré à San Marcos en 1953, inscrit en lettres et droit, après avoir emprisonné, supprimé ou banni ses dirigeants ; et le parti essayait de se reconstruire avec le Groupe Cahuide, où j’ai milité un an.
C’est là que j’ai reçu mes premières leçons de marxisme, dans des groupes d’étude clandestins où l’on lisait José Carlos Mariátegui, Georges Politzer, Marx, Engels ou Lénine, et l’on avait d’intenses discussions sur le réalisme socialiste et le gauchisme, « la maladie infantile du communisme ». La grande admiration que j’avais pour Sartre, que je lisais religieusement, me défendait contre le dogme – nous, les communistes péruviens, étions alors, selon l’expression de Salvador Garmendia, « en petit nombre mais parfaitement sectaires » – et m’amenait à soutenir dans ma cellule, selon la thèse sartrienne, la croyance au matérialisme historique et à la lutte des classes sans adhérer au matérialisme dialectique, ce qui me valut, lors d’une de ces discussions, d’être qualifié de « sous-homme » par mon camarade Félix Arias Schreiber.