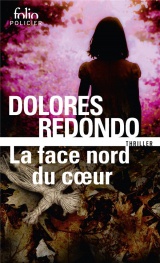La face nord du cœur
Amaia Salazar, détachée de la Police forale de Navarre, suit une formation de profileuse au siège du FBI dans le cadre d’un échange avec Europol. L’intuition singulière et la perspicacité dont elle fait preuve conduisent l’agent Dupree à l’intégrer à son équipe, lancée sur les traces d’un tueur en série recherché pour plusieurs meurtres de familles entières. Alors que l’ouragan Katrina dévaste le sud des États-Unis, l’étau se resserre autour de celui qu’ils ont surnommé le Compositeur. La Nouvelle-Orléans, dévastée et engloutie par les eaux, est un cadre idéal pour ce tueur insaisissable qui frappe toujours à la faveur de grandes catastrophes naturelles.
L’association du réalisme cru de scènes apocalyptiques en Louisiane, de rituels vaudous des bayous et de souvenirs terrifiants de l’enfance basque d’Amaia constitue un mélange ensorcelant et d’une rare puissance romanesque.
Ce livre fait partie d’un cycle de romans inspirés par le Nord. Dans certains, Amaia Salazar est l’héroïne principale ; dans d’autres, les personnages et les intrigues s’entrelacent, créant un univers commun dont le Nord n’est pas toujours un point cardinal, mais le fil conducteur. Car le lieu le plus désolé du monde est la face nord du cœur humain.
Extrait
Elizondo
Prologue
Quand Amaia Salazar avait douze ans, elle se perdit dans la forêt pendant seize heures. On la retrouva à l’aube à trente kilomètres au nord de l’endroit où elle avait quitté le chemin. Évanouie sous une pluie battante, les vêtements noircis et roussis comme ceux d’une sorcière médiévale rescapée d’un bûcher. En revanche, sa peau était blanche, propre et froide comme si elle venait de sortir de la glace.
Amaia affirma toujours qu’elle ne se rappelait presque rien de tout cela. À partir du moment où elle avait quitté le chemin, le film dans sa mémoire durait seulement quelques secondes, d’images répétées inlassablement. La vitesse vertigineuse de ses souvenirs lui procurait la sensation du praxinoscope de Reynaud, dans lequel la répétition successive d’images en mouvement finissait par provoquer un effet d’immobilité absolue. Parfois elle se demandait si elle avait marché dans la forêt, ou si elle s’était contentée de s’asseoir là et de rester sans bouger à regarder le même arbre pendant tellement longtemps que son cerveau était tombé dans une sorte d’hypnose, au point de graver pour toujours dans son esprit sa silhouette primitive et maternelle. C’était un dimanche matin comme un autre, où elle était allée marcher en compagnie de son chien, Ipar*1, avec le groupe de randonneurs d’Aranza qu’elle avait rejoint le printemps précédent. Elle aimait la forêt, mais elle avait accepté, surtout, pour faire plaisir à sa tante, Engrasi, qui depuis des mois la pressait de sortir davantage. Toutes deux savaient qu’elle ne pouvait pas le faire dans le village. La dernière année, ses trajets s’étaient limités aux allers-retours entre l’école et la maison, et à accompagner sa tante à l’église le dimanche. Sinon elle demeurait chez Engrasi, assise près du feu, lisant ou faisant ses devoirs, aidant au ménage ou à la cuisine. N’importe quel prétexte était bon pour ne pas franchir le seuil de la porte. N’importe quelle excuse pour ne pas avoir à affronter ce qui se passait dans le village.
Amaia raconta toujours qu’elle se rappelait seulement l’arbre, rien d’autre... même si ce n’était pas tout à fait vrai. Dans ses souvenirs il y avait toujours l’arbre, mais aussi la tempête... et la maison au milieu de la forêt.
Quand elle reprit conscience, elle vit son père à côté de son lit d’hôpital. Pâle, les cheveux mouillés par la pluie plaqués sur son front. Ses paupières irritées par les larmes étaient cerclées de rouge. Quand il la vit ouvrir les yeux, il se pencha, le visage crispé, mais avec un début de soulagement. Cette attitude la remplit d’une immense tendresse, l’émotion menaçant de la submerger. Elle l’aima, comme elle l’avait toujours aimé. C’est ce qu’elle voulut lui dire, mais elle sentit alors le léger contact de ses lèvres chaudes lui susurrant à l’oreille :
— Amaia, ne le raconte à personne. Si tu m’aimes, fais-le pour moi. Ne raconte rien.
Tout l’amour qu’elle éprouvait, qu’elle avait toujours éprouvé pour lui, lui oppressa douloureusement le cœur. Les mots destinés à lui dire combien elle l’aimait moururent en elle et restèrent comme un souvenir pénible, collés à ses cordes vocales. Incapable d’émettre un son, elle acquiesça, et son silence devint le dernier secret de son père qu’elle garderait et la raison pour laquelle elle cessa de l’aimer.