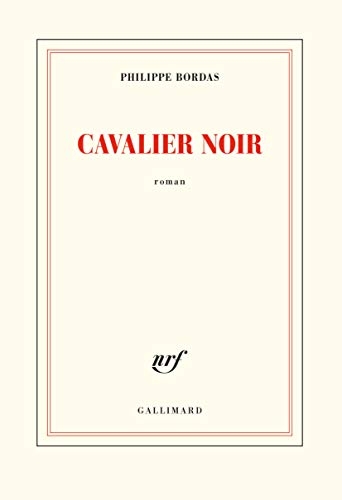Cavalier noir
Solaire et musicale, Mylena est de l’étoffe féerique dont son amant rêve d’habiller le français.
Détaché de son ancienne vie, chargé de son vélo et de ses écrits, ce dernier prend le train un matin et traverse les brumes, de Paris jusqu’à Heidelberg, où l’attend Mylena.
Là, dans un chalet perché au cœur des bois, le narrateur réinvente sa vie. À travers monts et forêts, il pédale tout le jour, puis rejoint la jeune femme dans son nid d’aigle, mais les nuits souvent le ramènent au souvenir de ses vingt ans, quand il quitta la banlieue de béton de son enfance pour les classes de lettres supérieures.
L’histoire intense de ce nouvel amour alterne avec les réminiscences des heures terribles vécues dans ces classes d’élite, quand, enfui de la cité des mauvais parlers, le narrateur vit la promesse de haute langue française céder la place à l’apprentissage de langues maléfiques.
Au fond de ces mêmes vallées boisées du Neckar s’est retiré un ancien camarade de classe, auprès de qui le narrateur découvrira le secret de ces sortilèges subis à vingt ans.
Dans Cavalier noir se mêlent l’amour d’une femme et l’amour de la langue. L’écriture singulière et sensuelle de Philippe Bordas ouvre à la traversée envoûtante des forêts et des paysages encore pleins de l’empreinte des poètes romantiques allemands.
Extrait
Mon cœur s’est descellé du cœur de Paris. Plus rien ne me tient à ce bord de Seine dont j’ai tant rêvé. Je quitte mon quartier, mon fief, ma coutume. Je laisse derrière moi les décennies d’amour et le balcon d’altitude d’où la ville s’enflamme, du halo de Courbevoie jusqu’au bois de Vincennes. Évanouies l’épouse et la quiétude, effacées les promesses, les syllabes et les heures de laine. J’ai tout perdu et renoncé. J’ai réalisé mes biens, vendu mes livres, mes fétiches d’Afrique, sans mesurer mes fautes ni trouver le pardon.
Un soir d’avril, j’ai attendu le crépuscule sur mon promontoire et respiré la dernière lumière. J’ai pris le garde-corps à deux mains et laissé chuter ma tristesse derrière la lisse de métal noir. Là, au-dessus des tilleuls, la nuit a pris mon visage. J’ai brûlé mes carnets sur une feuille d’aluminium. La fumée s’est enfuie vers les tours de Saint-Sulpice et les photophores par milliers ont palpité sous les zincs.
Depuis cet autodafé, je n’ai plus mendié remèdes ni baumes contre l’ulcération des plaies. Je me suis soustrait aux hurlements de chien-loup d’Iggy Pop et aux alcools terreux qui dérivaient l’arc de la douleur vers les profondeurs de l’immeuble, de mon studio aérien jusqu’aux vieilles carrières maintenues de piliers. J’ai délaissé l’acide des Parisiennes et les lèvres de hasard qui ne ressuscitent personne. Depuis que j’ai abandonné le quartier rouge et les vénéneuses à voix de crécelle se déficellent les heures vaines et les petites délinquances sexuelles; les aigus se perdent dans les plis de velours, s’éloignent les figurines.
Maintenant que je pénètre dans l’instant de l’amour chimérique, les femmes vivantes n’entrent plus dans ma curiosité. Je retourne à ma vie d’errance et de libre sang. Les cicatrices du picaro se rouvrent et la chair est nue. Les silex meurtrissent mes semelles et je retrouve la solitude sans fond, celle des vingt ans.