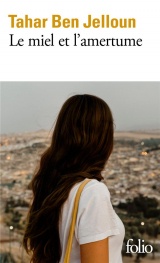Le miel et l'amertume
Tanger, au début des années 2000. Un pédophile abuse de jeunes filles en leur faisant miroiter la publication de leurs poèmes dans son journal. Il agit en toute impunité, sans éveiller le moindre soupçon.
Ce roman raconte l’histoire d’une de ses victimes, Samia, une jeune fille de seize ans. Elle ne se confie pas à ses parents, mais consigne tout dans son journal intime, qu’ils découvriront bien après son suicide.
À partir de cette tragédie, les parents de Samia basculent dans un désordre qui révélera leurs lâchetés et leurs travers. Le père, homme intègre, rejoint la cohorte des corrompus. Ensemble, ils s’abîment dans une détestation mutuelle aussi profonde que leur chagrin.
La lumière viendra d’un jeune immigré africain, Viad. Avec douceur et bienveillance, il prendra soin de ce couple moribond. Viad panse les plaies et ramène le souffle de la vie dans la maison. Le pauvre n’est pas celui qu’on croit. Et le miel peut alors venir adoucir l’amertume de ceux qui ont été floués par le destin.
Extrait
J’habite un sous-sol tellement bas qu’il m’arrive parfois de le confondre avec une tombe. Il est froid, ce qui m’arrange l’été et qui m’agace l’hiver, surtout que cette saison, à Tanger, est très humide. Au-dessus, nous avons une maison, construite à l’époque où tout allait bien et où nous étions, ma femme et moi, assez confiants dans l’avenir. Nous étions stupides et nous ne le savions pas. Nous étions même heureux et nous ne nous rendions pas compte de notre chance.
Les étages au-dessus sont fermés, ou plutôt interdits. Les salons et les chambres sont meublés, les rideaux tirés, les tapis étalés et fixés au sol. De temps en temps des chats viennent y faire leurs besoins. Nous l’apprenons par l’odeur. Nous ne recevons jamais, personne n’a jamais été invité dans les étages. C’est ainsi et je ne veux pas aborder ce sujet avec ma femme. J’ai appris qu’il ne faut pas discuter certaines décisions absurdes. Nous vivons donc, si on peut appeler ça vivre, dans quarante-neuf mètres carrés. Pas de fenêtre. La lumière entre par la porte ou par la lucarne de la cuisine.
Nous nous sommes installés là quelques mois avant la tragédie. Punis. Dorénavant, nous nous enterrons dans ce sous-sol que j’appelle souvent « la cave ».
Mon matelas n’est pas très épais. Je m’en contente ; je m’y suis même habitué. Je suis de petite taille et assez mince. Celui de ma femme a l’air plus confortable. Chacun est dans un coin. Cinq mètres nous séparent. Parfois ce sont des milliers de mètres qui s’installent entre nous.
La cuisine et la salle de bains sont de l’autre côté. Le reste de l’espace, on l’appelle « le salon télé », où trônent nos deux téléviseurs. Chacun le sien dans la mesure où nous n’avons pas les mêmes goûts. Munis d’un casque, nous regardons des programmes différents. Ma femme adore les séries turques et brésiliennes doublées en arabe dialectal. Moi, je regarde des films classiques et certaines émissions de débats politiques. Parfois, elle s’endort et le casque tombe. Je me lève et j’éteins sa télé. Le lendemain, elle m’en veut de lui avoir fait manquer la fin de l’épisode.
Depuis que j’ai pris ma retraite, j’essaie de ne pas mourir. Je me demande bien pour quelle raison je résiste. Mes joies sont si rares. Mes souvenirs sont fatigués et je fais un effort pour ne plus les convoquer, m’y réfugier. J’apprends à m’en méfier.
Je suis ce que je peux. Pas grand-chose. J’ai essayé de fermer la blessure, non pas de l’effacer, mais au moins de l’éloigner de moi, de nous.
Il m’arrive de fixer un point dans ce sous-sol. Ma vue se brouille. Tout devient flou. Ce qui m’entoure m’oppresse et me navre. Ce lieu est bien trop grand pour servir de tombe. J’ai vu l’autre jour à quoi était réduit le corps de mon ami d’enfance quand on l’a déposé dans la tombe. Il devait peser moins de quarante kilos. On l’a installé sur le côté droit, comme s’il dormait. Le linceul trop blanc était taché de terre brune. Une petite chose recouverte de blanc et de terre. Le soir, j’ai eu du mal à trouver le sommeil.
Nous sommes enterrés sous cette maison qui, vue de l’extérieur, renvoie pourtant l’image d’une belle réussite. La maison nous écrase. La maison nous nargue. La maison nous tue lentement. Elle a été la scène de notre bonheur bref et de notre malheur permanent. Ma femme en parle comme si c’était une vieille dame méchante qui nous en voulait. Elle dit : « Cette baraque finira par avoir notre peau ; elle s’acharne sur nous ; c’est le démon qui l’habite... »