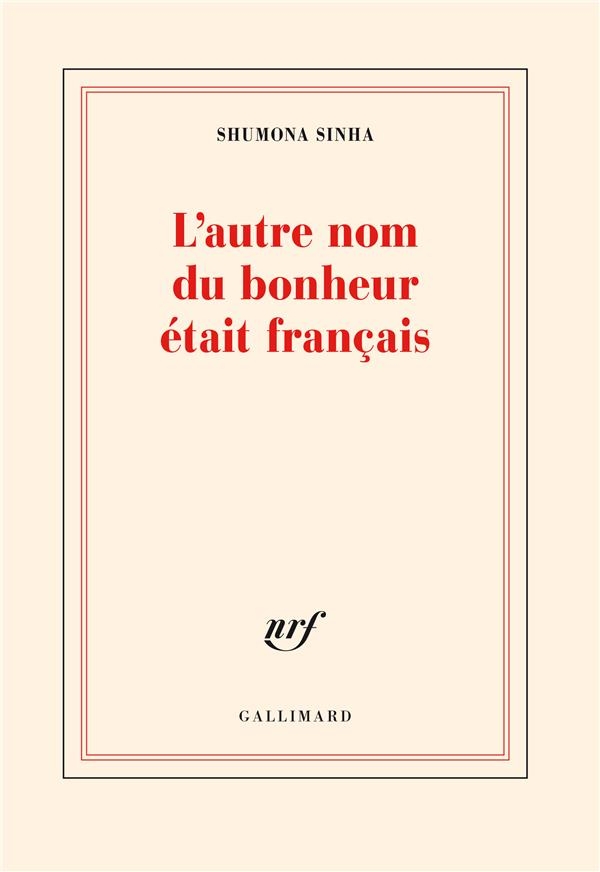L'autre nom du bonheur était français
Shumona Sinha, née à Calcutta, a appris le français à l'âge de vingt-deux ans. Depuis, elle considère cette langue comme sa "langue vitale", celle qui l'a libérée, sauvée, fait renaître. Venue vivre en France à vingt-huit ans, autrice de cinq romans tous écrits en français, elle raconte son itinéraire, semé de déceptions : les années passant, elle conserve l'image d'une femme exilée, étrangère dans un pays qu'elle avait cru celui de son émancipation. Ce livre puissant, d'une grande sincérité, apporte un éclairage sur l'oeuvre et la vie d'une Indienne qui a choisi de vivre en France, d'habiter notre langue, et qui confie : "Pour chaque mot j'ai fait un long voyage."
Extrait
L’errance ou le début du corps
Je suis arrivée ici un après-midi d’automne. Une lumière pourpre et dorée inondait la ville. La ligne frissonnante entre le ciel et le fleuve était effacée. Je pensais aux tableaux de Turner.
Très vite j’ai compris ce que la ville attendait de moi, ce qui devrait être mon occupation principale ici, dans cette ville d’Europe : rôder.
Je fendais la foule. Les touristes hardis et les riverains flâneurs. Moi je n’étais ni détendue ni paisible. Je marchais vite et j’avais une idée derrière la tête. Depuis le campus de la Cité universitaire, je prenais toujours le même trajet. Je dessinais toujours le même cercle. Comme si je détenais sans le savoir le code secret d’un lieu magique, d’une tour cachée, d’une source d’énergie interstellaire avec laquelle fusionner. J’ignorais presque tout du reste de la ville et de ses alentours mais je lisais, je répétais, je récitais chaque mur, chaque ruelle et chaque recoin de la trajectoire que je m’étais imposée.
Aller d’abord vers la place de la Sorbonne. Me mouiller secrètement les mains à sa fontaine. M’arrêter devant le Reflet Médicis, puis devant le Champollion, papoter avec la guichetière et m’aviser de la couleur de ses mèches qu’elle changeait régulièrement, remonter le boulevard Saint-Michel vers le jardin du Luxembourg, laisser le Rostand à ma droite, continuer encore, m’arrêter devant José Corti, discuter Julien Gracq avec les libraires, et monter encore, vers le Sénat, vers le théâtre de l’Odéon, revenir sur mes pas, contempler les affiches au cinéma Saint-André-des-Arts, continuer encore et me perdre devant les vitrines des galeries d’art, pour aller enfin vers la Seine. Vers ses vagues. Écouter l’eau. Avant de m’asseoir sur le pont en bois, le pont aux cadenas, le pont aux millions d’amours. Puis regarder, regarder la coupole dorée de l’Académie française. Jamais dans mes rêves les plus sauvages de l’époque, de l’année 2001-2002 donc, je ne me serais imaginée debout dans la salle bondée sous la coupole, les jambes vacillantes, le corps entier transformé en oreille géante. Il aspirait chaque mot prononcé par Jean-Luc Marion. Le directeur en exercice de l’Académie me félicitait pour le courage de mon choix, celui d’écrire en français, avant de me décerner le Prix du rayonnement de la langue et de la littérature françaises.
Pourquoi est-ce que j’écris en français ? En quoi est-ce un acte de courage ? Pourquoi n’écris-je pas en bengali, ma langue natale? Pourquoi, alors que si grande était mon ambition de reconnaissance internationale, n’avoir pas choisi d’écrire en anglais, comme tant d’autres auteurs de mon pays natal, l’Inde ? Est-ce que j’écris vraiment en français? Est-ce que je pense en français? Ou bien est-ce que je traduis en français, depuis le bengali ou l’anglais, sans même y penser ?
Les questions fusent de toute part.
Le travail littéraire que j’ai effectué jusqu’à présent non seulement mérite, mais m’impose aujourd’hui d’aller à la source des choses, au début des périples qui m’ont projetée sur le territoire de la langue française.
Franchir la frontière n’est pas anodin. On délaisse forcément un bout de son être, ce qu’aucun douanier ne saurait repérer. Je suis ce qui reste comme le sédiment de moi-même, de ce que j’ai été autrefois. Dans une autre ville. Dans un autre pays. Je suis devenue le souvenir de moi-même. Je l’ai transporté jusqu’ici dans mon corps comme de la cendre dans une urne.
Je suis devenue Autre. J’ai brandi mon nouveau visage comme un drapeau et je l’ai porté dans la foule, dans cette ville, enchantée.
Qu’est-ce qui a pu déclencher une telle rupture et une genèse si exaltante ?
Dans les rencontres littéraires, ces questions reviennent, qui devraient me flatter. Je me suis inscrite au cours de français à l’âge de vingt-deux ans à Calcutta, et à vingt-huit ans je suis arrivée en France. Rien ne laissait présager que, neuf ans après avoir feuilleté pour la première fois les manuels Sans frontières et Bonne route, j’écrirais des livres en français. Je ne dis pas dans la langue de Molière, ou de Stendhal, ou de Duras, car, même si les écrivains partagent les mêmes codes alphabétique et linguistique, il est impossible qu’un écrivain puisse écrire dans la même langue que celle d’un autre.
Mes introspections linguistiques, qui constituent la matière même de mes textes, n’auraient pas existé si je n’avais pas entamé mon aventure dans la langue française. Elles n’existent que parce qu’elles existent en français. Elles n’ont pas d’autre lieu que la langue française.
De ma langue natale, je suis arrivée à ma langue vitale. Vitale car il m’est désormais impossible de concevoir ma vie dans une autre langue que le français. On ne choisit pas la langue, c’est la langue qui nous choisit. Alors on est habité par la langue. C’est charnel. Ça se passe dans le corps. Comme l’air qui circule dans les poumons.
Pour décrire mon ancrage à la langue française, je dois remonter au moment où j’ai abandonné non seulement ma langue natale mais aussi d’autres langues ambiantes en Inde. Au départ, il n’y a pas eu d’élection, ni de rupture. Les langues étaient abondance, errance, concomitance.