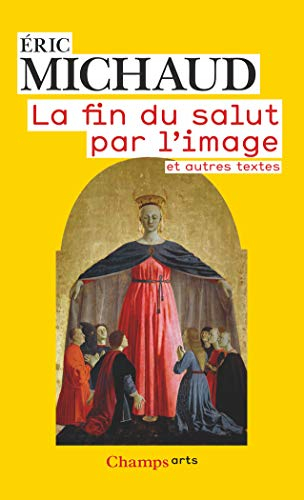La fin du salut par l'image et autres textes
Instituée par la théologie chrétienne, la fonction salvatrice de l’image fut réactivée par les romantiques après l’annonce de la « mort de Dieu ». Dans cet ouvrage, trois séquences (Sauver – Unifier – Dévorer) esquissent l’histoire récente de cette fonction. Depuis le salut individuel de l’artiste avec Eugène Delacroix jusqu’au salut du « peuple» par l’art avec Fernand Léger ou le Bauhaus, l’activité artistique a décliné ses promesses de bonheur jusqu’à l’épuisement, entre l’invention d’un présent insaisissable et celle d’une œuvre d’art totale, finalement destructrice.
Mais après que Lucio Fontana eut précipité encore « la fin de Dieu » pour affirmer la liberté illimitée de l’art, après que Joseph Beuys eut répété une fois encore l’identification dévorante de l’esthétique au politique, tout mythe de rédemption et d’unification future sembla avoir déserté l’activité artistique, qui s’expose désormais comme pur désir de survie, ici et maintenant, selon l’immanentisme de la loi de la concurrence.
Extrait
L’INSENSIBLE. MÉLANCOLIE DE LA RELIGION ET MANIE DE L’ART
Pourquoi le romantisme allemand proclame-t-il, dans un même mouvement, la mort de Dieu et la possible rédemption de l’humanité par l’art ? Et de quel dieu célèbre-t-on ici la mort ?
En 1796, Jean-Paul, par deux fois, annonce la mort de Dieu. Une première fois lorsque « Du haut de l’édifice du monde, le Christ mort proclame qu’il n’y a point de Dieu » et que nous sommes tous orphelins, ajoutant peu après cette parole : « Ah, si chaque Moi est son propre Père et son Créateur, pourquoi ne peut-il être aussi son propre Ange destructeur ? » Une seconde fois dans « L’Anéantissement », cet autre rêve écrit la même année, où surgissent, l’une après l’autre, les deux faces du dieu : celle qui anéantit et celle qui protège ; celle qui dit au rêveur : « Prends peur et meurs, je suis Dieu !... » et celle qui le rassure : « Je suis l’amour éternel, tu ne peux mourir. » Ainsi, conclut Jean-Paul, le rêve (mais nous comprenons qu’il s’agit tout aussi bien de la fiction de l’art) est tout à la fois le produit de notre angoisse dont il vient hâter la crise – et la guérison de cette même angoisse.
Est-ce donc le dieu terrible parce qu’anéantissant qui meurt à cet instant de l’histoire, ou bien le dieu protecteur, celui qui est Amour et guérison, celui qui lie ce que l’autre défait ? Mais peut-être le dieu qui meurt est-il celui que Schelling, dans Les Âges du monde, décrit comme l’instance du refoulement lui-même, terrible en cela-même qu’il représente ce qu’il refoule, qu’il nous menace de l’horreur qu’il contient :
En pensant à tout ce qu’il y a d’effrayant dans la nature et dans le monde des esprits et à toutes les choses, plus redoutables encore et plus nombreuses, qu’une main bienveillante semble écarter de notre vue, on ne peut pas ne pas reconnaître que Dieu trône sur un monde d’horreurs et qu’un Dieu qui préside à tant d’horreurs et les dissimule par sa présence peut être considéré comme un Dieu terrible, redoutable, non pas au sens figuré, mais au sens propre du mot. En soi, cette vie, refoulée par Dieu ou dissimulée par lui, reste certes toujours ce qu’elle était ; les forces du feu destructeur sommeillent toujours en elle, mais apaisées et comme conjurées par le Verbe, grâce auquel le Tout est devenu Un. Que cette puissance se retire, et l’on verrait aussitôt la vie redevenir ce qu’elle était : une vie de contradictions et de désirs inassouvissables.
En destituant ce dieu qui trônait, pour nous en protéger, sur un monde d’horreurs, les romantiques se seraient donc emparés de sa puissance de liaison salvatrice pour la donner tout entière à l’art. Mais qu’advint-il alors du dieu terrible, de l’autre face du dieu ?