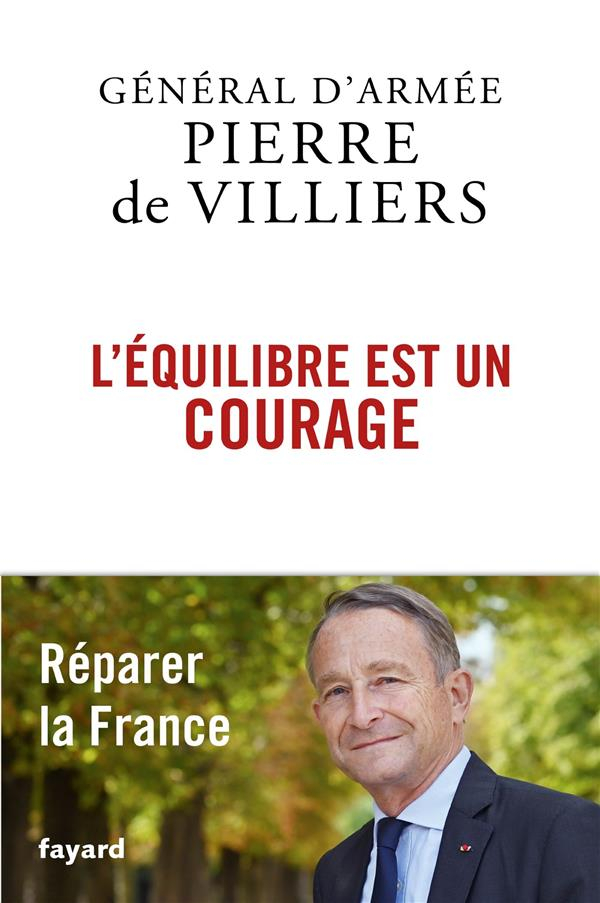L'équilibre est un courage
S’inspirant de sa carrière militaire comme des multiples rencontres que lui ont valu le succès de ses précédents livres, le général de Villiers dresse le portrait sans ambiguïté d’une France divisée, déboussolée, dépourvue de vision d’avenir dans un monde instable. Les Français ressentent à l’unisson qu’ils sont à un point de bascule, et que vient le moment du courage, d’un équilibre entre ceux qui exercent l’autorité et ceux qui doivent la respecter, entre humanité et fermeté, entre droits et devoirs. C’est ainsi que nous pourrons nous réconcilier, au-delà de nos différences, sur le chemin de l’unité et de l’espérance. Il y a urgence.
« À la fin d’une conférence, une femme d’une cinquantaine d’années se présente devant moi, visiblement émue, et me dit qu’elle a peur. “Peur pour samedi prochain.” Son mari, Gilet jaune convaincu, prévoit d’aller manifester à Paris. Or l'unité de CRS à laquelle appartient son fils a été désignée pour y assurer le maintien de l’ordre. Ne vont-ils pas se retrouver face à face ? Cette pensée la hante, comment ne pas la comprendre ? À cet instant, j’ai ressenti le déchirement qui s’opère dans notre nation, l’impérieuse nécessité d’une véritable réconciliation nationale. »
Après ses deux premiers livres, Servir et Qu’est-ce qu’un chef ?, le général Pierre de Villiers a pris le temps d’une plongée passionnante dans la France, celle des Gilets jaunes, des habitants des villes et des banlieues. Il y a vu une nation profondément divisée et menacée par ses tensions internes, mais aussi par les ruptures d’un monde instable et dangereux. Il y a rencontré des femmes et des hommes entre angoisse et envie de s’en sortir. L’union nationale ne va plus de soi. Les Français ressentent à l’unisson qu’ils sont à un point de bascule, et que vient le moment du courage, d’un équilibre entre ceux qui exercent l’autorité et ceux qui doivent la respecter, entre humanité et fermeté, entre droits et devoirs. C’est ainsi que nous pourrons nous réconcilier, au-delà de nos différences, sur le chemin de l’unité et de l’espérance. Il y a urgence.
Extrait
Halte au feu !
5 décembre 2018. Alors que je viens de terminer une de mes premières conférences après la parution de mon livre Qu’est-ce qu’un chef ?, je m’installe à la table qui m’a été préparée pour une séance de dédicaces. La salle bondée et enthousiaste se réorganise et se met en colonne « avec une discipline et un calme peu habituels dans notre pays », aux dires des organisateurs. Nous sommes au cœur de la France, à l’abbaye de l’Épau, un joyau de l’architecture cistercienne magnifiquement restauré près du Mans. Nous sommes aussi en pleine vague des Gilets jaunes. Une femme d’une cinquantaine d’années se présente, visiblement émue, et me dit qu’elle a peur. « Peur pour samedi prochain. » Son mari, Gilet jaune convaincu, prévoit d’aller manifester à Paris. Or l’unité de CRS à laquelle appartient son fils a été désignée pour y assurer le maintien de l’ordre. Ne vont-ils pas se retrouver face à face ? Cette pensée la hante, comment ne pas la comprendre ?
Je la rassure, trop rapidement comme toujours, mais comment faire plus compte tenu de la longueur de la file qui attend ? Comment ne pas être frappé, mais aussi révolté par la situation dramatique d’un père et d’un fils qu’une situation inédite oppose dans la violence sur notre propre territoire et, en l’occurrence, au cœur de la capitale ? À cet instant, en ce lieu séculaire d’histoire et de culture françaises, j’ai ressenti profondément le déchirement qui s’opère dans notre nation, l’impérieuse nécessité d’une véritable réconciliation nationale, une réconciliation qui ne nie pas nos divisions, mais qui les transcende au service du bien commun. Cette idée ne m’a plus quitté et je n’ai cessé d’y réfléchir.
Depuis ce déplacement au Mans, j’ai rencontré, écouté et entendu de nombreuses personnes. J’espère avoir compris leurs messages : le temps de la réconciliation a sonné. J’ai appris de mon expérience d’officier que seule la force fait reculer la violence. Mais je sais aussi que la guerre est un état transitoire qui doit nous amener à la paix, le seul état durable, dont nous ne réalisons peut-être pas assez le prix quand nous en jouissons. L’habitude n’est pas toujours bonne conseillère.
Dans mon premier livre, Servir, j’ai essayé de montrer combien le bonheur se trouve pour et par les autres. Dans Qu’est-ce qu’un chef ?, j’ai modestement tenté, à partir de mon expérience, de tracer les grandes lignes de ce que devrait être, selon moi, un dirigeant. J’ai parcouru la France en donnant de nombreuses conférences sur le thème « servir en tant que chef ». Naturellement et quasi mécaniquement, ces deux termes conduisent à l’unité et à la réconciliation entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent.
Voilà pourquoi le temps est venu d’écrire à nouveau. L’agenda se commande et ne se subit pas. Je le dis à temps et à contretemps dans mes conférences. L’accueil réservé à mes deux premiers livres m’y encourage. À ma grande surprise, dans chacun de mes déplacements – un à deux par semaine en moyenne –, je bénéficie d’un accueil enthousiaste et attentif dans des salles toujours pleines. Peut-être que ma voix singulière, indépendante et je l’espère authentique, au-dessus de la mêlée, résonne dans le vide actuel. Peut-être aussi qu’un équilibre entre fermeté et humanité, qui absorbe l’inquiétude et diffuse la confiance, fait l’objet d’une immense attente. Le contexte national et international l’exige, tant il est anxiogène, en particulier pour ceux qui sont au bout de la chaîne. Notre pays semble à certains égards se disloquer sous nos yeux.
Il se peut également que dans une époque parfois bien superficielle, dans le tourbillon des activités, nous ayons besoin de réflexions qui, dépassant l’apparence des choses, plongent aux racines des problèmes pour élaborer des solutions durables. Peut-être, enfin, avons-nous besoin d’asseoir cette réflexion sur une vision stratégique, bien au-delà de la ligne de crête, loin de l’écume des événements instantanés, loin des deux maux de notre époque, tels que les décrit judicieusement le général Bentégeat : « l’émotion et l’impatience ». Face au tragique de l’Histoire qui se rappelle à nous, nous manquons sans doute de points cardinaux fiables et d’une boussole stabilisée.
Notre monde est fracturé, notre pays fissuré. On évoque la fracture sociale depuis des décennies, mais nous ne l’avons jamais ressentie aussi cruellement. La confiance dans les dirigeants s’effrite chaque jour en Europe et en France. La crise sanitaire a accru ce phénomène. Notre nation se déchire comme un tissu qui s’est trop longtemps effiloché.
Avec les nouvelles technologies qui se superposent, nous connaissons une déshumanisation accélérée. L’économie mondialisée nous propulse dans des sphères de complexité et d’interdépendances quasi immaîtrisables pour l’esprit humain. La nature se dégrade et les dérèglements climatiques n’en sont qu’une manifestation parmi d’autres. Les générations se succèdent de plus en plus vite, tant les modes de vie évoluent, et la solidarité intergénérationnelle se délite, alors même que la longévité s’accroît. Le monde est en fusion, en confusion, et l’intensité de la violence augmente sous le double effet du terrorisme islamiste radical et du retour des États-puissance.
Dans la rue, à pied ou au volant, les insultes pleuvent et la nervosité grandit. Beaucoup sont à bout de souffle, à bout de nerfs, sans espoir et souvent agressifs. D’autres sont généreux et cherchent à se rendre utiles. La plupart, quoique solidaires, se retrouvent souvent très solitaires. L’individualisme et son cortège idéologique répandent une forme de sinistrose et de frustration collectives, car une personne, quand elle est seule, accède au mieux au bien-être, au pire à la déprime, mais jamais au vrai bonheur, qui passe par la rencontre et l’échange avec les autres. Il y a ceux qui cassent, ceux qui souffrent en silence, et ceux qui réparent.
La France croit même devoir faire repentance en permanence sur sa culture, son histoire, sa langue, son savoir-être, cherchant ailleurs le trésor qu’elle a en elle. L’herbe lui semble toujours plus verte à côté, dans cette mondialisation supposée heureuse des modes de vie qui devient un piège mortel pour les cultures authentiques. À l’étranger, elle est admirée, respectée, souvent adulée, et, pourtant, il lui faudrait en permanence battre sa coulpe et s’unir au cortège du désespoir. On préfère parfois commémorer Trafalgar plutôt qu’Austerlitz.
La crise du coronavirus est venue utilement nous remettre à notre place, dans notre humanité et notre vulnérabilité. Elle a mis en lumière la fragilité de notre monde et les dysfonctionnements internationaux et nationaux. Elle a provoqué une secousse planétaire amplifiée et accélérée par la globalisation. Elle doit nous faire réfléchir à cette mondialisation qu’il faut maîtriser au service des peuples et de l’humanité tout entière et pas au seul bénéfice de quelques gagnants déjà bien pourvus, voire repus. Elle doit nous remettre devant nos responsabilités nationales, car on a vu à quel point l’idée de nation est réapparue avec force face à l’imminence du péril. La nation, que certains avaient remisée au musée, est la protectrice familiale et familière du peuple, uni autour de son drapeau et de ses valeurs communes, loin de tout repli nationaliste évidemment. Cette crise porte le coup de grâce à l’image bienfaitrice d’un monde oublieux des patries, uniformisé par les marchés, nourri par un libre-échangisme sans frontières.
Le coronavirus est aussi un rappel à l’ordre de l’histoire, qui remet l’homme à sa place avec ses forces et ses faiblesses, au moment où certains commençaient à se croire immortels, à se prendre pour des dieux, à imaginer qu’un homme augmenté par les progrès fulgurants de la science accéderait au bonheur parfait. Quel retour de l’histoire ! L’homme avait oublié la place de l’imprévu. La nature reprend ses droits, renvoyant l’homme moderne à la recherche de sa propre résilience face à l’adversité.