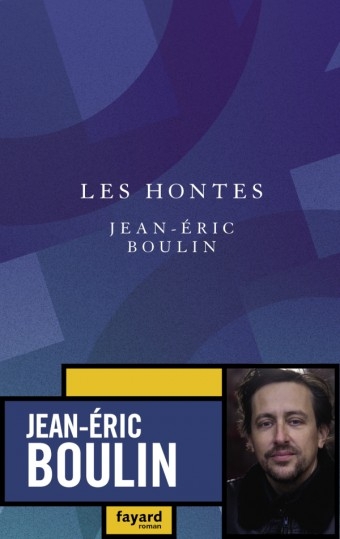Les Hontes
Dans la France endeuillée par le terrorisme, un couple se déchire sur ce que devrait être « un homme », entre virilisme darwinien à rebours de l’histoire et reste de foi en l’humanisme.
Présentation de l'éditeur
Un jeune Marseillais prépare un long article sur le renouveau du fascisme en Europe. Il suit aussi, de loin en loin, la carrière de son ami d’enfance, Reda, entré en politique.
Mais les attentats qui endeuillent la France brouillent les repères. Crispation identitaire, désir de revanche voire de « châtiment », défiance, paranoïa : la haine se répand partout. Le journaliste et sa compagne se disputent : elle voudrait un homme qui la protège ; il juge cette conception dépassée. Quant à Reda, il ne sait plus quoi faire de ses ascendances algériennes…
Entre virilisme darwinien à rebours de l’histoire et reste de foi en l’humanisme, livrés au chaos du monde, deux amis aux trajectoire différentes tentent de redéfinir ce que c’est qu’être un homme.
Extrait
J’avais éprouvé une étrange fierté lorsque l’État français avait montré les dents après la première vague d’attentats djihadistes. Une martialité, jusque-là dormante, venait de ressurgir pour défendre la vie. La fragilité démocratique était révolue. Des avions de chasse décollaient pour la Syrie. Des colonnes de soldats coiffés de bérets montagnards quadrillaient Paris et sa couronne. Un nuage de sang était massé au-dessus du pays et, venus de la profondeur et du lointain, de Castres et de Nouméa, ces soldats incarnaient une dureté nécessaire.
À Malakoff, devant la glace de la salle de bains d’Andrea, j’avais moi aussi retroussé les lèvres et montré les dents. Dans les rues, je marchais crânement, en bonhomme. Je roulais des épaules, je me sentais capable de tout. J’aurais désarmé un commando. Je serais entré dans un immeuble en flammes.
Ce matin de novembre, je prenais un café au comptoir de la Brioche dorée qui donnait sur l’esplanade de la gare de Lyon. J’attendais le Ouigo de 10 h 16 pour Nice afin d’y retrouver Andrea. Nous devions ensuite prendre le train pour l’Italie et, vraisemblablement, nous quitter là-bas. Nous avions failli nous séparer à plusieurs reprises. Notre amour se détraquait comme un corps entré dans la maladie. La vitalité le fuyait, comme si le tuteur – le désir ? la tendresse ? la domination ? – qui l’avait fait tenir deux années durant lui avait été retiré.
Il faisait chaud. Une exposition photo en plein air, intitulée « Afghanistan, des visages dans la guerre », était organisée par la Mairie de Paris sur le parvis de la gare. De là où j’étais, je pouvais voir en gros plan, étrangement virginaux, les visages des autres. La foule marchait sur l’esplanade dans ma direction. Je me tenais face à elle, le coude calé contre le comptoir. Je me suis toujours méfié de la foule. Mon instinct juif, sûrement. La foule était calme ce matin, s’écoulait vers le hall des départs.
Une colonne de soldats du plan Vigipirate est entrée par la droite dans mon champ de vision. Ils étaient disposés en quinconce et progressaient lentement, comme dans une forêt. Je les ai regardés de près. Ils étaient jeunes, avaient des bras grêles, des torses en boîte d’allumettes. Leurs fusils Famas ressemblaient à des scies sauteuses. Le rempart contre la barbarie m’a paru bien mince.
J’ai fumé une cigarette sur le quai, avant d’embarquer. J’avais le cœur serré. Je me suis mis à regarder la foule non plus avec crainte, mais comme un être cher. C’est à elle qu’Andrea me rendrait, si les choses tournaient mal en Italie. Des familles étaient alignées derrière les pères comme les Dalton. Des jeunes couples blancs en Stan Smith se mêlaient à des Séfarades en pantacourt, des femmes voilées et des retraités en K-way. Je me suis dit : « Ce sont les tiens, c’est comme une grande famille, c’est en leur sein que tu connaîtras tes plus grandes douleurs. »
De Nice, nous devions prendre un train pour Noli, sur la côte ligure. C’est dans cette ville d’eaux que nous devions, tels des dignitaires, discuter de l’état de notre amour. Nous en avions l’habitude. Nous nous étions déjà « sauvés » à deux reprises. Ferme et constructive, Andrea avait l’expertise de ces pourparlers. J’étais, de mon côté plus émotif. Je perdais rapidement toute dignité. Je pleurais à ses pieds, je bramais.
Je suis arrivé à Nice avec deux heures d’avance. Je me suis promené dans le centre-ville rose et carmin, avançant d’instinct, comme à Marseille, vers la mer. Je me suis assis sur la plage. J’ai ramassé un galet. De grands nuages venus d’Italie avançaient dans le ciel comme une cavalerie. Je ne pensais à rien. La mer était calme. Je me suis dit : « Il y aura une première fois où tu regarderas cette mer sans elle », et je me suis enfoui le visage dans les mains. Je suis resté une heure puis je suis reparti. J’ai traversé la place Masséna en diagonale, comme le fou sur un échiquier. Je me suis arrêté devant un hôpital. Une ambulance était garée devant. Des ambulanciers ont transporté sur un brancard un corps recouvert de couvertures, d’où dépassait un bras maigre, blanc porcelaine. Dans cet immeuble beige, des hommes et des femmes étaient en train de rendre leurs âmes. J’ai montré les dents et grondé comme un chien.
Je me suis pris une part de socca dans le vieux Nice, que j’ai mangée debout, en regardant les passants dans les yeux. Puis, j’ai rejoint la gare. J’étais encore en avance. Je n’arrive pas à faire autrement. Andrea dit que les gens de droite sont à l’heure. Elle est toujours à l’heure. Je me suis regardé dans la glace d’un Relay près du tableau d’affichage. Les voyageurs me frôlaient. J’ai essayé de mémoriser la manière dont j’étais habillé, tout en noir, de l’expression de mon visage ce jour-là. J’ai essayé de me « fixer », mais je n’y suis pas arrivé. Je n’ai vu ni mon corps, ni mon visage, mais une membrane contractée par la peur. J’ai fermé les yeux, envahi par l’angoisse familière. J’ai rouvert les yeux, cherchant un appui. Je me suis accroché aux titres des journaux du Relay presse. « L’OM en costaud », titrait L’Équipe. Le ministre de l’Intérieur était en une du Monde. La veille devant le Parlement, il avait présenté un projet de loi portant à soixante-douze heures la garde à vue pour actes terroristes. Il ressemblait à un gladiateur du dimanche avec sa bouche tordue, son poing serré.
J’ai vu arriver Andrea de loin, fendant la foule comme un couteau. Ses cheveux aux épaules, noirs de jais. Ses grands yeux bruns. Sa démarche assurée. Elle occupe le monde sans aucune hésitation. C’est ce que j’aime le plus en elle, son côté armada, spectaculaire. Mon cœur s’est désintégré. Je me suis mis à pleurer, à gros bouillons. J’ai pensé à ma mère. Elle m’aurait dit : « Tiens-toi, on nous regarde. » C’était l’insurrection des souvenirs avec Andrea. La mélancolie des dimanches traversés sur son balcon à Malakoff. La façon dont ses narines battent comme de petites ailes quand elle rit. Le sexe du début, brut, somptueux. L’avenir toisé derrière la ligne de son corps.
Je n’arrivais pas à m’arrêter. De la morve me coulait du nez, comme les enfants. J’étais secoué de hoquets. Les voyageurs, autour, me contournaient. Certains se sont retournés. Une contrôleuse de la SNCF avec une casquette mauve. Un blédard avec un sac banane. Un moustachu avec des autocollants orange fluo de la CGT sur sa veste en jean. J’ai entendu Andrea soupirer. Elle détestait que je pleure. Elle a fait mine de lire les journaux au Relay, puis, lorsque je me suis calmé, elle s’est avancée vers moi, m’a tendu la main et a dit : « Monsieur. » Elle portait la même robe ocre que le jour où nous nous étions rencontrés. Elle avait par-dessus un cardigan en laine à mailles épaisses de couleur crème. Elle avait eu la force ce matin de marier les couleurs, de se maquiller. Je l’ai suivie jusqu’au train Corail.
Nous nous sommes assis l’un à côté de l’autre, sans un mot, dans un espace à quatre. Le train est parti. Le ciel était gris. La ville était composée d’immeubles en plomb. Il y avait cette luminosité d’hiver, blanche, qui tient davantage de la lueur que de la lumière. Un jeune reubeu s’est assis en face de moi, habillé, au vu de ses chemise et pull noirs cintrés, en Zara. Trente ans peut-être. Il sentait l’after-shave. Costaud. Il devait faire de la barre. Il avait la même gestuelle que les minots de Marseille, de Reda, tout du moins du premier Reda, tranchée, nette. Il avait, lui aussi, le corps du malentendu.
Nos regards se sont croisés. Je me suis instinctivement raidi, prêt à la violence. Le passé français, les cent trente années d’horreur coloniale ont ressurgi. Les corps arabes longtemps écrasés, debout maintenant, dont la présence est une demande de justice. Ce karma historique dont nous n’arrivions pas à sortir. Nous avons détourné les yeux. Moi, très vite, lui aussitôt après. Je n’aurais pas permis qu’il baisse les yeux devant moi.
Nous avions échoué, si ce n’est à nous rencontrer, à être, comme en démocratie athénienne, indifférents l’un à l’autre. Andrea n’avait rien vu de la scène. Elle était détendue dans son siège. Elle avait enlevé ses talons. Je pouvais voir le vernis de ses ongles de pied sous ses bas noirs. Cela m’a bouleversé, ce vernis posé en automne. Elle regardait par la fenêtre, le visage sans expression. J’ai voulu lui prendre la main mais elle l’a retirée aussitôt. Je lui ai parlé dans le cou, là où la voix fait courir un frisson. Je lui ai demandé si elle avait fait exprès de mettre la même robe que le jour de notre rencontre. Elle ne m’a pas répondu. Elle a fouillé dans son sac et sorti un livre de Sylvain Tesson.
Le train est passé devant le quartier d’Alésia, le ghetto arabe de Nice, enclavé comme un village de haute montagne. Des barres d’immeubles étaient alignées près d’une aciérie. Une dizaine de jeunes de ce quartier niçois étaient partis combattre en Syrie, pour ce qu’ils pensaient être leur guerre d’Espagne. Ils y étaient tous morts.