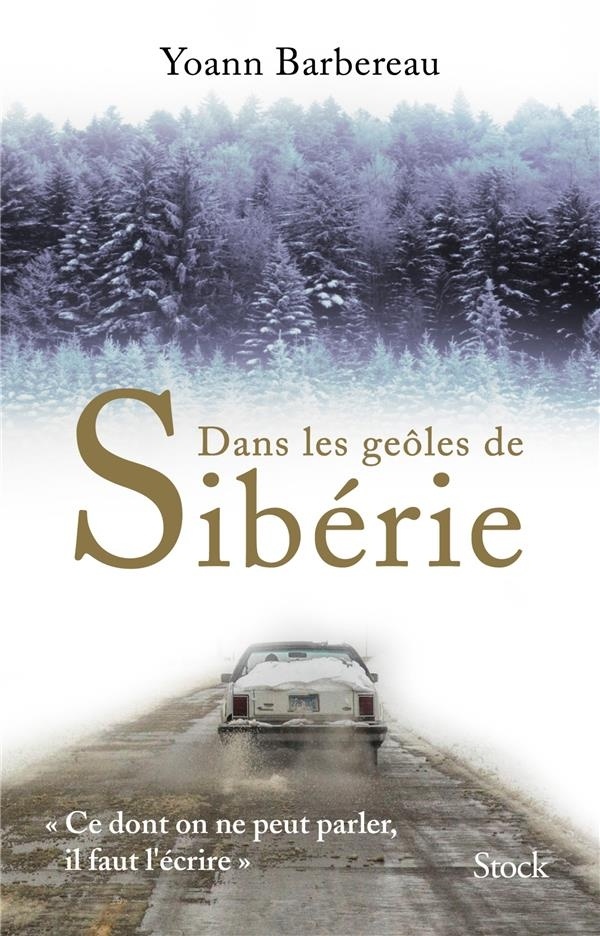Dans les geôles de Sibérie
« La scène se joue non loin du lac Baïkal, où je vis, où j’aime, où j’ai la chance d’être aimé, à Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale. Des hommes cagoulés surgissent, c’est le matin. Ma fille crie. Elle a cinq ans. Je suis arrêté sous ses yeux, frappé ensuite avec science, interrogé, mais surtout frappé de ce mot ignominieux qu’il m’est pénible d’écrire : pédophilie. Sous les cagoules et dans l’ombre, des hommes veulent ma peau. Ils ont enclenché une mécanique de destruction, grossière et implacable, elle porte un nom, je le connais, le mot a été inventé par le KGB : Kompromat.
Dans les geôles de Sibérie, je tente de comprendre. Dans l’hôpital psychiatrique où je suis plus tard enfermé, je tente de comprendre. On me promet quinze années de camp à régime sévère. L’histoire de mes évasions peut commencer.
Nommer les personnages et les lieux importe peu. Je n’ai rien inventé. C’est un film, et ce n’en est pas un. C’est un roman, et ce n’en est pas un. Ce qui importe, c’est le moment de beauté où la littérature rend la vie plus intéressante que la littérature, ce qu’il faut, c’est l’attraper comme on attrape un poignard. La meute lancée à mes trousses craignait que tout finisse dans un livre. Le voilà. »
Extrait
Tiens, des mots bruissent dans ma tête de taulard.
Une voix dit :
« Il l’ignore, pourtant, celui qui n’a pas senti le gel prendre sur sa peau n’est que l’ébauche d’un homme. »
La formule est un peu sèche, un peu raide, sentencieuse. Sortie de la bouche d’Alexandre, ce jour-là, elle était juste. Elle sonnait. Nous étions au bord du lac, dans une cabane qui aurait pu être un décor de cinéma. Température extérieure : – 41 °C. Le poêle réchauffait les corps à l’excès. J’étais en nage.
J’étais en forme. Viktor me servit une goutte de vodka dans un gobelet en argent dont il était très fier. Alexandre fit l’impasse. Il y avait la cabane, les bûches sagement empilées près du poêle, quelques flammèches, l’odeur du bois, du poisson, les petits gobelets et la fenêtre qui nous happait. Pris entre les falaises, la forêt et le lac glacés, nous goûtions une forme de félicité au milieu de nulle part – aucune route et pas âme qui vive à moins de dix heures de marche. Le gel est entré dans la conversation, je m’en souviens. Alexandre était cramoisi, mais des phrases limpides sortaient de sa barbe poivre et sel. Je les entends du fond de ma geôle.
« L’expérience du gel est une mise en question. C’est la mise à l’épreuve de ce qu’un homme sait du fait d’être. »
Nous étions prêts. Nous avons avalé les derniers morceaux de poisson fumé et pris la direction du lac. Trois moujiks déterminés sur la glace du Baïkal. Le ciel était d’un bleu catégorique, la lumière finement ajustée. Tout concourait à rendre notre expédition théâtrale. Les petits gobelets d’argent avaient leur part, sans doute.
Il y avait surtout le lac.
En Sibérie, quand l’humidité est suffisante, quand les températures sont très basses, on peut voir apparaître dans l’air comme une poudre de diamant. La vapeur d’eau qui nous entoure, invisible d’ordinaire, se transforme en une infinité de cristaux de glace. Le monde scintille. Quelque chose s’ouvre et veut nous ceindre.
Parfois, la langue cristallise elle aussi. Appelons cela le syndrome du Baïkal. Les mots s’évaporent et peu à peu se figent comme glace. Le phénomène s’observe n’importe où, à n’importe quelle heure. C’est là son raffinement. La glace prend sous toutes les latitudes. Nous choisissons de creuser ou d’esquiver, mais nous sommes tous un jour les jouets du Baïkal. Je veux le croire.
Nous marchions sur le lac, nos corps étaient à sa merci, agités par les rigolades franches et le son d’un tambour que je tenais d’un ami chaman. Nous dansions, je frappais, avec dans la main gauche l’objet rituel – une peau de chèvre cousue sur un cadre en bois de mélèze –, et dans la droite un battoir orné de fourrure de loup. Près de la rive, on distinguait le fond rocheux jusqu’à peut-être dix ou vingt mètres sous nos pieds, puis la glace perdait sa transparence miraculeuse, l’image devenait trouble, bientôt plus rien qu’un entrelacs de fêlures sur fond de ténèbres, avec de-ci de-là des colonnes de bulles blanches immobiles. On entendait parfois des explosions sourdes, des borborygmes gloutons et malicieux. Ils nous rappelaient qu’il y avait là, juste en dessous, une grande masse intraitable que nos gesticulations pourraient irriter.
« La plus grande patinoire du monde ! » s’était écrié Viktor en glissant sur un pied – une patinoire grande comme la Belgique, avais-je lu quelque part.
Nous étions seuls à peu près, loin des jacasseries du monde. Nous arrivâmes finalement au trou. Viktor l’avait creusé le matin même à l’aide d’une tronçonneuse. Par lubie, il avait réalisé son ouvrage à plus d’un kilomètre de la rive ; et pour la beauté, pour l’âme, pour la tradition, il avait sculpté une croix orthodoxe dans la glace. Elle était posée, là, à proximité du trou.
Lorsque les mots furent en passe d’être pris dans le gel, et lorsque, au même instant, je vis dans l’air le poudroiement d’une infinité de cristaux de glace, lorsque j’aperçus autour des visages de mes acolytes comme un halo se former, et même, disons-le, une évidente auréole, je compris. Le lieu donnait son assentiment, le lac nous accordait la sainteté. Qu’il nous avalât la minute d’après était chose possible, mais, pour l’heure, les histrions prenaient place sur l’icône. Voilà ce que disaient les quelques mots qui affleurèrent avant le grand silence de glace. Nous sommes tous plus ou moins fous.
C’était un 19 janvier.
Comme tous les ans, on célébrait un peu partout en Russie le baptême du Christ dans le Jourdain, c’est-à-dire que l’on perçait consciencieusement la glace des rivières, des fleuves et des lacs, on y plongeait son corps trois fois dans le but de se purifier, on pensait renaître lavé de tout. Des autorités spirituelles peu audibles avaient averti, depuis des lustres, qu’il n’y avait là que foutaises authentiques, hérésie ou paganisme, et, dans le pire des cas, diablerie. Pourtant, les popes bénissaient volontiers les eaux, on les voyait se presser au bord des trous, à côté des secouristes et des organisateurs, certains condamnaient, mais sans trop insister, l’Église nourrissait le doute, des illuminés défendaient fougueusement la tradition, d’autres l’entretenaient en athlètes rigolards, si bien que, dans la foule indémêlable des impies, des bateleurs, sportifs et croyants, chacun ignorait s’il plongeait comme un orthodoxe des plus orthodoxes, ou comme le plus païen des sagouins. C’était très bien ainsi.
À notre manière, nous participions à la fête, loin de la foule. Viktor devint sérieux, presque protocolaire. Il se déshabilla. Il fit un signe de croix. « Allons-y doucement, prenons garde, les gars, de ne pas glisser sous la couche de glace. Ardu de retrouver la sortie, après ça… » Il entra dans l’eau, sa bouche se déforma, le visage s’ahurit. Il plongea trois fois, se signa. « Sors maintenant ! gueula Alexandre. Ne fais pas l’abruti ! Dans une flotte comme celle-là, ton espérance de vie, c’est en minutes qu’elle se compte. » Viktor se hissa hors de l’eau : « Tu exagères toujours, on ne crève pas si vite, pas moi. » Alexandre : « Tes doigts tomberaient en moins de dix minutes. » Un médecin que j’interrogeai un jour estima que les plus solides pouvaient espérer survivre une heure tout au plus.
Alexandre se déshabilla, plongea, le visage s’ahurit. Il ressortit. Il cria, vit passer dans le ciel un aigle impérial. C’était impossible en cette saison. On le lui dit. Mais il le vit. Mon tour vint. J’imitai mes acolytes. L’eau à 0 °C n’est qu’une étape, une entrée en matière. L’expérience véritable survient au sortir du trou. Le petit thermomètre que Viktor trimballait partout affichait désormais – 44 °C.
Le froid et le gel sont deux mondes. Viktor était intarissable sur le sujet, il avait sa théorie. On peut la formuler simplement : la férocité, la cruauté et l’extrême sont le domaine du gel. Il y a certes un gel modéré, celui que l’humanité connaît en général, mais tout commence vraiment à partir de – 12 °C. On parle alors de gel significatif. À – 25 °C, le gel devient fort ; on peut sentir les cristaux de glace jouer dans les narines. Il est dit sévère ou cruel autour de – 35 °C ; il tanne, brûle la peau. L’extrême se présente à – 44 °C ; et avec lui une autre manière de respirer.
– 44 °C. Je sors du trou.
L’espace d’un instant, je sens sur mes épaules des cristaux de glace se former. Mes pieds et mes orteils sont des cailloux, à peine connectés au reste du corps. Aux commissures des yeux, les larmes hésitent, elles se solidifient et se liquéfient en un va-et-vient perpétuel. Mes doigts sont paralysés. Le sang s’est replié vers les organes vitaux. Je suis incapable de me rhabiller, pantalon et chaussettes me filent entre les mains. La scène est comique et belle. J’appelle Alexandre à la rescousse. Je suis sous le coup d’une formidable décharge d’adrénaline. La chaleur revient. Je ne sais plus où sont les mots. Dans la glace, au fond du lac ou ailleurs. Peu importe. Au diable mes pauvres palabres. Le chemin du retour est cavalcade. La lumière est bonne, les rires sont une grâce, notre joie glisse sur le lac gelé.
Le monde était simple. Devant moi, il y avait l’humanité chaude et minuscule, celle qui fend le cœur.
J’étais venu en Sibérie pour ça. Je le croyais.