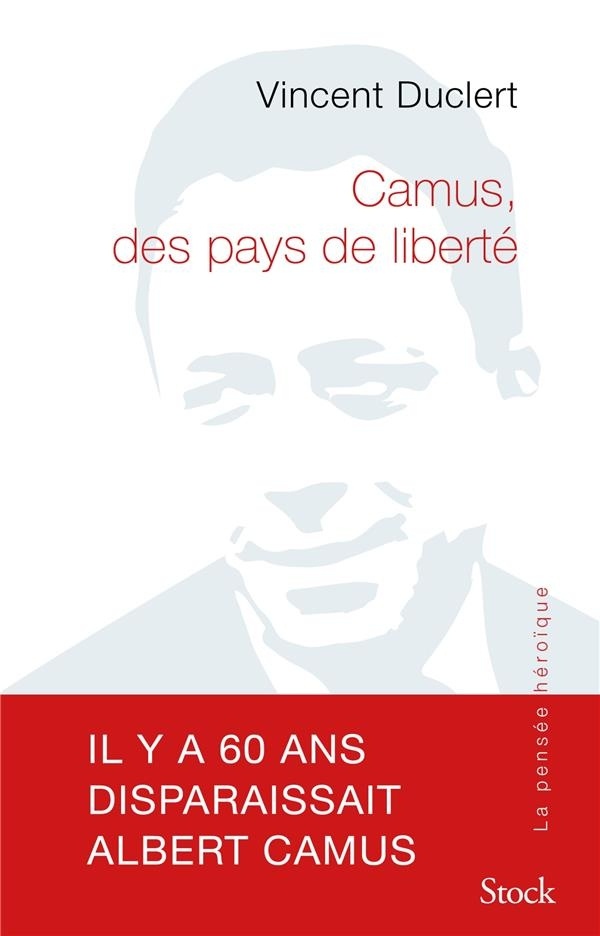Camus, des pays de liberté
« Êtes-vous un intellectuel de gauche ?
– Je ne suis pas sûr d’être un intellectuel… Quant au reste, je suis pour la gauche, malgré moi et malgré elle. »
(Entretien du 14 décembre 1959, Albert Camus avec François Meyer, université d’Aix en Provence.)
Albert Camus est mort dans un accident de voiture le 4 janvier 1960. Il y a tout juste 60 ans. Il a été de son vivant méprisé, haï même, pour avoir combattu tous les totalitarismes, pour avoir défendu une position réconciliatrice face à la guerre d’Algérie, pour avoir écrit L’Homme révolté. Il s’est tenu dans une position morale face à l’histoire tout en demeurant un homme de théâtre et un romancier exigeant.
Aujourd’hui il est reconnu, célébré souvent, toujours discuté pour sa solidarité en faveur de ses sœurs et frères algériens et sa critique permanente d’une gauche complaisante avec la violence d’État. Personnalité complexe et entière, Camus n’a pas transigé sur l’essentiel, le choix de la liberté et le devoir de vérité, lui imposant alors l'épreuve de la solitude et l’incompréhension de ses contemporains, ne comptant plus que sur le soutien de ses amis et celui des femmes qu’il aimait.
Pour mieux comprendre Camus, Vincent Duclert ouvre des archives familiales, notamment le récit de la toute dernière intervention publique de Camus (citée ici) qu’a menée son propre grand-oncle, François Meyer. Vincent Duclert revisite enfin les pays dont Camus a su donner une âme autant qu’un destin, celui de la liberté, de la vérité et du courage. Fondé sur la relecture de ses écrits notamment politiques, ce livre se veut hommage réfléchi à une pensée française autant qu’internationale, qui demeure de notre temps.
Extrait
Introduction
La liberté passe en trombe
« C’est trop jeune », murmura Catherine Sintès-Camus dans son petit appartement d’Alger lorsque ses deux petites-filles Paule et Lucienne vinrent lui annoncer que son fils n’était plus. La postérité allait décider désormais de son existence et il n’était donné qu’elle lui fût favorable. On ignorait à cet instant qu’un manuscrit d’une importance considérable avait pu être sauvé de l’accident, pouvant modifier la légende tenace de l’écrivain fini. De son vivant, Albert Camus avait été rejeté, stigmatisé à droite comme à gauche pour avoir combattu régimes liberticides d’Est à l’Ouest, pour avoir défendu une position réconciliatrice face à la guerre d’Algérie, pour avoir écrit L’Homme révolté et s’être tenu dans une position morale face à l’histoire, tout en demeurant un homme de théâtre, un romancier exigeant, un artiste conscient de ses responsabilités sociales et politiques. Il est aujourd’hui reconnu mondialement, étudié par des cohortes de chercheurs, célébré unanimement, comme en témoignent le rituel des commémorations et des anniversaires, la fréquence des couvertures de presse et des numéros spéciaux, le nombre de livres et de beaux livres qui lui sont consacrés. Un autre piège de la postérité s’est refermé alors sur lui, la perte de sens, la banalité, une autre forme d’effacement. Et comment écrire encore sur lui quand tant d’ouvrages ont été consacrés à son œuvre, à ses combats, à sa postérité, alors que ses livres ne cessent d’être réédités et de vivre auprès d’un large public dont l’audience ne se dément jamais ?
Précisément, il faut dépasser cette forme de sacralité entourant Albert Camus. Constater d’abord qu’elle renseigne en premier lieu sur l’époque présente, qu’elle reflète le désarroi devant la disparition du dernier grand écrivain français, d’un intellectuel indépendant et d’une conscience intrépide. Relever qu’elle entoure une œuvre littéraire qui n’est pas feinte, attentive au monde et à sa beauté sans rien cacher toutefois des injustices humaines et des luttes trahies. Camus ne nous est pas seulement précieux au regard de tout ce qui nous manque et dont il nous permet de nous souvenir, d’être mélancolique ou inspiré, au choix. Camus reste vivant. Son œuvre comme ses engagements et ce qu’il fut intimement rendent possible cette postérité libérée des mythes.
On peut le saisir dans ses combats portés par une écriture fondatrice d’un style intellectuel, dans le lien qu’il tissa avec une œuvre importante à laquelle il n’a jamais voulu renoncer en dépit de toutes les difficultés qu’elle représenta pour lui, grâce à des lieux qu’il habita et à sa manière de les vivre, affective et géographique, poétique et politique, les constituant en pays de liberté et en les léguant à tout un chacun. Il suffit pour cela de revenir vers ses livres et son histoire intimement liés, source d’une présence qui aide à revenir vers son œuvre. Camus incite chacun de nous à penser chacun de nous, même et plus encore quand l’espoir s’est échappé. Il amène à regarder la fragilité des êtres et des choses belles, il oblige au dépassement de soi et à la fidélité pour tout ce qui doit demeurer sur terre. Il confère à la pensée transmise un caractère héroïque.
Comprendre cette présence d’Albert Camus dans l’histoire et la géographie du monde, dans les consciences individuelles et dans la dignité qui traverse les sociétés en dépit de la noirceur de l’histoire, mènerait ainsi à témoigner personnellement d’une expérience personnelle avec Albert Camus faite de rencontres avec sa mémoire et son passé. À expliquer comment l’expérience camusienne nous a entourés et aidés à devenir ce que nous sommes. Ce serait une démarche très démonstrative, à la fois par le récit qui pourrait être fait de ces rencontres qui n’en forment qu’une aujourd’hui, et qui dure, et parce que nous sommes très nombreux à être désireux de témoigner de la trace en nous d’un homme disparu voilà des décennies, alors que nous apprêtions seulement à naître. Nous partageons un héritage commun, et cela n’a pas de prix. Ce récit viendra un jour. Nous pourrions nous inspirer des mots de René Char parlant de ses camarades tombés dans les combats de la résistance, lors d’une allocution lue à la radio le 15 août 1946 :
J’aimerais que ceux que les circonstances ont empêchés d’être à vos côtés chaque heure de votre peine et de votre solitude, en refassent furtivement par le cœur et par la pensée le trajet, trajet dont on ne savait pas alors, tant les mots s’étaient compromis, s’il était vertigineux ou pitoyable. Certainement mon souhait a perdu aujourd’hui son sens. Ils connaissent le prix de ces deux mots : rendre justice. Mais, s’il vous plaît, qu’à tous ces bras avides de construire des images de bon vouloir on ne tende pas que des fantômes…
Dans l’immédiat il y a tant à dire sur Camus, à commencer par une trajectoire dans l’histoire et face à l’histoire, dans la création et face à la création. Avec lui reviennent toujours les grandes questions morales que la politique, la littérature, l’art, ne peuvent éluder et qu’il a choisi, comme artiste, écrivain et dramaturge, d’assumer. Il est parvenu à composer une œuvre authentique, faite de combats d’écriture et de fidélités à la mémoire, tout en menant une veille efficace sur le monde et ses injustices qui impliqua de s’exprimer par le texte – ses nombreux articles brisant les silences complices – et d’agir pour soutenir nombre de persécutés abandonnés par l’histoire. Il ne concevait pas cette dernière comme un tombeau pour les rêves de paix et les révoltes de la liberté. Il affirmait pour ses contemporains cette pensée héroïque qui constitue encore aujourd’hui un exemple de lucidité, de conscience et de courage. Si Albert Camus nous manque, c’est en raison de la force d’une volonté intransigeante de ne jamais accepter la raison d’État, le sacrifice des innocents et l’effacement des invisibles.
Il enseigne la résistance obstinée à l’écrasement, le refus de l’impunité et la croyance dans la fidélité. Lui que la maladie et la pauvreté n’épargnèrent point, que ses origines algériennes et des études modestes déprécièrent aux yeux de l’élite intellectuelle, que ses ambitions littéraires et artistes furent raillées, il trouva en lui et dans le monde les ressources pour rester debout et combattre. Un courage personnel et un refus du renoncement l’amenèrent à ne jamais fuir ses responsabilités tout en s’interrogeant sur les vérités qui les fondaient. L’engagement face aux libertés menacées et aux États liberticides n’avait d’équivalent que sa volonté à transmettre une œuvre et le sens de la création qu’il mettait en elle. Albert Camus eut l’art et l’intelligence en effet, à travers une écriture littéraire d’une beauté classique, ces moments fragiles de l’existence qui nous émeuvent et nous aident à vivre. Mais il ne déserta jamais ce qu’il concevait comme un devoir d’être présent en toutes circonstances. Les images que l’on garde de lui à travers ses photographies témoignent de cette présence au monde et aux autres, Camus dans les rues et dans les trains, Camus devant les porches et sur les balcons, Camus en conférence et sur la scène, Camus dans les salles de rédaction et au marbre des imprimeries, Camus entouré de ses amis, de ses enfants et les entourant, Camus avec des revues et des livres car il aimait les unes comme les autres, se destinant au moins à trois d’entre elles, Rivages en 1938, La Revue noire en 1943, Empédocle en 1949 avec René Char. Sa vie croisa deux des maisons d’éditions les plus réputées pour leur catalogue littéraire et leur classicisme d’avant-garde, Charlot à Alger avant-guerre puis Gallimard à partir de 1942. Il demeura fidèle à l’une comme l’autre et s’attacha à y publier des livres, les siens et ceux des collections qu’il dirigeait, « Poésie et théâtre » pour la première, « Espoir » et « Les Essais » pour la seconde. Avec Camus continue de s’exprimer la souveraineté du livre et de l’écrit.
Son choix du journalisme et comme du théâtre s’explique par cette recherche de présence. Il ne renonça non plus ni à l’un ni à l’autre, le contraignant à une existence souvent surchargée et exténuante. Il compensait cette fatigue et cette tension par une consommation très déraisonnable de tabac et une recherche de moments plus authentiques, avec les femmes qu’il aimait ou bien seul encore avec ses amis, peu nombreux mais exclusifs. Des ruptures comme sur l’avenir de l’Algérie le laissaient douloureusement affecté surtout quand il percevait de l’insincérité dans les attitudes. La violence de l’histoire, celle qu’affrontaient des peuples ou des individus sans défense, le révoltait. Il en concevait un vif désir d’action en plus de l’effort de compréhension qu’il déployait. « J’aime la bagarre », confiait-il à son éditeur canadien qui avait décidé d’annuler la conférence prévue à Québec le 28 mai 1946 par peur d’un « chahut mémorable ». Il prouva à plusieurs reprises ce caractère trempé, notamment à Alger lorsque les ultras de l’Algérie française prétendirent interdire le meeting de l’Appel pour la Trêve civile porté par Camus, place du Gouvernement, aux cris d’« À mort Camus, à mort Mendès, à mort les Juifs ». Ce qui ne l’empêcha pas ce soir-là de marquer son indépendance face au FLN déjà acquis à la cause du terrorisme et qui tentait de s’imposer à l’initiative.
Camus restait attaché en toutes circonstances à la confrontation raisonnée des arguments et à la recherche des solutions raisonnables. Ces convictions ne faisaient pas de lui pour autant un modéré tenté par le compromis permanent, et que le spectacle de la violence aurait tétanisé. Il acceptait de faire face à l’histoire, confiant dans le pouvoir de la pensée capable d’affronter ses pires tragédies, et fidèle à ses camarades d’une gauche libertaire pour lesquels il se serait battu jusqu’à la fin. Cette dernière salua l’un des siens par d’importants hommages à sa mort, et plus récemment par des publications qui firent date. Ce que Camus retrouvait dans cette gauche, ce n’était par l’embrigadement dans un parti, mais la liberté qui définissait l’action, le souci de la réflexion et de l’indépendance des militants, et l’attention au mouvement social, au syndicalisme révolutionnaire qui s’était, dès 1953 à Berlin-Est, opposé à la tyrannie soviétique.
Philosophiquement, son apport est aussi original qu’ignoré en raison du procès en incompétence que lui intentèrent les sartriens en riposte à L’Homme révolté de 1952. Il est vrai que le livre n’était pas taillé pour supporter des tirs nourris qui visèrent, plus encore que ses thèses, l’auteur qui avait osé les avancer. La messe avait été dite dès la parution en 1941 du Mythe de Sisyphe accompagnant celle de L’Étranger, à travers un long compte rendu aussi exagérément élogieux que très ambigu de Jean-Paul Sartre dans les Cahiers du Sud de février 1943. Tout semblait comme s’il fallait interdire à Camus de progresser dans une voie philosophique d’une importance capitale. En effet il avait perçu confusément, comme Henri Bergson en son temps, que la philosophie du concept avait laissé à l’écart un pan immense de la compréhension de l’homme en méconnaissant sa dimension sensible. Il s’y intéressa sur deux plans, d’une part en découvrant combien la relation au monde naturel pouvait enrichir cette dimension sensible, et de l’autre en ne séparant jamais cette philosophie du sujet sensible à celle de la raison et du logos. La confrontation des deux l’intéressait particulièrement et il aboutit à sa proposition de « pensée de midi » ouvrant sur la mesure et la responsabilité de l’homme face à l’histoire. Cet idéalisme conscient de l’historicisme mais refusant qu’il dirigeât la vie humaine fait écho à d’autres tentatives de renouvellement philosophique, assumées par Jean Jaurès à la fin du XIXe siècle, par Simone Weil et Élie Halévy au milieu du XXe siècle. Aucun des trois n’eut de succès académiques flagrants.