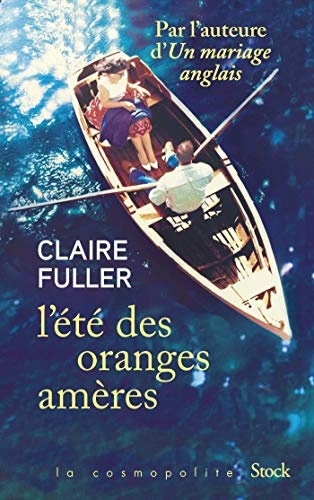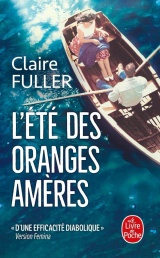L'été des oranges amères
À 39 ans, Frances Jellico s’apprête à vivre son premier été de liberté. Enfin délivrée de son tyran de mère, Frances a été missionnée pour faire l’état des lieux du domaine de Lyntons. Jadis somptueuse propriété au cœur de la campagne anglaise, Lyntons est désormais un manoir délabré qui peine à se relever des années de guerre.
Dès son arrivée, Frances réalise qu’elle n’est pas la seule occupante des lieux : Peter et Cara, un couple aussi séduisant que mystérieux, sont déjà installés. Lorsqu’elle découvre un judas dans le plancher de sa chambre – qui lui offre une vue plongeante sur leur salle de bains – sa fascination pour eux ne connaît plus de limites.
Ses voisins se montrent très amicaux, et plus les jours passent, plus Frances se rapproche d’eux. À mesure que l’été se consume, que les bouteilles de vin se vident et que les cendres de cigarettes se répandent sur le vieux mobilier, Frances commence à entrevoir le passé tourmenté de Cara et Peter. La vérité laisse place au mensonge, les langues se délient, les souvenirs ressurgissent, au risque de faire basculer cet été 1969.
Extrait
Ils doivent penser que je n’en ai plus pour longtemps puisque ce matin, ils ont laissé entrer le vicaire. Peut-être ont-ils raison, bien qu’aujourd’hui ne me semble pas très différent d’hier et que j’aie du mal à imaginer autre chose pour demain. Le vicaire – non, il n’est pas vicaire, il a un autre titre, j’ai oublié lequel – est plus âgé que moi, de plusieurs années, il a les cheveux gris, la peau squameuse et rouge, à vif telle une plaie. Ce n’est pas moi qui ai requis sa présence ; si j’ai eu la foi par le passé, elle a été largement éprouvée et mise en défaut à Lyntons, mais même avant cela, ma fréquentation de l’église était davantage une habitude, une routine autour de laquelle ma mère et moi organisions nos semaines. Je suis au point sur la routine et les habitudes ici. Nous en vivons et nous en mourons.
Le vicaire, ou pas, peu importe comment il se fait appeler, est assis près de mon lit avec un livre sur les genoux dont il tourne les pages trop vite pour pouvoir lire. Lorsqu’il s’aperçoit que je suis réveillée, il me prend la main, et je constate avec étonnement que cela me procure un certain réconfort : une main dans la mienne. Je ne me souviens pas de la dernière fois qu’on m’a touchée – en dehors de la couverture chaude qu’on remonte parfois sur moi, du peigne qu’on me passe dans les cheveux incidemment, ces gestes-là ne comptent pas. Non, vraiment touchée, tenue par quelqu’un. C’était Peter, sans doute. Oui, c’était Peter, sûrement. Il y a vingt ans, au mois d’août. Vingt ans. Que faire d’autre ici si ce n’est compter les jours et se souvenir ?
« Comment vous sentez-vous, mademoiselle Jellico ? » demande le vicaire. Je ne crois pas lui avoir dit mon nom. Je prends le temps d’assimiler le mademoiselle Jellico, je fais tourner le mot dans mon cerveau comme une bille en argent dans un jeu de bagatelle, je le fais rebondir d’une quille à l’autre jusqu’à ce qu’il atterrisse dans le trou central et fasse tinter la cloche. Je sais parfaitement qui il est, c’est son titre qui persiste à m’échapper.
« Où pensez-vous que je vais aller ? Après ? » Je lui lance la question sans préambule. Je suis une vieille chouette malcommode. Quoique, peut-être pas si vieille.
Il remue sur sa chaise comme si son pantalon le démangeait. Peut-être qu’il a la peau à vif sous ses vêtements aussi. Je préfère ne pas y penser.
« Eh bien, commence-t-il en se penchant sur son livre. Tout dépend… tout dépend de ce que vous…
— De ce que je… ?
— De ce que vous… »
Ma destination finale dépend de ce que je vais confesser, c’est cela qu’il veut dire. Paradis ou Enfer. Même si je doute qu’il y croie encore. De toute façon, nous n’attendons pas les mêmes choses de cette conversation. Je pourrais faire traîner, le taquiner un peu, mais je décide de ne pas jouer pour le moment.
« Ce que je veux dire, reprends-je, c’est où vais-je être enterrée ? Où nous mettent-ils quand nous quittons cet endroit pour de bon ? »
Il sombre dans la déception puis m’interroge : « Vous pensez à un endroit en particulier ? Vous pouvez compter sur moi pour transmettre vos volontés. Y a-t-il quelqu’un à qui vous voudriez que je parle, quelqu’un que vous voudriez inviter à la cérémonie ? »
Je reste silencieuse un moment, je fais semblant de réfléchir. « Pas besoin d’engager des figurants, dis-je. Vous, moi, et le fossoyeur, ce sera parfait. »
Il fait une grimace – de gêne ? de maladresse ? – parce qu’il voit bien que je sais qu’il n’est pas un vrai vicaire. Il n’en revêt l’attirail – le faux col – que pour qu’on le laisse entrer. Il avait déjà demandé à me voir auparavant et j’avais refusé. Mais voilà qu’avec cette conversation sur les tombes, je me mets à penser aux corps : ceux qui sont sous terre, ceux qui sont sur terre. Cara et moi, prenant le soleil au bout de la jetée sur le lac à Lyntons. Elle, en bikini – c’était la première fois que je voyais autant de peau dévoilée si près de moi – et moi, m’aventurant à relever ma jupe en laine au-dessus des genoux. Elle avait tendu le bras jusqu’à ce que ses doigts m’effleurent le visage et m’avait dit que j’étais belle. J’avais trente-neuf ans assise sur cette jetée, et personne auparavant ne m’avait jamais dit que j’étais belle. Plus tard, tandis que Cara repliait la nappe et rangeait ses cigarettes, je m’étais penchée au-dessus de l’eau verte pour découvrir avec déception que mon reflet n’avait pas changé, j’étais toujours la même, même si brièvement, cet été-là, il y a vingt ans, j’avais fini par la croire.
Les images se mettent à affluer, se superposent les unes aux autres. J’abandonne alors toute idée de chronologie et me laisse aller au ressac de la mémoire, à ses vagues montantes et descendantes. Mon dernier regard dans le judas : à genoux sur le plancher nu de ma salle de bains sous les combles de Lyntons, l’œil collé au cristallin émergeant du sol, la main sur l’autre œil pour le maintenir fermé. Dans la chambre sous la mienne, il y a un corps allongé dans l’eau rose du bain, les yeux grands ouverts fixant mon regard trop longuement. Des flaques miroitent sur le sol, des empreintes mouillées et luisantes ont commencé à s’effacer en direction de la porte. Je suis une voyeuse, je suis celle qui se tient derrière les rubans de la police et regarde une vie se défaire sous ses yeux ; je suis dans la voiture qui ralentit devant un accident mais ne s’arrête pas ; je suis la coupable revenant sur la scène de crime. Je suis la pleureuse solitaire.
Le judas. Je n’avais jamais croisé ce mot avant d’arriver ici, dans cet endroit.
Il y a combien de temps ?
« Combien de temps ? » J’ai dû poser la question à voix haute, car l’une des auxiliaires me répond. Non, pas auxiliaire ; quel est son titre à elle ? Aide-soignante ? Assistante de vie ? Ma maladie dégénérative a grignoté plus que de la chair : elle a pris tous mes souvenirs de la semaine passée, de même que les noms, les titres qu’on m’a dits il y a à peine une heure, mais elle a eu la gentillesse de ne pas s’attaquer aux souvenirs de l’été 1969.
« Il est 11 heures 40 », répond la femme. C’est celle que j’aime bien ; sa peau a la couleur d’un marron que j’avais ramassé fin septembre et retrouvé dans la poche de ma veste début mai. Elle reprend, plus fort : « Plus que vingt minutes avant l’heure du déjeuner, madame Jellico. » Elle découpe soigneusement les syllabes, Jel-li-co, on dirait le nom d’une fabrique de gâteaux : Les tartes de Madame Wagner, Les cakes de Monsieur Kipling, les – quoi d’ailleurs – de Madame Jellico… En plus je n’ai même jamais été Mme Jellico ; je ne me suis jamais mariée, je n’ai pas d’enfants. Il n’y a qu’ici, dans cet endroit, qu’on m’appelle madame. Le vicaire m’a toujours appelée mademoiselle Jellico, depuis notre première rencontre. Le vicaire ! Je me rends compte tout à coup que ma main est vide, il est parti ; est-ce qu’il m’a dit au revoir ?
« Vingt ans », murmuré-je.
Le souvenir de la première fois que j’ai vu Cara m’étreint : un lutin pâle aux longues jambes. Je l’entends encore crier dehors, dans l’allée des calèches à Lyntons. J’avais cessé alors de découper la moquette de ma salle de bains et traversé le couloir étroit vers une des chambres vides en face de la mienne. Sous la fenêtre des combles, une gouttière en plomb bordée par un parapet en pierre débordait de feuilles mortes en décomposition, de petit bois et de restes de plumes d’anciens nids de pigeons. Tout en bas, Cara se tenait debout sur la fontaine asséchée au milieu de l’allée des calèches. La première chose que je remarquai fut sa masse de cheveux – elle paraissait presque solide, avec ses boucles foncées et serrées, sa raie au milieu, dissimulant en grande partie son visage dont on n’apercevait plus qu’un trait laiteux. Elle criait en italien. Je ne reconnaissais aucun mot ; le plus près que je me sois approchée de cette langue, c’est à travers les noms latins des plantes, dont la plupart se sont effacés aujourd’hui. Un essai : Cedrus… Cedrus… Cedrus libani, Cèdre du Liban.
Les pieds nus de Cara remuaient sur les cuisses de Cupidon, d’une main elle s’agrippait à la robe d’une femme en pierre comme si elle tentait de la lui arracher, et de l’autre elle tenait une paire de ballerines plates. Songeant aux dégâts supplémentaires qu’elle pourrait causer au marbre déjà blessé, écaillé, je grimaçai. Je conservais l’espoir que la fontaine fût l’œuvre de Canova ou de l’un de ses élèves, même si je n’avais pas encore eu l’occasion de l’examiner de près. Cara portait une longue robe en crochet, et, j’en étais certaine, même de si loin, pas de soutien-gorge. Le crépuscule s’installait de l’autre côté de la maison, son corps était plongé dans l’ombre, mais sa tête, basculée en arrière, les yeux vers le ciel, était diaphane. Je compris immédiatement qui elle était : fougueuse, piquante, envoûtante ; un cactus en fleur.
Je crus que ses cris s’adressaient à moi, là-haut dans les combles. Je n’ai jamais aimé le fracas, les insultes ; j’ai toujours préféré le calme des bibliothèques, à l’époque personne n’avait jamais élevé la voix sur moi, pas même Mère, c’était une chose inconnue, même si depuis, les choses ont bien changé. Mais avant que j’aie une chance de répondre, et Dieu seul sait ce que j’aurais pu trouver à dire, un châssis s’ouvrit dans une des majestueuses chambres de l’étage inférieur, d’où un homme sortit la tête et les épaules.
« Cara ! lança-t-il à la fille sur la fontaine, me renseignant sur son nom. Ne sois pas ridicule. Attends. » Il semblait épuisé.
Elle cria de plus belle, agitant les bras, lèvres mobiles et mains jointes, repoussant ses cheveux de ses épaules, inlassablement, puis elle sauta de la fontaine les pieds dans l’herbe haute. Elle a toujours été agile, Cara. Elle s’avança vers la maison, sortit de mon champ de vision. L’homme disparut à l’intérieur et je l’entendis cavaler à travers l’écho des pièces vides de Lyntons, j’imaginais la poussière s’envoler sur son passage et retomber dans les coins. De ma fenêtre, je le vis surgir par la grande porte, débouler dans l’allée des calèches juste au moment où Cara s’emparait d’une bicyclette et la poussait en trottinant derrière sur ce qui restait de graviers, tout en enfilant ses chaussures. En atteignant la route, elle rassembla les pans de sa robe et enfourcha la bicyclette telle une acrobate de cirque sautant sur un cheval en marche, chose dont j’aurais été incapable à l’époque, a fortiori aujourd’hui.
« Cara ! appela l’homme. Je t’en prie, reste. »
Nous la regardâmes, lui et moi, zigzaguer autour des nids-de-poule le long de la route bordée de tilleuls. Elle s’éloigna de nous en pédalant, lâcha la bicyclette d’une main et lança un doigt d’honneur en guise de réponse. Difficile de convoquer les émotions exactes déclenchées par ces premières images de Cara après tout ce qui s’est passé. J’étais sans doute choquée par son geste, mais je me plais à penser que j’étais excitée aussi à l’idée de me réinventer moi-même, à l’idée d’un nouveau champ des possibles, de l’été.
L’homme avança jusqu’au portail en fer rouillé haut de deux mètres cinquante et plaqua ses paumes contre les caractères coulés dans la ferronnerie, Lyntons 1806. Sa frustration m’intrigua : venais-je d’être témoin de la fin d’une histoire ou juste d’une querelle d’amoureux ?
L’homme devait avoir à peu près mon âge, dix ans de plus que Cara, des cheveux blonds dégringolant sur son front et une façon de se tenir comme si la gravité, ou le monde, l’avait vaincu. Séduisant, pensai-je, dans le genre déprimé. Il fourra les mains dans les poches de son jean et se retourna vers la maison, le regard posé droit sur ma fenêtre. Sans savoir pourquoi puisque j’avais toutes les raisons légitimes d’être là, je reculai dans la pièce et me recroquevillai sous le rebord de la fenêtre.
Lyntons. Rien que de penser à ce mot mes poils se hérissent, on dirait un chat qui aurait vu un fantôme. Mais l’assistante de l’aile… non, ce n’est pas ça… une nouvelle, une femme blanche, je ne la remets pas, elle porte un tablier blanc en plastique par-dessus son uniforme, me voyant bouche bée, en profite pour y fourrer une cuillerée de brocolis trop cuits. Je referme mes lèvres serrées l’une sur l’autre, tourne la tête, et laisse un autre souvenir, plus ancien, me gagner.