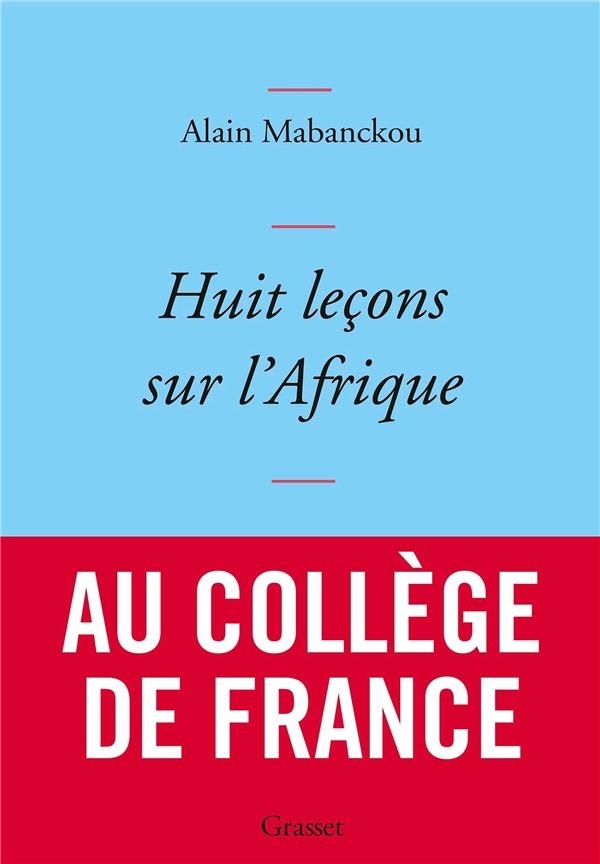Huit leçons sur l'Afrique
En 2016, Alain Mabanckou a occupé la Chaire de création artistique du Collège de France. C’était la première fois qu’un écrivain africain était amené à y enseigner la littérature et la culture si souvent dédaignées du « continent noir ».
Alain Mabanckou est l’héritier de l’histoire littéraire et intellectuelle de l’Afrique, qu’il retrace dans ces Huit leçons sur l’Afrique données au Collège de France. Croisant la stylistique et la vision politique, envisageant la littérature mais aussi le cinéma et la peinture, les Leçons d’Alain Mabanckou sont une nouvelle façon de visiter la francophonie, matière moins conventionnelle que son nom ne pourrait l’évoquer. La France n’est pas le seul centre de gravité de ce monde-langue. De « Y’a bon » à Aimé Césaire, la lutte a été longue pour passer « des ténèbres à la lumière », et c’est une vision apaisée des rapports de la culture africaine au monde que ces Huit leçons proposent.
Loin d’être en concurrence avec la culture française, la culture noire, d’Afrique, de Haïti ou d’Amérique, l’enrichit. « La négritude n’est pas essentiellement une affaire de Noirs entre les Noirs, mais une façon de reconsidérer notre humanisme. »
Le livre est enrichi d’un avant-propos inédit et de deux interventions d’Alain Mabanckou sur l’Afrique, dont sa fameuse lettre ouverte au président de la République sur la francophonie.
Extrait
VANT-PROPOS
Tout avait commencé en 2015 par un courriel d’Antoine Compagnon, titulaire de la chaire de Littérature française et moderne au Collège de France. Il m’apprenait que mon nom revenait depuis un certain temps au sein du Collège, qui souhaitait m’attribuer la chaire annuelle de Création artistique, une première pour un écrivain, soulignait-il.
Des paramètres liés à l’histoire littéraire du continent noir m’incitaient à franchir le Rubicon. En effet, à l’époque où j’étais encore étudiant à Paris, chaque fois que je passais devant les bâtiments du Collège de France, je ne pouvais pas ne pas songer au Congrès des écrivains et artistes noirs qui se déroula juste à côté, à la Sorbonne, en 1956. Pour moi, ce quartier du Ve arrondissement est toujours « habité » par la silhouette d’Alioune Diop qui organisa ce Congrès après avoir fondé la revue Présence Africaine (1947), puis une maison d’édition portant également le nom de Présence Africaine (1949), sise jusqu’à ce jour au 27 bis rue des Écoles, donc à quelques centaines de mètres seulement du Collège. Le Quartier latin était alors une véritable « Afrique intellectuelle » à Paris, le lieu exact de naissance et de légitimation de ce qu’on appelle désormais « la pensée noire ». Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Bernard Dadié, Cheikh Anta Diop, Amadou Hampâté Bâ, Léon-Gontran Damas, Jacques Rabemananjara et d’autres précurseurs du courant de la Négritude fréquentaient la librairie et les éditions Présence Africaine, de même que les intellectuels français, et non des moindres, qui soutenaient ce bouillonnement culturel du monde noir : Théodore Monod, André Gide, Jean-Paul Sartre, Georges Balandier, Michel Leiris ; mais aussi des personnalités venues d’autres espaces linguistiques, et je pense à Pablo Picasso, à Richard Wright, à James Baldwin, à Joséphine Baker, etc.
Malgré cette effervescence culturelle en plein cœur de Paris, l’Afrique demeurait absente au Collège de France. Absente vraiment ? Pas tout à fait, dans une certaine mesure, car il y avait du temps de l’Empire colonial français des chaires sur les « pays du Sud » – en réalité de l’espace colonial français à travers les quatre coins de la terre –, mais ces études mettaient plutôt l’accent sur l’Afrique du Nord, son histoire, la sociologie musulmane. Et, pour couronner le tout, elles étaient financées non pas par l’Éducation nationale française, mais par les institutions coloniales !
La chaire des Études comparées des sociétés africaines, occupée par l’ethnologue et anthropologue Françoise Héritier dans les années 1980, était une réelle avancée au regard du charisme et de la réputation intellectuelle de sa titulaire. Cet enseignement riche et passionné n’avait pourtant pas créé au sein du système éducatif français l’élan que nous espérions, celui qui aurait bousculé les esprits et hâté l’avènement des « études africaines » dans ce temple du savoir. Aux États-Unis où j’enseigne, elles existaient depuis bien longtemps, avec des chaires souvent confiées aux universitaires, écrivains et artistes africains ou d’ascendance africaine, tous formés dans les facultés françaises, une lancée qui s’est poursuivie avec la présence du Martiniquais Édouard Glissant (Louisiana State University et City University of New York), de la Guadeloupéenne Maryse Condé (Columbia University à New York), de l’Algérienne Assia Djebar (New York University), du Camerounais Achille Mbembe (Northwestern University à Chicago, University of California à Irvine, University of California à Berkeley, et University of the Witwatersrand en Afrique du Sud), du Sénégalais Souleymane Bachir Diagne (Columbia University à New York), du Djiboutien Abdourahman Waberi (Claremont McKenna College en Californie ; George Washington University à Washington DC), etc.
Je n’ai jamais pensé pour ma part que cette « absence africaine » était la preuve d’un grand complot du milieu universitaire français souvent houspillé à tort. Chaque chose arrive en son temps et, sans baisser les bras, il nous faut progressivement forcer les portes en expliquant comment le monde de demain sera celui de l’expression des voix qui n’ont pas été prises en compte dans le grand concert des civilisations. Ces voix qualifiées à tort de « lointaines » constituent les pièces manquantes qui nous permettraient de définir notre humanisme de la manière la plus diversifiée.
Je ne déduirais donc pas que l’Afrique n’existe pas dans le système éducatif français, il y a plutôt une frilosité lorsqu’il s’agit d’intégrer les questions liées à l’histoire de la colonisation, les études africaines étant encore considérées en France comme suspectes, réactionnaires, démagogiques, portant en elles la mauvaise réputation de contredire la « belle et glorieuse » histoire de la nation française qui ne devrait en aucun cas céder au « sanglot de l’homme blanc ».
Parler autrement de l’Afrique est de ce fait perçu comme une charge à l’encontre de l’ancienne puissance coloniale qui a écrit et enseigne sa version de la rencontre avec le continent noir et ne souhaite pas que quelques « agités du bocal » viennent raturer cette admirable épopée. La crainte de certains de ces réfractaires pourrait se résumer en ceci : les études africaines, les études postcoloniales sont dangereuses et nocives, elles mettent sans cesse l’Europe sur le banc des accusés. Ce qui est une aberration puisque ces études véhiculent le souffle de l’altérité, le refus d’une vision unilatérale, figée et arbitraire de notre passé commun, la nécessité de ne jamais escamoter les conquêtes, les heurts, les complicités, les divisions, les hypocrisies, les ingratitudes, les guerres, etc.
Souvenons-nous que le Collège de France existe depuis 1530 et qu’à l’époque de sa création l’Afrique n’était pas une zone perdue ou un espace de désordre comme on aura tendance à le clamer dans le dessein de justifier la cohorte des expéditions coloniales et leur prétendue mission civilisatrice ! Non, cette Afrique-là, dessinée grossièrement par l’Occident, est une Afrique fantasmée et hostile au discours contradictoire. Il suffit, pour s’en convaincre, de relire les livres de l’explorateur Olfert Dapper (1639-1689) un siècle après la fondation du Collège. Ce Néerlandais, spécialiste des « régions inconnues », donnait par exemple une description détaillée du royaume Kongo en Afrique centrale, avec sa hiérarchisation politique et son indéniable prestige intellectuel. En Afrique de l’Ouest, du côté de Tombouctou, l’on savait, par le diplomate-explorateur Hassan al-Wazzan (alias Léon l’Africain) et d’autres témoignages concordants, que la connaissance était présente.
Le XVIe siècle sera également le moment où s’amoncelleront les préjugés qui allaient faire de nous autres Africains des exclus. Pour le monde occidental, comme j’allais le rappeler dès ma première leçon, nous n’étions pas faits pour penser et, jusqu’à l’époque de la littérature coloniale écrite par les Européens, nous n’avions toujours pas la parole, l’Europe parlait en notre nom, nous réduisant dans un statut d’incapacité civique et intellectuelle qui n’allait être contesté qu’à partir de l’émergence d’une véritable littérature africaine, opposée à la littérature écrite sur l’Afrique par les Européens qualifiée également de littérature… africaine !
J’avais tout cela dans mon esprit en acceptant de compter parmi les membres du Collège de France. Si j’avais senti que je devais cet honneur à la couleur de ma peau, cela m’aurait davantage froissé que fait plaisir, et j’aurais décliné sans remords cette invitation. J’aimais plutôt me dire que c’était un écrivain qu’on sollicitait – et Antoine Compagnon insistera longuement là-dessus lors de son introduction pour me présenter. Par ailleurs, j’avais conscience que je ne venais pas en ces lieux dans le dessein de concurrencer les spécialistes de Charles Baudelaire, de Victor Hugo, de Marcel Proust et de bien d’autres auteurs qui ont marqué les lettres françaises. Le Collège ne m’avait rien imposé ou suggéré, il ignorait même le champ d’études que j’embrasserais et peut-être s’attendait-il qu’en ma qualité d’écrivain à qui on a confié la chaire de Création artistique, je puisse m’appesantir sur le « métier » de l’écriture, une sorte « d’atelier d’écriture » de prestige. Mais pourquoi serais-je entré directement dans la « technique » de l’écriture sans me soucier avant tout de mes « origines », celles puisées dans cette littérature africaine née du refus des canons imposés par les lettres européennes dans lesquelles l’Africain n’était qu’un comparse muet, rabaissé, escortant l’Européen dans ses équipées les plus exotiques et ne s’exprimant que par des onomatopées ? J’ai par conséquent proposé au Collège une introduction à l’écrit en français provenant de l’Afrique noire, espace vu de nos jours comme le théâtre des guerres ethniques, des dictatures, des républiques bananières malgré « les soleils des Indépendances » des années 1960 qui avaient sonné pourtant l’heure de l’émancipation de ces nouveaux États dont les frontières avaient été tracées par les anciennes puissances coloniales européennes lors de la fameuse Conférence de Berlin qui eut lieu entre le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885.
Mon objectif, formulé donc en toute indépendance, mariné dans mon for intérieur, avec la liberté que me confère l’Art, était clair et n’allait plus varier : combler un vide en posant un regard sur le parcours de ces littératures pour que puissent enfin résonner les noms d’écrivains majeurs reconnus ailleurs mais quasiment méconnus en France où ils ont pourtant été publiés dans la même langue et les mêmes maisons d’édition que leurs collègues français. L’angle de cette entreprise serait de démontrer comment le texte en français n’a pas qu’un seul centre de gravité, la France, qu’il est tentaculaire, avec une géographie dépassant le cadre étriqué du continent européen et couvrant de vastes espaces qui ne cessent de ravitailler le génie de l’imaginaire en français et de l’exporter à travers les cinq continents.
Ayant accepté ma charge, il me fallait à présent passer à l’étape suivante : commencer à écrire la leçon inaugurale. Celle-ci est ainsi la feuille de route, et peut-être, par bonheur, ce qui restera lorsqu’on aura tout oublié ! Je tenais à ce qu’elle reflétât ma personnalité – le je était donc nécessaire –, et je la considérais comme le prolongement de ma carte d’identité. La leçon prendrait bien sûr ancrage sur l’histoire littéraire et, dans cette optique, je rappellerais certaines idéologies sur la race, l’idée que l’Occident avait de l’Afrique à l’époque des explorations, des expéditions coloniales et comment, partant des conceptions les plus surannées, la littérature africaine d’expression française avait malgré cela pu éclore et donner naissance à ce qui était et demeure plus que jamais pour nous un héritage inaliénable : la conception de notre univers par nous-mêmes, les Africains.
Je me répétais sans relâche que je me garderais d’être un écrivain englué dans une sorte d’africanisme grégaire et qui arriverait au Collège avec une arme de destruction massive et une liste des atrocités que l’Occident avait perpétrées dans mon continent ! Au contraire, je serais aussi reconnaissant à l’égard des imaginaires venus d’autres lieux et qui m’avaient permis de m’ouvrir au monde, ce monde que je considère comme un langage, tout en ne perdant pas de vue le recours à la critique objective…
Cette première leçon étant vécue comme le moment le plus important de la chaire, la préparation n’était pas de tout repos entre les appréhensions, l’absence de sommeil à quelques jours de l’événement, les incertitudes permanentes nourries par le sentiment qu’une « maille rongée » pourrait brusquement « emporter tout l’ouvrage », comme dirait La Fontaine. J’étais dans l’état d’esprit de l’étudiant qui préparait un grand oral, avec des livres partout et des notes collées sur tous les murs !
Dans sa forme traditionnelle, la leçon inaugurale expose le sujet, s’ouvre aux questions qui vont être traitées tout au long de l’année dans un enseignement différent de celui de l’université, sans notation, avec des cours, des séminaires et des intervenants. C’est dans cet esprit que j’avais lu pendant des mois plusieurs de ces leçons et m’étais procuré les cours de différents professeurs dans des disciplines aussi variées que la théologie, l’anthropologie de la nature, l’histoire – avec notamment Ce que peut l’histoire1, la magnifique leçon inaugurale de Patrick Boucheron.
Il me fallait écrire la mienne, la dérouler devant un public dont j’ignorais la composition jusqu’avant mon entrée dans l’amphithéâtre Marguerite de Navarre. J’étais loin de penser que ce 17 mars 2016 plus de mille trois cents personnes se bousculeraient au portillon, que la presse (française et internationale) serait elle aussi au rendez-vous et qu’exceptionnellement la leçon serait diffusée par Radio France Internationale – ce qui permettrait aux Africains de la suivre en intégralité depuis le continent.
J’étais ému de constater que parmi les Africains et les personnes d’ascendance africaine, beaucoup poussaient pour la première fois la grille d’entrée du Collège de France, patientant durant des heures et des heures devant l’amphithéâtre Marguerite de Navarre où se dérouleraient mes cours et mes séminaires. Ils étaient là non pas uniquement pour manifester leur fierté de voir leur « frère », mais également pour saluer la présence des lettres du continent noir dans cette illustre enceinte. Pour eux, c’est l’Afrique qui entrait au Collège de France par la grande porte…
Cette présence de l’Afrique au Collège est à encourager, et je suis optimiste dans ce sens au regard de l’ouverture du corps professoral et de la réception exceptionnelle que m’avait réservée le public et la presse française durant mes cours. C’est donc avec un immense plaisir que je propose ici mes huit leçons qu’il faudra parcourir comme une invitation au dialogue en vue d’une relecture apaisée et courtoise de notre passé commun. Ce n’est qu’à ce prix que notre présent ne sera plus enchaîné par les préjugés, et notre avenir pollué par les discours des éternels marchands de chimères. En fin de volume j’ai souhaité rajouter deux documents : ma lettre ouverte au président de la République française au sujet de la francophonie et mon allocution à Reims, à l’invitation du chef de l’État français en vue de célébrer la mémoire des tirailleurs africains qui ont combattu pour la France. Ces deux textes sont de près ou de loin un prolongement de mon passage au Collège de France.
Los Angeles, le 30 mai 2019.