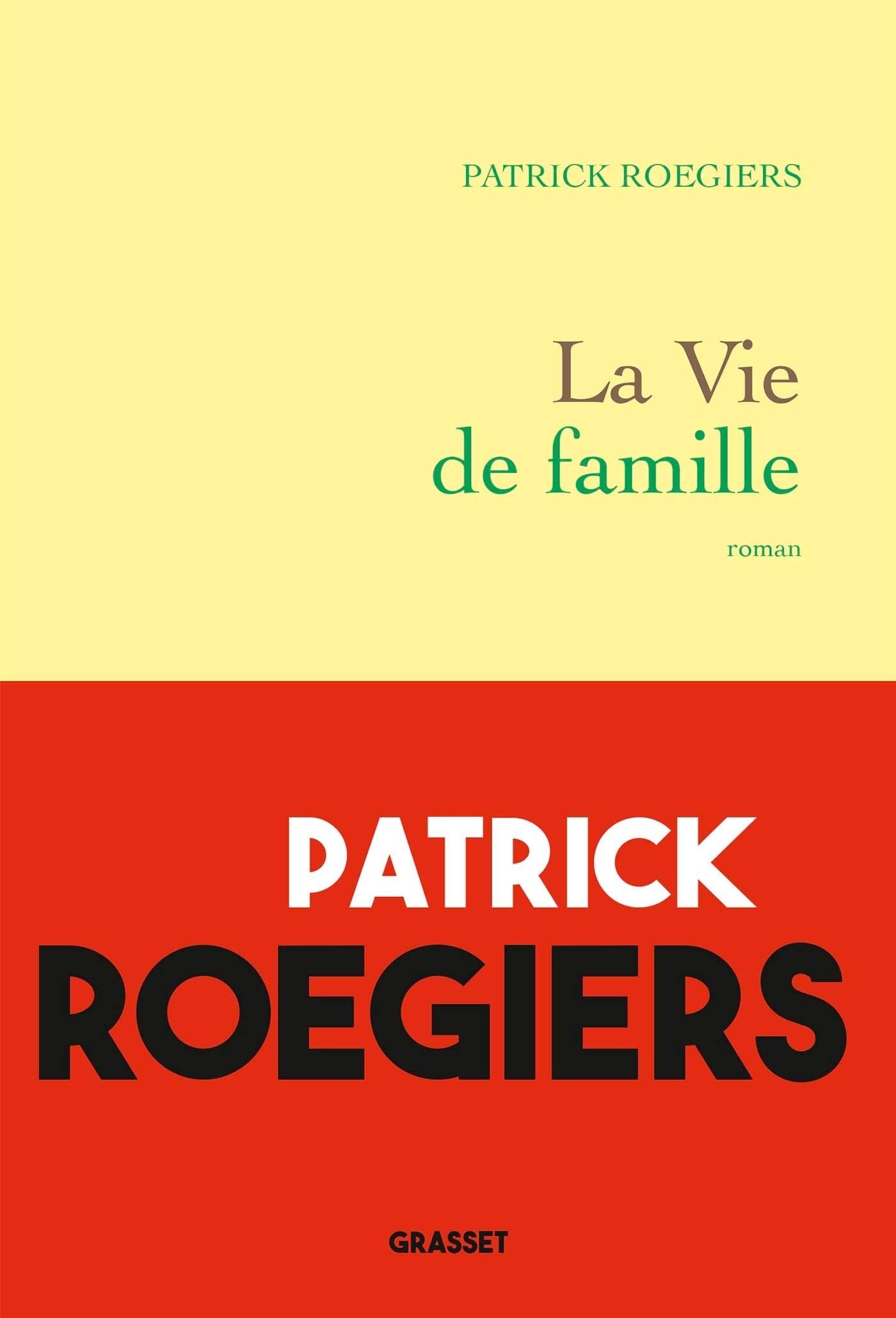La vie de famille
« Lorsque j’ai été mis à la porte de chez mes parents le jour de mes vingt ans, vendredi 22 septembre 1967, j’aurais dû comme Salvador Dali dans la même situation me raser le crâne et placer un oursin sur le dessus de ma tête, à l’instar de Guillaume Tell posant une pomme sur le front de son fils … »
Dans ce livre incisif et percutant, allègrement écrit, après avoir attendu longtemps, avec beaucoup d’amusement et une grande sincérité, Patrick Roegiers parle pour la première fois de lui-même, de ses parents, de sa famille, de son éducation, des fracas de son adolescence et des tumultes de son enfance. Sans nostalgie mais non sans émotion, il raconte son histoire comme il l’a vécue et, surtout, telle que la reconstitue et la ressent inconsciemment la mémoire. Le portrait de sa mère, Gorgone moderne, Médée vengeresse, chargée d’une lourde hérédité et agonisant sa progéniture, est plus que saisissant. Le souvenir n'est pas le pardon. Le passé n’est jamais mort. C’est un fantasme du présent.
Extrait
À la porte
Lorsque j’ai été mis à la porte de chez mes parents le jour de mes vingt ans, le vendredi 22 septembre 1967, j’aurais dû comme Salvador Dalí dans la même situation me raser le crâne et placer un oursin sur le dessus de ma tête, à l’instar de Guillaume Tell posant une pomme sur le front de son fils. Penché sur la balustrade, au sommet de l’immeuble banal et sans charme de la rue du Départ, je vois la voiture balisée qui contourne le rond-point du Repère et se gare devant l’entrée, à midi pile. Trois agents en uniforme en descendent, jettent un œil vers le firmament, aussi magnifiquement bleu qu’un ciel de Cézanne, et frappent trois coups à la porte de ma chambre comme on le fait au théâtre avant que ne se lève le rideau. Ce ne sont pas des policiers comme on en voit dans les films comiques français mais de vrais flics, au physique de shérif, avec une étoile dorée qui brille sur le côté gauche de la poitrine, un revolver dans une gaine de cuir noir qui pend au ceinturon astiqué cachant mal leurs bourrelets adipeux et un képi sur la tête. Ils ont l’air étonnés de se trouver face à un jeune homme bien élevé, d’aspect sympathique, qui ne présente aucun danger pour l’ordre public et n’a pas commis d’infraction ni perpétré de crime. Ils réclament mes papiers et me font décliner mon identité comme il est de mise lors d’un excès de vitesse ou d’un accident de la circulation où l’on dresse un constat. Tout est en ordre. Les agents, chargés de veiller au respect de la loi, qui ne jouent pas les gros bras mais ont la tête de l’emploi, prennent leur mal en patience et, comme rien ne se passe, s’agacent d’avoir été dérangés pour des prunes et finissent par se demander s’il ne s’agit pas d’une mauvaise plaisanterie.
Et les voilà qui se pointent tous les deux, l’un après l’autre, leurs têtes émergeant peu à peu, lui devant, elle légèrement en retrait. Grimpant l’escalier, ils débouchent sur le palier face aux flics qu’ils ont convoqués, elle dans une robe bariolée, aux couleurs criardes, lui en veston croisé brun (sa teinte préférée), la chemise boutonnée jusqu’au cou, la glotte étranglée par une cravate beige à lignes diagonales, avec une pochette de soie bistre sur laquelle se détachent des chevaux de course sautant une haie, les jockeys aux tenues chamarrées cravachant leurs pur-sang lancés à vive allure et galopant en projetant sous leurs sabots des mottes de terre meule. Ils n’en mènent pas large et ne sont pas fiers d’apparaître comme deux imbéciles. Faussement dignes et souriants, gênés aux entournures, ils font mine de ne pas être au courant. Ils ignorent ce qui se passe et demandent hypocritement ce qu’ils font là. La lâcheté de l’un n’excusant pas l’ignominie de l’autre, ils saluent les agents interloqués qui les fixent comme on se voit dans un miroir, surpris de la conduite de ce couple d’honnêtes citoyens qui semblent tout ignorer de la situation, alors que ce sont eux qui les ont appelés. « Allô, la police ? Pouvez-vous venir ? Non, ce n’est pas un cambriolage ou un hold-up. C’est plus simple que cela. Il s’agit de flanquer notre fils à la porte. C’est son anniversaire. Tout juste vingt ans. C’est une surprise. Un beau cadeau. Non, il n’est pas dangereux. À tout de suite. Merci. » Je les dévisage tous les deux pendant une minute sans mot dire. Des paroles crues saillent en silence de ma bouche. L’envie me prend de les pousser dans l’escalier, qu’ils le dévalent cul par-dessus tête, s’entraînant l’un l’autre dans une chute irrémédiable, se fracassant le crâne et le dos et finissant au milieu des flammes et des charbons ardents dans les profondeurs de l’enfer où s’agitent les damnés de la terre. Un des agents, rouge comme un rosbif, au menton à double étage, s’interpose et nous sépare du bras, aussi gros qu’un tronc d’arbre. Le recours à l’autorité est le refuge des faibles. L’ordre règne sur le palier. Une boule de salive s’agglutine au levier de ma langue et quand elle est assez dense, aussi ronde qu’une goutte lors d’un orage qui s’abat subitement, je l’expédie de toute la force de mes lèvres et toise le glaviot visqueux, grêle purulente, graillon gluant, pulsé à la vitesse de l’éclair qui coule doucement telle une larme amère sur la figure de mon père. L’un des flics, solide comme un roc, demande alors ce qu’il faut faire. Il n’y a rien à me reprocher. Mon seul délit est d’être le fils de mes parents. J’ai beau chercher, il n’y a pas d’autre raison à ce forfait inexplicable. Mon père en s’essuyant du revers de la main consulte ma mère qui déclare froidement :
— Foutez-le dehors. Il se débrouillera tout seul.
Allez, ouste ! Du balai, hors d’ici. Place nette. Chargés d’expulser ce fils maudit, ce paria, ce renégat, ce bon à rien, ce parasite, ce rejeton mal-aimé, rejeté, honni à vie, qui n’a plus sa place ici, qu’il dégage au plus vite, qu’il débarrasse le plancher, ici ne remette jamais les pieds, les policiers ne savent quelle attitude adopter ni sur quel pied danser, et, plutôt que de me jeter dans un cachot comme un escroc, un bandit de grands chemins ou un brigand qui dévalise une banque, ils me font signe de circuler. Je n’en demande pas plus, jette deux ou trois affaires dans un sac, lance un dernier coup d’œil à mon père, cet homme lamentable – le flic familial, le dégonflé parental, le « poulet » dominical – qui a donné son fils aux gardiens de l’ordre pour que la paix règne chez lui, avec la bénédiction de ma mère que je fixe dans les yeux, mais qui détourne le regard, feint de regarder ailleurs, comme sur toutes les photos, et descends à mon rythme les escaliers, posant calmement le plat du pied sur chaque marche. Prendre l’ascenseur serait une fuite insupportable. Ce n’est qu’un début. Je suis libre comme l’air et me retrouve dans la rue, bordée d’immeubles d’habitation quelconques et de maisons avec des jardinets. Je marche seul, absolument seul, à grandes foulées égales vers le square des Quatre Vents, sans me retourner ni savoir où je vais, en me disant que jamais, au grand jamais, je ne reviendrai sur mes pas.
Pour tout bagage on a vingt ans
On a l’expérience des parents
Ce jour-là, j’ai compris qu’il ne me faudrait compter que sur moi et qu’on me mettrait toujours à la porte. À la porte de ma famille, qui a instantanément cessé d’exister, à la porte de mon théâtre, qui était toute ma vie, à la porte de ma ville natale, où je suis désormais un étranger, à la porte de mon pays, que je pensais ne jamais quitter, à la porte de ma vie, qui m’appartient et qui commence à peine, à la porte de mes amis, que j’ai tant semés que je n’en ai plus, à la porte de mes ennemis, triés sur le volet, à la porte du succès, que j’ai moins côtoyé que je ne le désirais, à la porte de la chance, qui m’a parfois souri, à la porte de l’enfance, bel et bien finie, à la porte du présent, qui m’incite à gagner mon salut, à la porte de l’avenir, qui reste à inventer et qui me tend les bras, à la porte des boîtes de nuit, où j’ai mes entrées et qui m’ont accueilli quand je ne savais où aller, à la porte du paradis, où je ne me suis pas présenté, à La Porte de l’Enfer, inspirée par Dante à Rodin, qui traite des tourments de l’âme et du corps, à la porte du destin, qu’il faut savoir forcer, et si cela ne suffit pas, je m’en chargerai en personne et, me prenant par le cou, je me mettrai à la porte de moi-même. On croit que j’exagère, fais le malin ou tente d’attirer l’attention sur moi. Tout ce qui arrive advient sous forme de récit. Je n’invente rien. Ne raconte pas d’histoires. Cela s’est vraiment passé ainsi. Tout avait bien commencé. J’aimais sincèrement mes parents et j’étais un bon fils.