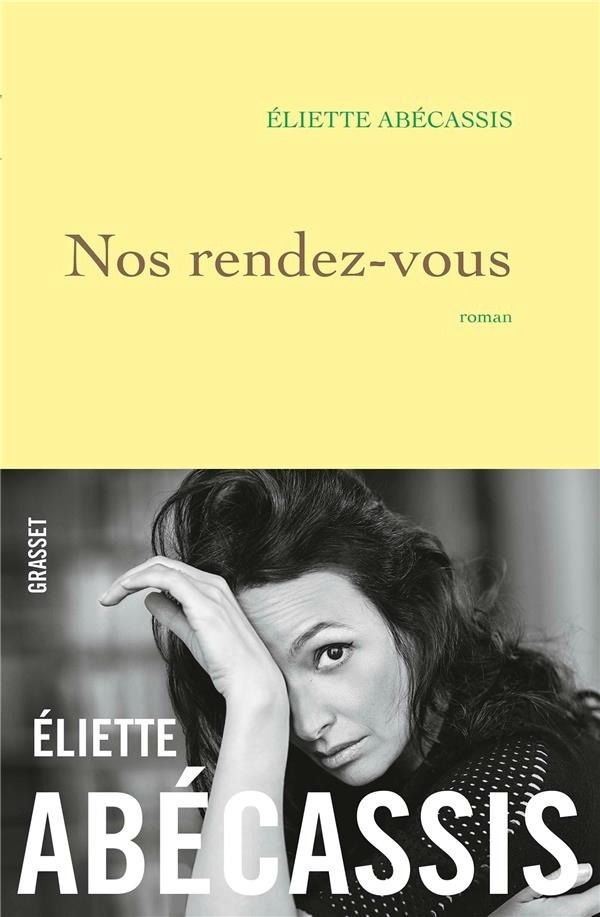Nos rendez-vous
Ce roman d’une passion d’amour contrariée est aussi le roman d’une époque.
Amélie et Vincent se rencontrent, jeunes, à la Sorbonne à la fin des années 80. Chacun ressent un coup de foudre sans oser l’avouer à l’autre : aucun des deux ne se sent « à la hauteur », aucun ne fait le premier pas, aucun n’a la maturité de saisir son bonheur…
Ils se donnent rendez-vous, la jeune femme est en retard : A quelques minutes près, ce jour-là, ce n’est pas un simple rendez-vous qu’elle rate, c’est sa vie.
Puis la vie prend le dessus, les emporte malgré eux vers des destins qu’ils ne maîtrisent plus, leur fait prendre des bifurcations comme on emprunte des portes, puis des couloirs, de dix ans, de vingt ans, de trente ans…
On suit en parallèle la trajectoire intime et professionnelle d'Amélie et de Vincent, et chaque fois que les hasards de l’existence les remettent en présence, ce n’est pas « le bon moment ».
« Trente ans que nous nous connaissons… Des mariages, des divorces, des deuils, des enfants, des centaines de voyages, parfois au bout du monde, des succès, des échecs, des espérances déçues, des rêves d’enfance perdus, des enfances déchues…Trente ans de rêves et de désir ».
Extrait
Ce fut un long couloir, à Paris, à l’université de la Sorbonne, un échange de regards. Ils étaient là, simplement, dans la même file d’attente, devant le secrétariat. Deux personnes qui discutent ensemble, de tout, de rien, comme cela se produit des milliers de fois dans une vie.
Vêtue de couleurs sombres, avec une frange, des lunettes et du khôl sous les yeux, elle sortait tout droit de l’adolescence et d’un escalier qui montait du rez-de-chaussée, avec sa meilleure amie, Clara, en rouge et noir, à moitié dissimulée par un chapeau plus grand qu’elle, et trois autres compagnons, tous étudiants à la Sorbonne. Ils partageaient la même vision de la vie et un grand appartement avec d’autres colocataires, dont un jeune homme qui parlait une langue indéfinissable, grec, croate ou suisse allemand, et qui vivait avec eux depuis des mois, sans que personne sache vraiment d’où il venait ni ce qu’il faisait là. En plein cœur du Quartier latin, c’était une sorte de squat où ils donnaient des fêtes sagement alcoolisées, et où traînaient le soir des cadavres de poulet et des restes de bouteilles, à moins que ce ne soit l’inverse. Ils s’étaient rencontrés, tous les cinq, en militant à SOS-Racisme. Ils avaient défilé pour Malik Oussekine, martyr des manifestations contre la loi Devaquet, et ils se retrouvaient, le soir, à distribuer des tracts et à lutter, ils ne savaient pas très bien pourquoi, sinon pour étancher leur soif d’engagement.
Lui, arrivé de Saint-Germain, avec son gilet sur sa chemise blanche, ses lunettes rondes et ses cheveux bouclés, un rien dandy, un rien parisien, s’inscrivait en licence d’économie. Il était poli, timide et socialiste, ayant accueilli l’élection de Mitterrand avec une grande joie. Son ami Charles l’accompagnait : il venait de Corse, avait l’air sombre, les sourcils froncés et un sourire complice. Ils s’étaient rencontrés sur les bancs de la fac, et ils militaient ensemble contre l’extrême droite.
Après l’inscription, la troupe d’étudiants se rendit place de la Sorbonne, pour prendre un café. Ils poursuivirent leur conversation, sur tout et rien, ce qu’ils faisaient, et ce qu’ils rêvaient d’accomplir. Ils finirent par se présenter. Elle s’appelait Amélie, et lui Vincent. Elle, issue d’une famille de la région normande, était en Lettres et se destinait à l’enseignement. Brune, les yeux cernés, ouverts sur le monde, comme étonnés d’en découvrir la couleur, le corps chétif, mince, le sourire timide, elle était enfant encore, à peine femme. Elle se demanda s’il allait lui donner son numéro de téléphone, s’il désirait l’appeler, si elle lui plaisait comme il lui plaisait. S’il valait mieux le montrer ou le cacher, le taire tout à fait. Si elle était assez belle, ou s’il y avait un défaut rédhibitoire, quelque chose en elle qui ne lui conviendrait pas, son nez trop grand, ses pommettes trop hautes, ses cheveux mal coupés, son allure pas trop féminine. Elle fut impressionnée par sa façon de parler, sa mèche sur les yeux, son assurance, la beauté de son visage, l’intensité de son regard, sa voix chaude, profonde et pourtant fine, subtile. Un caractère affirmé mais doux, il était poli et bien éduqué, un peu distant mais sympathique. Un zeste de fantaisie, comme une folie douce. On le sentait parfois ailleurs, dilettante, rêveur. Il faisait de la musique, du piano, c’était ce qu’il aimait par-dessus tout.
Puis ils ont marché dans Paris, comme des touristes. Ils ont traversé le pont, se sont rendus sur l’île Saint-Louis, ont admiré la Seine sous un soleil couchant, se sont assis sur les quais, et se sont raconté leur vie. Vincent, au milieu du groupe, était impressionné. De la voir ainsi, devant lui, si étrange, timide et captivante. Elle, un air innocent et malicieux à la fois. Il se dit qu’il avait rencontré quelqu’un d’intéressant, de profond, de cultivé, et qui semblait le comprendre, avec qui il pourrait parler. Elle était charmante et bizarre, un peu triste, comme perdue dans la ville. Était-il possible qu’elle s’intéressât à quelqu’un comme lui ? Elle semblait inabordable. Et pourtant elle était là, à côté de lui, et ils parlaient.
Elle, avec ses vêtements sombres, mal dans sa peau, quoi qu’elle porte, quoi qu’elle fasse, quoi qu’elle dise, s’exprimait souvent dans une confusion due à sa timidité et la mauvaise image qu’elle avait d’elle-même. Sa mère lui avait dit : « Quand on a ton physique, ma fille, il vaut mieux compenser par l’intellect. » Peut-être l’intriguait-elle ? Elle n’osait y croire. Il était séduisant, avec sa balafre sur la joue gauche, qui faisait penser à Robert Hossein dans Angélique, marquise des anges, nimbé de parfum, entouré de filles ce type-là ! Un air hiératique, et une façon de regarder qui la clouait sur place. Un charme émanait de son regard, et de sa voix profonde, presque caressante, il lui demanda ce qu’elle faisait. Elle se mit à bégayer, elle étudiait, et pour gagner sa vie, elle donnait des cours, elle écrivait à ses heures perdues, elle aimait l’art, la peinture, la sculpture, elle courait au jardin du Luxembourg, avec un walkman. Et lui, était-il parisien ? Montmartre, la colline et ses vignes, un grand appartement, des parents commerçants, ils ne comprenaient rien à ce qu’il voulait, ce qu’il aimait, la musique. Il avait eu un professeur dans sa jeunesse, un voisin qui enseignait au conservatoire dans le 17e à Paris et lui avait transmis la passion du piano.
Elle, élevée dans le rigorisme d’une éducation provinciale, menait une vie rangée. Son père, directeur d’école, ne la laissait pas sortir. Adolescente, elle n’avait pas le droit de se rendre dans les bars, ni dans des boums – que ses parents appelaient « surboums », mot issu de la période yé-yé qu’ils n’avaient pourtant pas vraiment connue –, ni de recevoir des amis du sexe opposé. Née en 1968 pourtant, il semblait que la libération de la femme n’avait pas eu lieu chez elle, ni même effleuré le foyer parental, de près ou de loin. Lectrice de Simone de Beauvoir, qui était devenue son modèle, son idéal, elle s’était juré qu’un jour elle existerait à part entière. Elle se réfugiait dans les livres, pour s’y retrouver dans un miroir et fuir le réel.
Or, ce soir-là, il faisait beau sur la ville déjà envahie par la torpeur estivale. Les gens marchaient d’un pas nonchalant sur les quais, devant les cafés. Des vieux, des jeunes, des enfants, des femmes, des hommes, des amoureux. Des couples, assis sur des bancs. Des rues qui menaient jusque dans le Marais, où boulangeries et restaurants vendaient des falafels et des shawarmas, à même le trottoir, dans un joyeux brouhaha.
Puis lorsque les autres décidèrent de rentrer chez eux, il lui proposa de prendre un café. Pourquoi pas. Ils avaient le temps. Ils restèrent à discuter, sur le pont, se promenèrent encore, s’arrêtèrent chez un bouquiniste, devant un étal sur les quais de Seine. On y trouvait, pour trois francs six sous, des livres d’amour, des thrillers, des romans de gare, à l’eau de rose, à tiroirs, haletants, nouveaux, anciens, futuristes, des manuels, des essais, des livres de psychologie ou de philosophie, d’Histoire ou d’histoires, et même des recueils de poésie.
C’était le temps où les gens lisaient, dans les métros, les rues, les plages et les lits, les salles de bains et les cuisines, les gens apportaient des livres dans les parcs, les jardins, les piscines, les salles d’attente, les bus, les trains, les avions, ils lisaient dans les fauteuils, les canapés, les salons, les hôtels, les cafés et les bars, les villes et les villages, l’été comme l’hiver, le soir ou le matin, en mangeant, en se couchant, en se levant, avec une tasse de thé ou un verre de vin, au coin du feu, lorsque le jour déclinait : les gens lisaient partout, à chaque moment de leur journée, à chaque heure de la vie, pour se raconter une autre histoire, pour fuir le réel ou le vivre plus intensément, pour comprendre les hommes ou pour les détester, ou simplement pour passer le temps. Tous les vendredis soir, Amélie regardait l’émission « Apostrophes », où Bernard Pivot interrogeait les auteurs avec une passion réelle, Roland Barthes ou Françoise Sagan, Albert Cohen, Truffaut, Jankélévitch, Le Roy Ladurie ou Duby, tous avec la cravate, sauf BHL. Vincent préférait Michel Polac qui, au milieu d’un nuage de fumée, alimentait les débats autour de Charlie Hebdo, de Minute et de Harakiri, et Serge Gainsbourg disait « merde » avec ses lunettes noires et Pierre Desproges dissertait sur l’intelligence des sportifs devant Guy Drut.