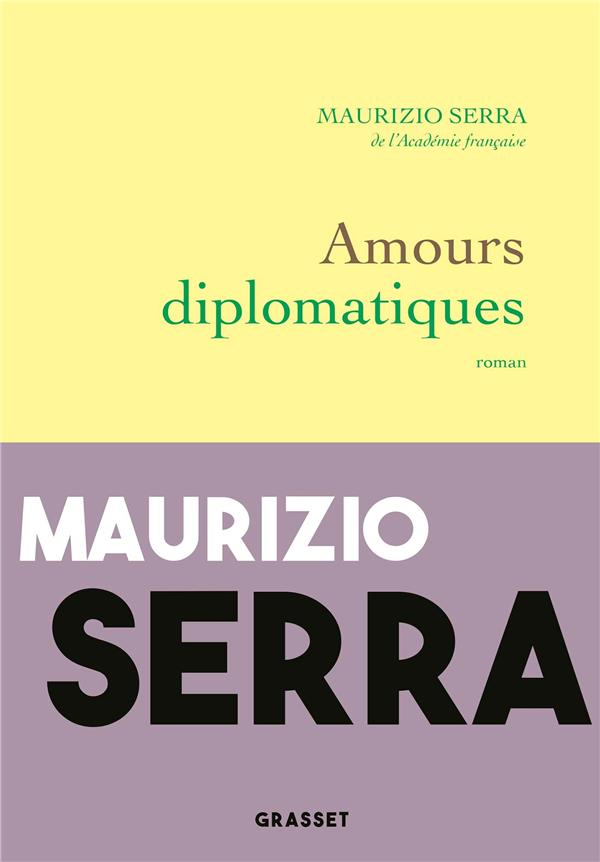Amours diplomatiques
Un ambassadeur exilé d’un lointain pays en proie à la guerre civile revit les espoirs et les illusions d’une existence balayée par l’histoire, comme son grand amour d’antan. Un attaché culturel japonais poursuit la femme de ses rêves, de Rome à la veille de la guerre jusqu’à Tokyo vingt ans plus tard et à Denver de nos jours. Une belle femme alcoolique conduit son Alfa Romeo le long du lac de Genève, en quête de l’homme de sa vie qui vient de s’éteindre- ce qu’elle feint d’ignorer.
Trois histoires éblouissantes et drôles, qui composent un seul roman, empreint d’une mélancolie glaçante et d’une parodie douloureuse.
Premier roman
Extrait
Serait-il vain de l’évoquer dans les circonstances actuelles ? Je descends en ligne directe de la principale dynastie politique du Michoumistan, qui s’est incarnée, jusqu’aux désastres présents, dans le parti des Justes longtemps majoritaire au Parlement, garant de l’unité nationale. La redingote, le col empesé, le regard à la fois glacial et compatissant, la main velue de mon arrière-grand-père, posée comme un bien de famille sur la première (et unique) constitution, en 1880, figurent, ou mieux figuraient, dans tous les lieux publics, y compris les bordels et les pissotières, reproduits sur des dizaines de milliers de photos officielles, peinturlurés par les artisans sur les statuettes, les vases et les plats de faïence qui égayaient nos marchés jadis si pittoresques, avant l’arrivée de la pacotille plastifiée, qui a envahi même ce coin reculé du monde. De la saison démocratique du pays, la meilleure malgré tout de son histoire millénaire, il reste encore quelques timbres-poste prisés par les philatélistes, à défaut d’institutions plus solides. Madrés, âpres au gain, imbus de leur rang et de leur sang, mes ancêtres identifiaient l’avenir du Michoumistan avec leurs privilèges, mais y croyaient quand même. Ils ont illustré, à chaque génération, avec panache et astuce, leur dévouement à la nation, non désintéressé certes, mais foncièrement sincère, jusqu’à mon père, homme agréable sans plus, qui n’avait pas la carrure des aïeux. Il ne s’était montré ferme que dans le choix d’une épouse, qui s’avéra mauvais pour lui. Et pour moi, en conséquence.
Notre clan, installé au centre du pays, avait dû s’associer par des liens habilement tissés, en proportions soigneusement établies, à la puissante peuplade côtière des Zeughides au sud et à celle montagnarde, non moins redoutable, des Lakhbadiens au nord : alliances indispensables pour conserver un semblant de stabilité et de paix à notre inquiète patrie. Or, mon père ramena de ses années d’études à la Sorbonne un modeste diplôme et une jeune fille d’origine inconnue, sinon aventureuse, d’une beauté tapageuse, française de surcroît, prénommée Fanny : tout ce qu’il fallait pour provoquer, chez nous, la réprobation des hommes et la jalousie des femmes. Le milieu où mes compatriotes s’ébrouent les rend peu propices aux nouveautés, qu’ils prennent volontiers pour des offenses. Comme en plus, Fanny refusait de se conformer aux usages locaux et de revêtir les robes traditionnelles des dames de sa condition, la froideur qui l’avait accueillie à son arrivée se mua rapidement en franche hostilité. Tout lui fut imputé à crime, même des faux pas qu’on aurait ignorés si elle avait agi avec plus de discrétion. Elle riait trop en public, après trois ou quatre coupes de champagne, s’entourant d’une cour d’obligés à la renommée douteuse, choisis de préférence parmi les étrangers qui exploitaient les ressources du pays. Suprême outrage, elle ne baissait jamais le regard devant celui des mâles, y compris nos patriarches, sorciers et devins, pour la plupart, il est vrai, aveugles de naissance. Le scandale éclata le jour où, dégrafant son maillot de bain sur une plage réputée déserte, elle fut poursuivie par une horde en rut. Fanny l’avait probablement fait exprès pour précipiter un nouveau départ. Le conseil des anciens se réunit et exigea de mon père qu’il répudie l’étrangère, qu’on aurait expulsée hors frontière sous garde sûre. Il regimba, menaça de partir lui aussi, avec elle et pour toujours, ce qui, vu sa position haut placée, aurait eu un effet défavorable sur les fortunes du clan et du parti des Justes, les deux entités n’en formant pratiquement qu’une. Il fut alors décidé qu’il renoncerait, dans l’immédiat, à poursuivre la carrière parlementaire déjà tracée pour lui comme pour tous les membres de la branche aînée, de peur de créer d’autres frictions avec une population encore plus austère que ses chefs. Le couple fut envoyé, avec beaucoup d’égards, dans un poste consulaire au Canada, où je naquis.
La période qui suivit fut, au début tout au moins, la plus sereine de notre vie familiale et les vagues souvenirs que j’en garde semblent le confirmer. Dans quelques vieux films amateurs tournés en format Super8, on me voit gambader entre mes parents, poupon blond et dodu, au bord de la clairière qui délimitait notre résidence d’été. Ce décor apaisant, qui lui rappelait avec nostalgie la patrie lointaine, revigorait le consul, dont les journées étaient accaparées par des concessions de visas, des enregistrements de biens et des procédures d’héritage, tâches dont il s’acquittait consciencieusement, sans y prendre le moindre intérêt. Timide, réfractaire à la vie sociale, il retrouvait un simple bonheur le soir, dans la paix du foyer et sa collection de timbres. Ma mère, elle, s’ennuyait ferme et ses nostalgies étaient sans doute d’une autre nature, vu qu’un jour, elle courut renouer avec sa vie d’antan. Ne sachant la retenir, il décida de garder l’enfant, dans l’espoir que cela l’aurait fait revenir sur ses pas. Si elle en avait jamais eu l’intention, ce dont je ne suis pas sûr, maman n’eut pas le temps de rebrousser chemin. Quelques semaines plus tard, elle s’abîma en voiture, enlacée à un play-boy uruguayen, dans la baie de Vancouver. Je garde le regret de ses cheveux de miel, de caresses distraites et d’une berceuse où il était question de mon bijou, mon chou, mon pou / viens vite sur mes genoux… : ou serait-ce genous ? J’ai toujours éprouvé une certaine difficulté avec le pluriel des noms communs. Et le français n’a pas été pour moi, on s’en doutera, une langue de prédilection, quoique je l’aie beaucoup pratiqué dans ma vie professionnelle.
Cette tragédie mit un terme à notre séjour canadien, en même temps qu’à mon enfance. Mon père obtint de regagner le Michoumistan, du fait que l’obstacle majeur à son retour s’était, pour ainsi dire, dissous. Repentant et désillusionné, il laissa désormais à d’autres, plus volontaires, le droit de prendre en main les rênes de son existence. Un cousin, qui était déjà ministre, le nomma dans son cabinet. Il acheta sur l’injonction du clan des terres rocailleuses en Lakhbadie, dans le but d’y perdre beaucoup d’argent, ce qui témoignerait de son attachement à cette région arriérée, toujours sur le point de se révolter contre le pouvoir central. Enfin, il épousa en secondes noces une héritière zeughide, choisie par le conseil des anciens, qui se mit avec entrain à lui faire d’autres enfants. Il perdit peu à peu l’attachement contrit qu’il me témoignait. Nous habitions maintenant une vaste demeure sans joie (pour moi, en tout cas) au cœur d’une plantation latifundiaire au sud de la capitale, entourés d’une masse de paysans résignés à leur sort, car s’ils crevaient de faim, ou presque, ils avaient au moins la consolation de vivre – et de mourir – dans une démocratie populaire, la seule de cette région agitée.