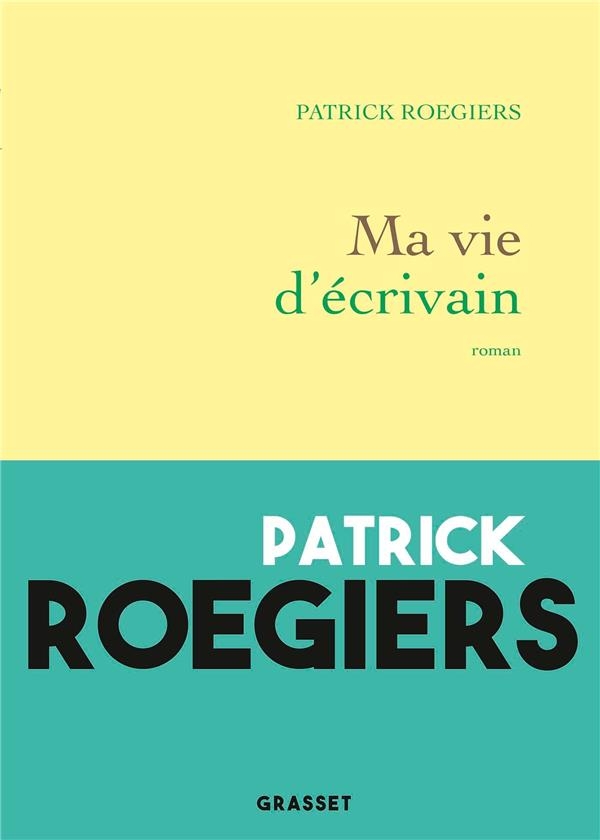Ma vie d'écrivain
En 1983, Patrick Roegiers s’établit à Paris pour devenir écrivain. Personne ne l’attend.
Installé dans la maison de Saint-Maur, d’où sortent tous ses livres, il conte avec humour ses premiers pas dans l’édition. Le bonheur en famille se conjugue avec des coups de théâtre, des incidents tragi-comiques ou carrément burlesques, qui émaillent l’existence de celui qui construit son œuvre au fil de la plume, sans quasiment sortir de son bureau, alors que le monde tourne autour de lui.
Voyages et vacances au bord de la mer, rencontres inattendues, portraits émouvants d’artistes, auteurs, acteurs, chanteurs, éditeurs ou cinéastes admirés.
Portée par une écriture enthousiaste, une éblouissante déclaration d’amour à la France.
Cet hymne à la création crépite comme un feu d’artifice apollinien.
Extrait
Paris vaut le déplacement, déclare Ernest Hemingway, dont le deuxième fils comme moi s’appelle Patrick. Paris est la capitale de la France. Paris n’est pas loin. Paris est un monde. Paris est le centre du monde. Paris contient toutes les villes du monde. Paris, la ville idéale, tient autant de la réalité que du rêve. Ah, la magie de Paris. À Paris, tout est comme on l’imagine. C’est à Paris qu’il faut vivre. À Paris, le ciel est moins pesant qu’ailleurs. À Paris, se bousculent les talents. Paris n’appartient à personne, mais à tout le monde. « Paris est tout petit, c’est là sa vraie grandeur », dit Jacques Prévert, le voisin de Boris Vian qui s’installe en 1953 6 bis cité Véron (quarante mètres carrés), avec accès sur la terrasse dominant les ailes du Moulin-Rouge. Lorsqu’on écrit en français, et qu’on rêve d’être publié, il est normal de venir vivre à Paris. On écrit d’abondance à Paris. À Paris, on vient se faire un nom. À Paris, tout n’est que littérature. Oui, on est bien à Paris. Paris me sourit, j’entends Léo Ferré, mon chanteur préféré, qui chante :
Paname
On t’a chanté sur tous les tons
Y’a plein d’parol’s dans tes chansons
Comment ne pas aimer cette ville ? Il y a des plaques sur les façades des maisons où vivent les écrivains. Arthur Adamov séjourne longtemps à l’hôtel Taranne, 53 boulevard Saint-Germain, à deux pas de la statue de Diderot. Apollinaire au 202 du même boulevard, au dernier étage. Marguerite Duras vit 5 rue Saint-Benoît, troisième étage (gauche), rue perpendiculaire au Flore, 122 boulevard Saint-Germain (plutôt de gauche) et à la librairie La Hune qui fait le coin. Jacques Lacan demeure au 5 rue de Lille. Caméléon des lettres, Romain Gary habite 108 rue du Bac, au deuxième étage. Valery Larbaud réside 71 rue du Cardinal-Lemoine, à deux pas de la place de la Contrescarpe, derrière le Panthéon, où James Joyce finit d’écrire Ulysse, en 1921, dans son étroit logement situé au premier. Samuel Beckett, son compatriote, occupe 38 boulevard Saint-Jacques un appartement de trois pièces, au septième étage, de sa cuisine il voit les détenus de la Santé avec qui il échange des signaux lumineux. Eugène Ionesco loge 96 boulevard du Montparnasse, en face du Théâtre de Poche, où je me trouve un soir à côté de Salvador Dalí, en veste de velours amarante, souliers vernis, canne à pommeau d’or, moustaches cirées telles des pointes d’épingle, qui tarde à entrer dans la salle car il doit satisfaire un besoin naturel et qu’il est ridicule d’aller aux toilettes quand on se déclare un génie.
À nous deux Paris !
Emil Cioran, pessimiste complaisant, niche au coin de la rue de l’Odéon, en face du théâtre où on assiste à la représentation de La Cerisaie d’Anton Tchekhov jouée par le Piccolo Teatro de Milan de Giorgio Strehler, avec le train miniature qui traverse le fond de la scène tchutt ! tchutt ! et les jouets qui déboulent de la vieille armoire en chêne dans ce qui est encore « la chambre des enfants ».
Ô merveille !
Jean-Paul Sartre, pipe au bec, teint terreux, s’installe en 1946, chez sa mère, 42 rue Bonaparte, au quatrième étage, avec vue sur la terrasse des Deux Magots (plutôt de droite), 6 place Saint-Germain, qui porte aujourd’hui son nom et celui de Simone de Beauvoir, qui ne sourit jamais sur les photos, même le jour de son prix Goncourt, en 1954. Il déménage au 222 boulevard Raspail, après deux attentats en juillet 1961 et janvier 1962, dans un petit studio. C’est là qu’il refuse le prix Nobel de littérature qui lui est attribué en 1964. À l’automne 1973, il emménage au dixième étage d’un immeuble triste et quelconque, 29 boulevard Edgar-Quinet, en face du cimetière du Montparnasse, qui lui tend les bras. « J’ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute : au milieu des livres. »
Qui dit mieux ?
Paris m’ouvre les bras. L’avenir est devant moi. Prié d’aller me faire voir ailleurs, sans un coup d’œil en arrière, ne pouvant plus reculer, abandonné par tous, prêt à tout réinventer, bien décidé à réussir et à reconstruire ma vie, serrant les dents, les poings et les mâchoires, n’ayant plus rien à perdre, mais tout à gagner, tirant des plans sur la comète, n’ayant rien fait de mal, mais ayant mal partout, et me souvenant de tout, me voici dans la ville que j’ai choisie, rayonnante de lumière, qui m’accueille à bras ouverts. Aimer la vie est plus facile ici qu’ailleurs. L’audace fourmille à tous les coins de rue. Tout est subtil, léger, élégant, brillant. Riant. Il faut être cultivé pour vivre à Paris.
On y vient depuis beau temps voir des amis comme Jacques Sternberg, le premier écrivain que je connais, ses livres occupent tout un rayon de ma bibliothèque, qui habite 1 villa Chanez, dans le 16e arrondissement, des expositions dans les galeries ou les musées, et assister dans les théâtres à des spectacles mémorables. Je sais qu’il n’y a pas plus Parisien qu’un étranger fraîchement débarqué, peu me chante. J’aime me balader dans Paris où je me sens comme un poisson dans l’eau. J’aime les bancs publics vantés par Georges Brassens que je ne goûte pas tellement pourtant, les grilles cernant le tronc des arbres, les pavés de Mai 68, les ponts qui traversent la Seine, la plus belle avenue de la capitale, le café-théâtre La Vieille Grille de Maurice Alezra (une ancienne épicerie, il gobe des tonnes de petits pois avant d’ouvrir), les bâtiments illustres, encrassés de nicotine, ravalés par André Malraux, avec sa mèche sur le front et son éternel mégot, le bitume noir et les feux rouges, les colonnes Morris, les boîtes aux lettres jaunes qui ne sont pas faciles à trouver, les bureaux de tabac, les marchands de journaux, les zincs des bistrots où on s’accoude et l’atmosphère enfumée des cafés.