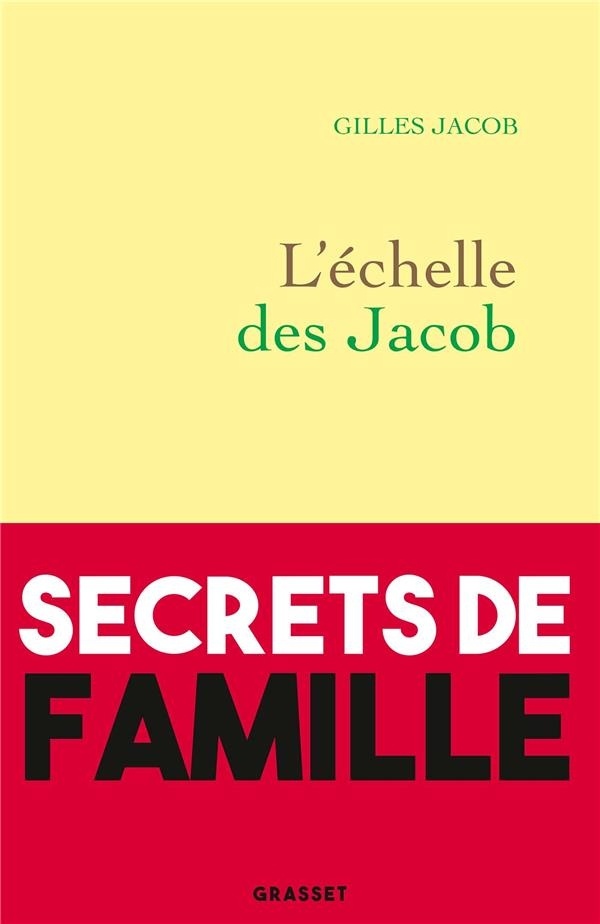L'échelle des Jacob
« Je me suis rappelé le jour où nous avions dîné tous ensemble et où mon père avait allumé son cigare à la fin du repas. Ma mère nous a rejoints au salon et a pensé à haute voix : « On est là tous les quatre… les choses qu’on a vécues… » Silencieux, le regard perdu, tous deux souriaient à demi. Oui, la famille avait survécu. »
C’était avant Bardot et les starlettes, avant que Spielberg, Coppola ou Jarmusch ne débarquent sur la Croisette, avant les batailles pour la palme et les très riches heures du Festival de Cannes.
C’était à la fin du XIXème siècle, dans une ferme en Lorraine. Un certain Auguste Jacob, mon grand-père, décidait de monter à Paris. Ainsi commençait l’histoire des miens - mon histoire. Avec ses heures de gloire -mon père André, héros de la Première guerre ; le cousin François, Compagnon de la Libération et prix Nobel- et ses heures sombres -l’Occupation, l’exode, un dramatique secret.
En racontant l’ascension d’un modeste paysan qui aura fondé, contre vents et marées, guerres et déportation, une dynastie, j’ai voulu raconter un peu plus qu’une affaire de famille. Une histoire française prise dans la tourmente du siècle et les tourments intimes.
Extrait
Aucun de ceux qui l’ont vécue n’a oublié cette journée du 25 juillet 1918. Dès le matin, le vent d’est fait frissonner les arbres et pencher les luzernes de la rive gauche de l’Aisne. Il y eut d’abord deux obus avant-coureurs tombés trop loin. Des 170 ou des 245, en tout cas de gros calibres. Puis on n’entendit rien d’autre que le grondement sourd, continu et ouaté de l’artillerie allemande qui tonnait au loin derrière une boucle de la rivière. Quand un obus s’abattait sur les hommes, le chuintement sec de l’air fendu en deux par le projectile était perçu trop tard pour leur laisser le temps ne serait-ce que de courber la tête. À quoi du reste aurait servi aux nôtres de se baisser – on bourrait sa pièce, on faisait feu, on rechargeait. De temps en temps, sur l’ordre de l’officier, on ajustait. À l’inverse, quand on était salement touché, on mourait sans que personne puisse empêcher ce massacre.
Parce qu’elles étaient installées en retrait des lignes d’assaut qu’elles appuyaient, les batteries d’artillerie passaient pour moins exposées. Tirées par des chevaux, elles se déplaçaient la nuit afin d’éviter le pilonnage incessant des canons à longue portée et des tirs de l’aviation allemande qui, de jour, piquaient sur nos positions en des attaques miaulantes. Quand elles ne coupaient pas à travers champs, les batteries passaient par des villages abandonnés dont les trous de shrapnells et les pans de mur noircis disaient l’intensité des combats.
Le 17 juillet, suivant les ordres de l’état-major, la 8e compagnie du 8e régiment d’artillerie de campagne se porte en avant de Ressons-le-Long jusqu’au Chat embarrassé. La surprise des Boches est totale. Ils reculent. Dans la nuit du 17 au 18, à cinq heures, les batteries 3, 1 et 2 suivent l’infanterie sous le feu des mitrailleuses et des mortiers. Le 19, elle est en place à l’est de Fosse-en-Haut, le 20 à La Barre, puis à La Croix-Saint-Créaude et, le 25, au ravin de Pernant après avoir repris haleine.
C’est là, front stabilisé, que la chose va se produire.
La pluie tombe sans discontinuer sur la lisière des champs et des bois, fait patauger les chevaux déjà fourbus dans une fange qui n’épargne ni les pantalons rouges ni les capotes des artilleurs. De cette couche visqueuse, le pied doit se décoller à chaque pas. La position est dure à tenir, continuellement bombardée y compris par des tirs d’obus toxiques, dominée qu’elle est par les hauteurs de la rive droite de l’Aisne.
Évaluer les distances au télémètre, surveiller à la jumelle les contreforts d’où pourrait dévaler à tout moment l’ennemi n’est pas mince affaire, d’autant que les batteries voisines semblent par moment manquer de munitions alors que la contre-attaque nécessite un feu ininterrompu. À force de reculer ou d’avancer pour couvrir l’infanterie, les chevaux sont désorientés sous le fracas de la bataille et se cabreraient s’ils n’étaient couplés par deux et freinés par le poids des canons qu’ils traînent.
Tandis que se déroule la deuxième bataille de la Marne où une masse énorme de fantassins est engagée, la 2e batterie est soumise à des tirs roulants de gros calibre. L’aspirant qui la commande consulte sa carte. Ensuite, il inspecte à la jumelle un chemin qui serpente dans la colline sur la gauche avant de plonger puis de remonter vers un petit bois. Il perçoit comme un reflet lumineux sur un objet métallique. La sensation n’a duré qu’un instant mais suffisamment pour le mettre en alerte. Il voudrait confirmation de ce qu’il a cru voir. Soudain, un sifflement rapide juste devant lui : l’abri d’une des pièces de canon est écrasé sous un 150, ensevelissant dans la boue trois canonniers et blessant les trois autres. Le reste du personnel de la batterie se précipite dans l’entonnoir ainsi créé et commence à dégager les survivants qu’une gerbe de terre a entièrement recouverts.
L’aspirant, lui aussi, s’est précipité. Il soulève, sous un déluge de feu, le lieutenant Richard dont une balle a fracturé la cuisse. Mais une vive douleur le fait lâcher prise : il vient de recevoir à son tour un éclat d’obus qui lui a percé le flanc droit à quelques millimètres du foie. Aussitôt, sa vareuse se teinte de rouge. Il se croit fichu. Il se sent mal. Il est à moitié enseveli.
Les blessés sont dégagés à mains nues puis transportés par les servants survivants accomplissant un effort surhumain pour avancer dans la boue. Ensuite, lors d’une brève accalmie, ils sont évacués jusqu’à une tranchée protégée des balles de mitrailleuses, puis vers l’arrière, où on est soigné. Malgré la douleur, leur intention est simplement de survivre.
Cet acte de bravoure, un parmi des milliers d’autres de la guerre de 14, c’est mon père qui l’a accompli. Le futur lieutenant à deux galons Jacob, André, Robert, né à Nancy le 25 juin 1897 à quatre heures, avait vingt et un ans et il aimait la vie.