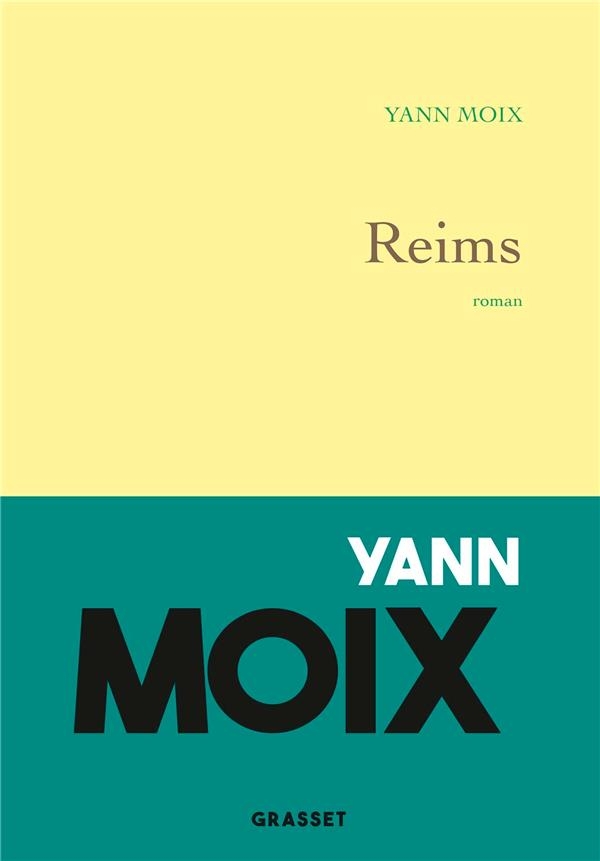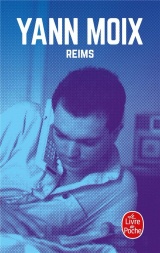Reims
Reims constitue le deuxième volume de la tétralogie, ou du quatuor, que l'auteur a intitulé « Au pays de l'enfance immobile », dont Orléans paru en aout 2019 était le premier opus, et dont Verdun et Paris seront les troisième et quatrième.
Le narrateur s'est enfin échappé du cauchemar familial d'Orléans, il aspire aux plus grandes écoles pour « monter à Paris » mais ses résultats médiocres aux examens de mathématiques le font atterrir à l'Ecole supérieure de commerce de Reims, vécue par lui comme une relégation en troisième division.
Ici tout n'est qu'ennui, impuissance, obsession sexuelle jamais assouvie, dérive alcoolisée, débâcle progressive avec une petite bande de paumés masturbateurs et suicidaires qui tournent le dos à la compétition scolaire pour mieux affirmer leur différence.
Dans cette course à la vanité paradoxale de l'échec, avec les mots brandis contre les chiffres, la littérature contre les mathématiques, le déclassement contre le classement, la révolte contre le conformisme, la provocation contre la convocation, il va s'agir, à défaut de briller par le succès, de se distinguer par l'ignominie.
Sur cette bande de pieds nickelés travaillés par la chose littéraire qu'ils ne travaillent pas, plane l'ombre des « Simplistes » qui étaient parvenus à produire des oeuvres belles et profondes à partir de Reims : René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte, Roger Vailland et d'autres qui ont illuminé la revue littéraire Le Grand Jeu, là où leurs pâles successeurs ne sont plus capables que d'un tout petit jeu grinçant et misérable.
Reims, ou la prolongation de la haine de soi quand la haine des vôtres vous a définitivement incarcéré au « pays de l'enfance immobile »...
Extrait
1. – J’échouai, piteusement, aux concours d’entrée des « grandes écoles scientifiques ». L’emploi de guillemets s’impose : ces écoles n’étaient pas si grandes. N’ayant aucune chance à Polytechnique, aux Mines, à Centrale, je ne pouvais espérer que des établissements médiocres, sis dans des villes de province où les mardis soir, en novembre, suggéraient le suicide par pendaison. Mon camarade Pierre Granspian s’était pendu horizontalement, en courant sur trois mètres, dans son galetas d’étudiant. Il avait « intégré » l’École supérieure d’électronique de Vesoul. Pendant trois ans, il avait répandu sa sueur, son sang, afin d’appartenir à l’élite de la nation ; il avait rêvé de prestige, de tunique militaire, de galons cognés de soleil, de défilés du 14 Juillet. Il s’était imaginé, marchant au pas sur l’avenue des Champs-Élysées, applaudi par ses parents bouffis d’orgueil et sa tante morne, le bicorne engoncé sur la tête, glabre, sabre au clair, brodequins cirés.
Granspian n’avait pas eu le niveau requis ; son cerveau ne s’était pas révélé suffisamment puissant pour dominer les exercices dont on l’avait accablé. Au lycée Pothier, où il fut mon condisciple, il n’avait pas démérité. Toujours vaillant, rempli d’optimisme, bon copain, « bosseur », il n’avait pas prévu, malgré les signes tangibles de ses insuffisances, qu’il n’accéderait jamais aux institutions glorieuses. La fatigue, la nervosité, la fébrilité firent que, durant l’âpre saison des concours, il se fracassa les dents contre un mur. Il le savait et ne bronchait pas ; il ne fut admissible qu’à des écoles de bas de classement dont ses propres professeurs ignoraient jusqu’à l’existence. C’en était fini des étincelles. Granspian n’épaterait personne. Il lui faudrait se recroqueviller quelque part, dans un trou, se faire oublier de ses contemporains. Il se coupa de ses amis. Nul ne put plus avoir accès à lui. Son désir d’être ingénieur avait toujours été inférieur à sa volonté d’en imposer aux foules – plus exactement à la foule de sa mère – par un diplôme flamboyant, censé faire taire à tout jamais les mauvaises bouches. Exagérément épris d’une Franco-Italienne aux seins mouchetés dont le prénom m’échappe, fille ambitieuse, méprisante, brillante qui fut reçue au sélectif concours de Télécom Paris, il dut abdiquer, la laissant convoler avec Guillaume, un professeur d’informatique qui devait se jeter sous un train six ans plus tard à cause de dettes contractées au jeu dans un cercle clandestin.
Granspian ne supporta pas Vesoul, sa texture, son climat – son architecture. L’agencement des rues lui portait au cœur. Les arbres plantés sur les avenues semblaient pleurer à sa place. Il sentait dans ses poumons, qui l’encombrait, un paquet de tristesse aussi lourd que sa haine. Il en voulut à la vie de s’être comportée envers lui comme une chienne. Il décida doucement de son sort ; entre l’instant où il s’avoua, un soir de poker, qu’il était déjà mort et celui où il se suicida, deux mois à peine s’écoulèrent. Les dernières semaines de son existence avaient produit sous son crâne rempli de vieilles équations désormais inutiles une détresse diffuse. Il dormait tard, lisait la presse comme il eût lu celle de 1856, se vêtait de façon lamentable. Il cessa de se laver. Se nourrissait exclusivement de céréales et de raviolis en boîte qu’il ne prit pas une seule fois la peine de réchauffer. Il fréquenta les prostituées, pratiquant sur elles l’anulingus. Si je connais ces détails, c’est parce qu’avant de « passer à l’acte », Granspian avait tenu le journal de ses jours ultimes. D’une écriture bleue, serrée, il exprime dans ces pages, avec un calme venu d’ailleurs, les difficultés qu’il éprouve à continuer de vivre dans la carcasse d’un raté. « Je ne suis pas fait pour être ce que j’ai fini par devenir. » Puis : « Ma solitude est totale. Aucune lumière ne peut plus me relier au désir d’être ; coincé dans mon échec, je décide ce soir de vivre “encore un peu”. Juste pour voir. Non pour espérer une surprise, un événement qui viendrait raturer ma décision, mais pour me sentir libre. Je choisirai moi-même la date de ma mort ; cette mort, contrairement aux écrits de Polytechnique, je la réussirai. Je vais maintenant quitter ce cahier pour boire. »
Granspian ne posa presque jamais un soulier en cours. Les étudiants de l’École, masculins à deux exceptions près (Julia Stéphane, Sonia Fauchez), ne présentaient aucun intérêt d’aucune sorte. Ils travaillaient dur aux fins de se spécialiser dans les transistors, les bobines. Il s’agissait pour eux d’exploiter le savoir théorique accumulé en classes préparatoires. Leur volonté était solide, de faire mieux connaissance avec les circuits électriques, les champs électromagnétiques, les phénomènes d’induction. Leurs conversations étaient ternes et répétitives. Ils ne s’intéressaient à rien, hors les motos, les ordinateurs, le sexe – cette passion cruciale. La plupart de ces anciens taupins, dont l’avenir venait mourir à Vesoul comme une méduse échouée sur le sable, étaient célibataires. La compagnie qu’ils offraient n’était pas de bonne qualité. Le soir, ils buvaient.
Un dimanche soir, Granspian ferma la porte de son studio à double tour puis attacha une corde à la poignée. Il opéra un nœud coulant, le passa autour de son cou, courut du plus vite qu’il put, fut soulevé, trembla de tous ses membres comme électrocuté, puis tomba au sol dans un bruit sec. C’était fini. Les vitres du salon étaient crasseuses ; le soleil, aveuglant. Ses parents n’y survécurent pas – ils disparurent l’année suivante de deux cancers concurrents. Il n’y aurait plus de rêves, plus de cauchemars. Juste ce vent d’automne entre les branches affaissées des saules. Quand tout ce petit monde fut en terre, je rendis visite au seul survivant de la famille Granspian – une tante immémoriale et sourde. Nous allâmes prendre un kir dans un petit café d’Orléans, à l’angle de la prison et de la cité HLM où elle vivait depuis quarante-six ans.