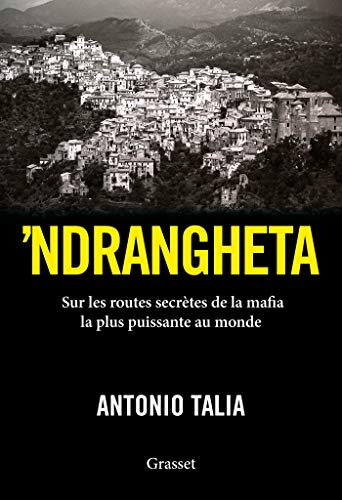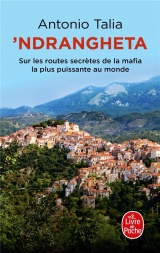'Ndrangheta
La route nationale 106 serpente entre la mer ionienne d’un côté et les montagnes de l’Aspromonte de l’autre. De Reggio de Calabre, on rejoint Siderno en seulement une heure et demie, c’est pourtant dans les quelques villages qui émaillent cette route qu’est née la ‘ndrangheta, la mafia calabraise implantée sur les cinq continents depuis plus de quarante ans et devenue l’une des organisations criminelles les plus puissantes – et rentables – au monde.
Semant la mort au Canada comme dans de paisibles villes allemandes, blanchissant son argent jusqu’à Hong Kong, pouvant faire vaciller un gouvernement européen, en mesure de traiter avec les cartels latino-américains les plus redoutables et d’organiser la plus grosse livraison d’ecstasy de tous les temps, la ‘ndrangheta a profité de l’espace ouvert par la mafia sicilienne pour conquérir le monde.
Antonio Talia, journaliste calabrais, n’a eu de cesse de chercher à comprendre le syndrome qui touche sa région depuis de nombreuses générations. Enlèvements, assassinats, corruption généralisée, pourquoi tout cela s’est-il développé justement ici ? Parcourir la Nationale 106 lui permet de remonter à l’origine du phénomène global qu’est aujourd’hui la ‘ndrangheta, une organisation aux rites ancestraux, qui peut, simultanément, célébrer une Madone en larmes tout en négociant des opérations financières de plusieurs millions d’euros. Talia a enquêté pendant plus de dix ans sur l’organisation secrète et pourtant poreuse, à laquelle lui et les siens ont toujours eu affaire. Il recoupe les informations, rencontre magistrats, criminologues, journalistes et ex-inflitrés, se nourrit de dossiers judiciaires, de rapports de police et de légistes qui, d’un bout à l’autre de la planète, font toujours entendre les mêmes noms, les mêmes consonances, du Canada à l’Australie, de la Slovaquie jusqu’à Marseille – car tous ont un lien avec ces villages le long de la Nationale 106.
Reportage lucide, empreint de l’émotion et de la rage de celui qui décrit sa terre natale, 'Ndrangheta est une immersion dans la psyché mafieuse, la carte – mentale et géographique – d’une organisation dans laquelle, selon la formule de Roberto Saviano, « on ne rentre que par le sang : celui qui coule dans nos veines ou celui que l’on fait couler ».
Extrait
Km 15, Bocale
Pour prendre la Nationale 106, on doit laisser derrière soi Reggio, les rues à angle droit du centre-ville qui débouchent sur le détroit de Messine, les vieilles guerres et les nouveaux équilibres des banlieues, ainsi qu’une certaine décadence diffuse.
Cependant, la ville exerce encore un magnétisme si puissant que son influence continue de rayonner le long de la côte, au point qu’à l’issue de ce voyage il nous faudra y revenir pour dresser un bilan définitif.
Après une zone industrielle semi-abandonnée et l’aéroport en déclin depuis des années, la bretelle qui conduit à la Nationale 106 donne sur un paysage immuable tout au long des cent quatre kilomètres à venir : l’asphalte au centre, les collines à gauche, la voie ferrée et la mer à droite, une césure qui rappelle la séparation entre Calabrais de la montagne et Calabrais de la mer, des catégories anthropologiques distinctes qui se recoupent à présent, après plusieurs générations de croisements et de déplacements.
Nous sommes partis un après-midi de printemps et le vent qui souffle n’est pas le sirocco (du sud), mais plutôt le grec (du nord-est) ou le libeccio (du sud-ouest), et l’air est donc pur, les nuages progressent rapidement, la lumière coupe l’horizon sans aveugler. Sur ce premier tronçon, la route est encore écrasée par des constructions inachevées, le soleil se reflète sur les tôles et les moignons de piliers, mais dès qu’on a franchi le feu rouge de Pellaro, cet enchaînement de laideur prend fin et le paysage commence à s’ouvrir.
C’est justement le sirocco qui a donné sa forme à Bocale dans les années soixante et soixante-dix. À l’époque, la classe dirigeante de Reggio – politiciens, professions libérales, entrepreneurs, tous liés au secteur public – se fit construire des villas au bord de la mer afin d’échapper à la canicule qui paralyse la ville quand le vent souffle du sud-est pendant des jours.
Bocale se dresse derrière Punta Pellaro. C’est là que le vent tourne, même si on n’est qu’à dix kilomètres de Reggio. Ainsi, quand un rival menace de conquérir un marché public dans votre dos un vendredi de la fin juillet, vous pouvez vous précipiter en ville et remplir des dizaines de documents avant la date limite de dépôt des dossiers.
Je suis persuadé que nombre des résidences d’été qu’on trouve à Bocale ont été construites avant tout pour garder un œil sur la concurrence. Dans ces villas, on organisait des dîners, des fêtes, des réceptions, des rencontres exclusives. Si quelqu’un inventait une application capable de mesurer, dans un certain périmètre, la part de travaux publics et la quantité de voix aux élections qui ont basculé, il suffirait de l’utiliser ici pour faire exploser les compteurs.
Sur la droite, une petite route mène à la départementale et, au bout d’un kilomètre, voire moins, on aperçoit une place entourée d’eucalyptus. On suit à pied un tunnel sous la voie ferrée et on accède enfin à la plage, ainsi qu’aux villas les plus discrètes. Rien de somptueux, de l’extérieur au moins : ce sont des constructions à deux étages décorées de stuc blanc, avec des arcades et de vastes cours entourées de murs d’enceinte hauts de deux à trois mètres, dont le seul luxe apparent – arraché grâce à une quelconque loi d’amnistie – consiste à donner directement sur la plage et le magnifique panorama du détroit.
La première villa à gauche a les murs quelque peu écaillés. Il n’est pas rare d’y observer du mouvement, parfois un jardinier qui s’occupe des bougainvillées ou quelqu’un qui arme une barque pour aller pêcher. Mais chaque fois que je suis venu, les voisins m’ont assuré que la famille n’y séjournait plus, faisant allusion aux mauvais souvenirs qui hantent toujours les lieux trente ans après.
Elle appartenait à Lodovico Ligato, ancien journaliste, ancien conseiller municipal, ancien député et président démissionnaire des Ferrovie dello Stato, la compagnie nationale des chemins de fer – qui était alors le premier employeur du pays –, contraint de quitter son poste après le scandale des « Draps d’Or », une affaire de marchés publics et de corruption qui a emporté toute la direction de l’entreprise.
Ligato fut assassiné ici durant l’été 1989. Son meurtre est à la fois la baleine blanche des homicides commis par la ’ndrangheta et un événement complètement refoulé par l’inconscient collectif. Le meurtre de Ligato ne donnera lieu à aucune commémoration, on ne diffusera pas d’enquête réalisée à partir d’images d’époque de la RAI, nul documentaire true crime pour évoquer l’exécution d’un des plus puissants serviteurs de l’État au cours des années quatre-vingt, et il y aura encore moins de plaque, de rue ou de prix à son nom.
Lodovico Ligato n’est pas le genre de victime dont les politiciens veulent se souvenir, il appartient au contraire à celles qui doivent disparaître de l’album de famille le plus rapidement possible. On doit donc s’en remettre aux paroles de ceux qui ont témoigné au cours des trois procès, en première instance, appel et cassation, et aux quelques autres personnes qui ont parlé, afin de reconstituer une affaire se déployant sur plusieurs plans et en restituer toutes les ambiguïtés.
Au cours de la nuit du 26 au 27 août 1989, Lodovico Ligato sort de sa villa et raccompagne deux invités jusqu’à la petite place entourée d’eucalytus où le couple a garé son véhicule. On se salue, Ligato reprend le tunnel pour rentrer chez lui et, au moment précis où Giovanni Gentile glisse la clé dans la serrure, son épouse Maria Grazia Bottari et lui entendent une longue série de détonations venant de la plage, suivie de cris et de plaintes. Ils se réfugient dans la voiture et, quelques secondes plus tard, une moto et ses deux passagers débouchent du tunnel à grande vitesse, avant de disparaître sur la route départementale.
Le corps sans vie du président démissionnaire des Ferrovie dello Stato gît sur les marches de sa maison, à quelques pas de la plage et des rails. Les enquêteurs estiment que trente-cinq coups de feu ont été tirés et que Ligato a été touché par vingt-six projectiles provenant de trois armes différentes, dont deux – un Glock calibre 9 parabellum semi-automatique et un Browning calibre 7.65 – avaient déjà servi à d’autres exécutions.
La reconstitution des faits montre que Ligato est atteint d’une première rafale dans le dos dès qu’il sort du tunnel. Il tombe, se relève et essaie de fuir jusqu’à la maison. Les tueurs le suivent et continuent à tirer, enfin ils l’achèvent de quatre balles dans la tête alors que la victime est déjà allongée sur les marches. Un dernier coup de feu est tiré en direction de son épouse, Eugenia Mammana, qui a réussi à ouvrir le portail d’entrée en murmurant, désespérée : « Ne tuez pas mon mari », avant de le refermer brusquement lorsqu’elle voit une arme pointée vers elle. La balle la manque, son fils Enrico trouvera la douille dans le salon de la villa le lendemain matin.