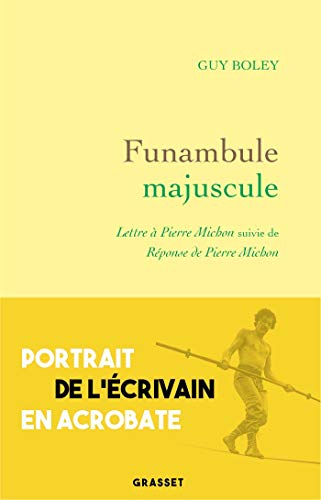Funambule majuscule
Avant d’écrire, Guy Boley a lu, énormément, en vrac et à l'emporte-pièce, comme tout autodidacte. Puis, un jour, un livre de Pierre Michon, Vies minuscules. Ebloui par ce texte, il est allé le rencontrer, il y a plus de trente ans, dans une librairie, lors d'une séance de signatures. Ils sont devenus amis. Quelques années plus tard, il lui écrit cette lettre, hommage non idolâtre dans lequel il compare le métier d’écrivain à celui qui fut le sien des années durant : funambule.
Qu’ont en commun l’auteur et l’acrobate ? Presque tout de ce qui rend la vie séduisante, dont ceci : chacun doit affronter le vertige, le vide, et le risque de la chute. Parce qu’il a su braver la peur et se relever après s’être brisé maintes fois, Pierre Michon mérite, aux yeux de Guy Boley, le titre de Funambule Majuscule. Il nous dit pourquoi. Mais pour illustrer son propos, il se livre également et partage avec nous ses souvenirs d’un temps où il risquait sa peau en traversant le ciel. Il raconte comment il grimpait des mètres au-dessus du sol pour s’élever et tendre ses cordes d’acier avant de se lancer, et nous invite sur les toits, les clochers, les hauteurs, à le suivre.
Déclaration d’amour, ce court texte est le plus intime de Guy Boley. Il y assume le je pour se confier, se raconter funambule, lecteur et prétendant auteur, mais aussi revenir sur ses rêves utopiques de jeune soixante-huitard ou la mort de son père. Avec une force et une poésie brutes, il nous livre ainsi une confession inédite et une réflexion profonde et terriblement juste sur l’écriture, la littérature, et la beauté que traquent ceux qui la servent encore.
La lettre est suivie de la réponse de Pierre Michon à Guy Boley.
Extrait
Mardi 6 juin 2000
Cher Pierre,
je sais que tu admires le fait que j’aie été funambule, que j’aie risqué ma peau sur un câble, entre terre et ciel, et que j’aie fait, comme tu le prétends, quelque chose de ma vie, ceci sous-entendant que tu aurais quelque peu gâté, ou gâché la tienne. Alors que, très sincèrement, j’ai souvent le sentiment d’avoir été un appareil photographique dans lequel on aurait oublié de mettre une pellicule, et de toutes ces années de funambulisme il ne me reste pas grand-chose : des images, certes, et des courbatures quand le temps change ; des milliers de visages anonymes dont une bonne majorité me regardaient en espérant la chute, témoin ces imbéciles, ces fiers-à-bras de village ou de banlieue qui secouaient parfois mon câble, juste pour amuser quelque pisseuse au rire idiot et au regard vide, au risque de me faire choir. Choir ou chuter. J’ignore quel verbe j’aurais employé juste avant de mourir.
Quand je t’ai dit que je t’admirais puisque tu as écrit, entre autres, Vies minuscules, tu as eu un geste de la main quelque peu blasé, du genre :
« On ne va pas encore m’emmerder avec toutes ces vieilleries… »
Tu vois, nous avons chacun nos dieux de fortune. À la différence que tes livres resteront. Mes galipettes sur un fil, tout le monde les a déjà oubliées, hormis mon corps, les jours d’humidité, qui me décompte ses fractures, lentement, une par une. Treize, au total, mais pas toutes en tombant du fil. J’ai commis, dans ma vie, bien d’autres sottises beaucoup moins élégantes que marcher sur un fil.
J’attendais tes livres. J’attendais depuis longtemps cette écriture inspirée. J’en avais plus qu’assez de toute cette littérature de merde, de ces articles laudateurs de critiques complaisants, de ces copinages parisianistes, de ces renvois d’ascenseurs vides, de toute cette profonde misère éditoriale. Parce que, mine de rien, du haut de mon câble ou du fond de ma campagne, je parvenais et je parviens toujours à suivre la chose de très près. Le petit monde de l’édition manipule ses marionnettes avec des ficelles tellement grosses qu’on les voit jusque dans mon village, un cul-de-sac de soixante habitants. Et si je prétends voir les ficelles hors de leur castelet, ce n’est pas par fanfaronnade, je sais de quoi je parle : j’ai été marionnettiste, avant d’être funambule. J’en ai manipulé, des pantins, autant qu’eux. Alors tu vois bien, ils m’agacent, ces mauvais artistes. Ils parviendraient presque à m’écœurer, à me dégoûter de la parole. À me la prendre. À me l’anéantir. À me faire douter du talent de Guignol.
Bien sûr, tu aurais souhaité que tes Vies minuscules te rapportent (ou rapportassent) leur équivalent majuscule en lingots d’or. Naïf ! Il fallait te couper l’oreille, comme Vincent. C’est de cela, qu’est assoiffé le peuple médiatique. De chair ! Mais de chair qui saigne encore ! Chaude et fumante ! Pas la chair des mots qui n’a plus grande valeur. Ne pas oublier que certains bourgeois payent des milliards de dollars un tournesol de peinture séchée qui a tout perdu de son éclat mais dans lequel ils croient déceler, entre deux pétales, quelques globules de l’artiste maudit. Globules jaunes qu’on paye en billets verts.
Montaigne disait : « Que me suis-je mêlé d’écrire ? » Nous en sommes tous au même point. Que nous sommes-nous mêlés d’écrire, nous autres au lieu de vivre.
Quand je t’ai demandé si tu n’écrivais toujours pas, toujours plus, j’ai senti que tu avais eu, au téléphone, le même geste blasé de la main :
« Ce n’est pas important, tout ça… »
Non, ce n’est pas important. C’est juste prioritaire. Fondamental. Duras l’a écrit, juste avant de jeter l’encre :
« Écrire toute sa vie, ça apprend à écrire. Ça ne sauve de rien. »
C’est bien ce que nous voulons, au bout du compte : apprendre à écrire. Être occupés, pas sauvés.
Je me suis mêlé d’écrire et je me suis mêlé de lire. J’ignore pourquoi. Quand j’étais gosse, il n’y avait aucun livre, chez nous, à la maison ; c’est moi le premier qui les ai amenés, ces bâtards, sous le toit familial. Première paye et première engueulade, parce que j’avais acheté « des conneries » plutôt que de l’utile. Je devais avoir dans les quinze ans. Ma première connerie fut un livre de Victor Hugo : Les Contemplations. Je le possède encore. Couverture rouge, toilée, j’avais dû payer ça la peau du cul. Pourquoi Hugo ? Parce que je viens du peuple, d’une famille à qui la chose imprimée faisait peur, et que je n’avais eu que l’école pour référence. Le seul vers que citait régulièrement mon père était d’ailleurs : « Le coup passa si près que le chapeau tomba. »
Il le mimait, ça faisait un peu rire, aux fins de banquets. De l’Hugo comme on l’aime dans les chaumières. Poète national. Poète du populo. Papa avait appris ce vers sur les bancs de la communale, juste avant de rentrer dans la vie professionnelle. À sa mort, j’ai retrouvé de petits carnets dans lesquels il notait des mots manifestement choisis au hasard dans le dictionnaire pour leur sonorité, leur couleur, leur bizarrerie orthographique. Un peu comme on choisit des mets sur un menu étranger dont on ne comprend pas la langue. Quand je suis allé pour la première fois au Japon, cela devint immédiatement un de mes jeux favoris : je prenais un menu écrit en idéogrammes, je posais mon doigt au hasard sur une ligne de kanjis, le garçon m’apportait le plat commandé et je m’émerveillais à chaque fois du machin étrange qui reposait dans l’assiette ou le bol.
Il m’arrivait d’en rire, seul, face à mes deux baguettes que je tournais entre mes doigts en me demandant par quel côté attaquer le repas. Papa, dans ses carnets, avait noté des mots qui eux aussi continuent de tristement m’émerveiller. Des mots qu’on ne sait pas non plus par quel bout attraper. Des mots comme ectropion, empyreume ou exogyne, si j’ouvre ses petits carnets à la page des E. Des mots qui ne lui servaient à rien. Des mots qui ne servent à pas grand monde, à part à quelques Japonais qui cherchent à maîtriser notre langue pour faire les malins lors de quelconques symposiums sur l’onomasiologie.
En feuilletant ses carnets, j’avais les larmes aux yeux. Je crois bien que c’est Cocteau qui a écrit : « Un roman, c’est un dictionnaire dans le désordre. »
Papa, à sa façon, était donc romancier.
J’ai été intoxiqué par la chose littéraire et j’ai passé ma vie à lire, hanter les librairies, les bibliothèques, les bouquineries : quête du Graal dans des odeurs d’encre, de poussière, de cire et de moisi.
Dans je ne sais plus trop quelle interview (ou peut-être est-ce dans un de tes livres), tu parles de tes errances au milieu des villes et de leur surabondance d’ouvrages ; errance d’un naufragé en quête de grâce. Je connais cette vacance. On feuillette, tout debout, un peu de tout et de n’importe quoi pour se donner l’illusion d’être. Je connais, pour l’avoir suffisamment subie, cette indigestion de trop de temps libre, cette paresse de retrousser les manches. Fréquemment, j’appelle au secours Louis Guilloux, ce grand écrivain injustement méconnu qui disait justement, comme s’il s’était tout spécialement adressé à nous : « Il ne faut pas qu’un certain pessimisme serve d’excuse à notre paresse d’écrire. »
Cette phrase, extraite d’un de ses carnets, m’est hélas rarement utile. Sinon à me culpabiliser davantage. Que veux-tu, on ne pourra jamais conquérir l’inaccessible étoile sans s’abîmer un minimum les genoux, et les mains, et la tête, alouette. Le vieux précepte judéo-chrétien planqué sous le confessionnal ne nous accordera l’hostie qu’à condition que la flagelle nous ait suffisamment, et dûment, molestés.
La vie m’a plutôt gâté, si je regarde en arrière, et rien ni personne ne m’a contraint à cet enfer douillet (je veux dire la littérature) (enfin, sa quête). En exergue de Vie de Joseph Roulin, sans doute un de tes plus beaux livres, tu as écrit :
« Est-ce que chaque chose vaut exactement son prix ?
— Jamais »,
répond l’autre.
On aurait vite tendance, en te paraphrasant, à rallonger la liste :
« Sommes-nous absolument ce que nous sommes ?
— Toujours »,
répondrait l’autre.
Car nous sommes toujours ce que nous sommes, depuis notre naissance. Nous aurons beau courir après nous-mêmes pour nous lancer des pierres, elles ne nous atteindront jamais. Nous sommes inaccessibles à notre propre amélioration. À Nietzsche qui nous hurle : « Deviens qui tu es », on devrait simplement répondre : « Le mal était déjà fait. »
Le mal était venu d’ailleurs. De là où les seringues de la vie ne pénètrent aucune veine. Heureusement que tu as placé, en exergue d’un de tes autres livres, cette phrase salutaire :
« Tu pourras être un grand écrivain, tu ne seras jamais qu’un petit farceur. »
Ça fait du bien, de rire un peu.