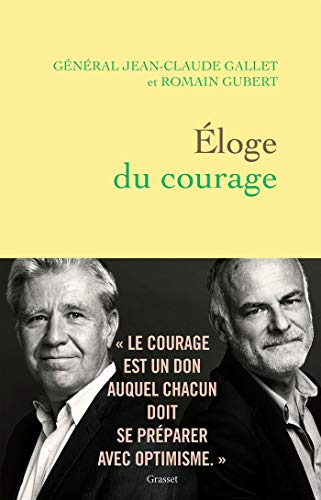Eloge du courage
C’est un éloge qui n’a jamais été fait : le courage ne peut se vivre qu’en actes, au marché de la mort et de la vie, dans les instants limites. Il ne s’offre, ne s’échange pas, ne se transmet pas. Mais il se confond : courage ou audace, courage ou témérité, courage ou colère… Si cet éloge est difficile, exigeant, à hauteur d’homme et non des dieux, c’est parce que les mots peuvent sembler fragiles. Face au feu qui gronde. Devant la violence nue. Quand tout geste est irréversible. A l’instant de sauver l’autre, en y risquant sa vie.
Pour faite cet éloge, il faut avoir vécu avec cœur, et ne pas aimer donner des leçons. Il faut ce mélange de force, de simplicité. Il faut avoir connu la peur. Il faut de la solitude et de la fraternité. Et il faut raconter. Au fil des pages, ici, la traversée est magnifique. Un souvenir d’enfance. Le regard maternel. Une histoire méconnue. Mais aussi : cette négociation dangereuse. Une tractation dans un désert qu’on ne peut nommer. L’escalade à mains nues d’une façade en flammes. La perte d’un frère d’arme.
N’en doutez pas : l'époque est au courage, affirment Jean-Claude Gallet et Romain Gubert, dans ce court livre, à la fois traité, récit, carnet de bord, leçon de vie. Le premier, ancien général des Pompiers de Paris, aux carrières nombreuses, qui sauva Notre Dame. Le deuxième, grand reporter, écrivain. Ensemble, ils ne donnent qu’une seule leçon : le courage est un don, auquel il faut se préparer, et qui peut se dire.
Extrait
Je n’ai pas 25 ans. Dans quelques semaines, je sortirai de Saint-Cyr. Avec mes camarades de promotion, j’effectue un stage de survie en Guyane française au fin fond de la forêt amazonienne. Nous sommes sous les ordres d’un légionnaire, un lieutenant issu du rang, qui connaît parfaitement les mangroves, les dangers et les mystères de la faune locale. Les premiers jours du raid, tout se déroule parfaitement. Notre lieutenant-légionnaire nous casse de fatigue pour nous démontrer que malgré nos futurs galons d’officiers, nous ne sommes que des bleus et nous avons tout à apprendre. C’est le jeu.
Pendant qu’il nous pousse dans nos retranchements physiques, je me réserve un espace à moi que je ne partage pas avec les autres. Je découvre cette forêt avec un immense bonheur, une jouissance que je n’ai encore jamais connue, sauf en mer. C’est bête de le dire comme ça, mais tous mes sens sont en éveil.
Pour faire passer l’épuisement, je me concentre sur ces cris auxquels je ne suis pas habitué. Ceux des grenouilles géantes et des oiseaux aux mille couleurs. J’aperçois des singes narquois et des iguanes au regard désabusé, comme si ces bestioles préhistoriques avaient vu passer tant de monde avant nous qu’elles ne s’étonnent plus de rien, surtout pas de notre modeste défilé.
Relié aux autres par un fil d’Ariane tant il est aisé de perdre le groupe dans la végétation, j’ouvre la marche. Je jubile. J’ai le sentiment de cheminer à travers les pages de Papillon, ce livre que j’ai découvert adolescent dans lequel Henri Charrière raconte sa détention comme bagnard à Cayenne. Moi qui ne connais guère d’autres horizons que ma Vendée natale, je suis ébloui.
Le quatrième jour, tout bascule. Avec le lieutenant et trois de mes compagnons nous sommes partis en reconnaissance. Un serpent mord l’officier. Il devient livide. Il se tait. Avec mes camarades, nous devinons rapidement – et sans doute le sait-il lui aussi – que nous devons le sortir de là le plus vite possible. Le lieutenant est le seul à connaître la forêt. Nous n’avons pas de radio. Il n’y a pas de chemin, tout se ressemble et ces lieux dont je commençais à tomber amoureux deviennent terriblement hostiles, cruels. Nous nous taisons. Nos boussoles (à l’époque, il n’y a pas de GPS) ne servent à rien puisque nos cartes n’indiquent aucune habitation dans un rayon de 50 kilomètres. Nous sommes en milieu d’après-midi, la nuit tombe dans une heure. Petit à petit, un goût de rouille, un goût amer, envahit ma bouche. Je ne sais pas encore ce que c’est.
J’avais déjà eu la frousse à 20 ans en poussant une moto à 180 kilomètres à l’heure et lors d’un saut en parachute. Mais cette fois-ci, ce goût âcre, c’est autre chose. La trouille ressemble à une peur d’enfant, incontrôlable. Je ne sais pas encore que je la retrouverai plusieurs fois dans ma vie. Que je vais devoir vivre avec. À la tête de quelques hommes sur les terrains les plus fracassés de la planète ou plus tard général, commandant une brigade de 8 500 pompiers.
Ce jour-là, dans cette forêt, c’est la première fois qu’un de mes camarades est en train de mourir sous mes yeux. Je ne crains rien pour moi. Je suis solide. Mes compagnons aussi. Mais la peur, la vraie, est là. Ce que j’ai appris à l’école n’a plus aucun sens. Face à ce scénario imprévu, je suis en roue libre, je ne hiérarchise plus aucune information. Notre chef peine à respirer et je n’ai plus de repères. Je n’ai pas appris à réagir face à cette situation particulière. Il faut aller vite. Réfléchir. Prendre une décision.
Jusque-là, ma vie de jeune homme n’était guidée que par des valeurs très viriles et des certitudes : la force, l’entraînement, l’intelligence tactique, le combat… Ce jour-là, je comprends qu’à Saint-Cyr, aucun professeur ne parle de ce goût acide à ses élèves. Chacun, au combat ou ailleurs, devra s’en faire une idée par lui-même. En regardant le lieutenant s’éteindre peu à peu, je découvre qu’en mission, l’inconscient joue sa partie et que celle-ci n’est pas minime. Peu à peu, dans cette jungle, je fais connaissance avec la peur. Et je devine le goût du sang.
Je dois éloigner la fébrilité, l’excitation, la sidération, l’affolement, la panique. Avec un brancard de fortune sur lequel nous allongeons le légionnaire, nous décidons d’aller vers le fleuve. De là, nous construirons une embarcation puis nous nous laisserons entraîner par le courant. Nous finirons bien par tomber sur un village. C’est un pari. Il n’est pas question d’attendre plus longtemps que l’on vienne nous chercher : le lieutenant sera mort quand on nous retrouvera.