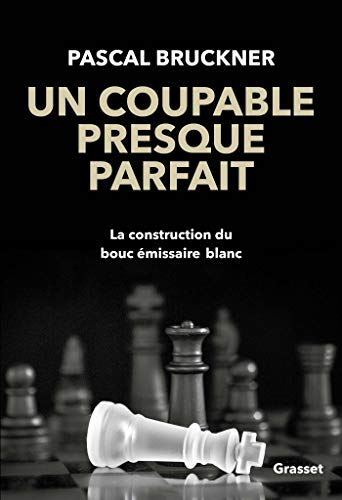Un coupable presque parfait: La construction du bouc-émissaire blanc
La chute du Mur a laissé les gauches européennes en plein désarroi. Sur le champ de bataille des idées, le progrès, la liberté et l'universel ont cédé la place à une nouvelle triade directement importée des USA : le genre, l'identité et la race.
On se battait hier au nom du prolétariat, du Tiers-monde et des damnés de la terre ; on condamne aujourd’hui l'homme blanc, coupable du colonialisme, de l’esclavage et de la domination des femmes. Trois discours – néo-féministe, antiraciste et décolonial - le désignent comme l’ennemi commun de l’humanité. Il est devenu le nouveau Satan, celui que son anatomie même désigne comme violeur ontologique, sa couleur de peau comme raciste, sa puissance comme exploiteur de tous les « dominés » et « racisés ».
Tout l'enjeu de cet essai est d'analyser comment, sous l'impulsion d’une américanisation caricaturale de l’Europe, la lutte des genres et celle des races sont en train de remplacer la lutte des classes, de balayer la méritocratie et de détruire l’idée d’humanité commune. Faire de l'homme blanc le bouc émissaire par excellence, ce n’est jamais que remplacer un racisme par un autre ; avec, comme horizon funeste, des sociétés tribalisées, crispées sur leur trésor identitaire et en proie à la guerre de tous contre tous.
Extrait
Y a-t-il une « culture » du viol ?
Pour la génération des baby-boomers, deux événements ont été déterminants : la libération des mœurs et le féminisme. L’un n’allait pas sans l’autre. Il est vrai qu’on revient de loin, en France : les femmes n’obtiennent le droit de vote qu’en 1945, ne sont émancipées de la tutelle maritale qu’en 1965, date à laquelle elles peuvent travailler et ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation de leur mari. La loi de 1970 dépouille le père de son autorité exclusive qu’il partage dorénavant avec la mère. Le contrôle de la fécondité grâce aux contraceptifs, la dépénalisation de l’avortement avec la loi Veil du 17 janvier 1975 ouvrent la voie, pour les femmes, à une plus grande maîtrise de leur corps. Ultérieurement, plusieurs lois facilitent le divorce : le mariage cesse d’être pour les épouses une prison, il devient un libre choix dont elles peuvent sortir à volonté.
Nous avons aimé le féminisme jadis, parce qu’il libérait à la fois les hommes et les femmes et mêlait la colère et la générosité. Il permettait aux unes et aux autres de se réinventer et de dépasser les stéréotypes. Quel réconfort pour les unes de s’affranchir du rôle de mère et d’épouse et de pouvoir enfin conquérir leur indépendance en travaillant ! Quel soulagement pour les autres de ne plus avoir à reproduire une virilité toxique et d’abandonner l’agressivité propre au machisme, qui est aussi une oppression des hommes par les hommes ! Que s’est-il passé, depuis, pour que l’étendard de la libération brandi par certaines ne vise qu’à dresser les sexes les uns contre les autres ? Comment le féminisme de progrès est-il devenu un féminisme de procès ?
Tous violeurs ?
Quelques mots en préambule. Nous connaissons tous, dans notre entourage, une épouse, une amie, une compagne qui a été victime de viol ou d’agression. Chacun peut voir dans la rue, le bus, le métro des hommes de tous âges solliciter ou insulter les femmes qui passent. Et le danger grandit à mesure que la nuit tombe et que l’alcool, le sentiment d’impunité s’y mêlent. Chaque père, chaque mère s’inquiètent lorsque leur fille, jeune, sort le soir et risque de faire une mauvaise rencontre. Le viol est un crime, le viol de masse, en temps de guerre, une arme de destruction massive des âmes et des corps et il est obscène d’en minimiser l’horreur ou la fréquence. Mais n’est-il pas aussi douteux d’en faire le révélateur des relations entre les sexes, comme si elles se résumaient toutes entières à celui-ci ?
À en croire une nouvelle doxa, tout serait viol dans la vie quotidienne : le regard des passants, leur allure louche, leur mentalité et jusqu’à l’air que nous respirons. Le moindre sourire d’un garçon à une fille recèlerait une intention meurtrière : naître femme, ce serait naître proie ; naître mâle, ce serait naître tueur. L’immense majorité des hommes, en France comme ailleurs, pour ne pas dire la totalité d’entre eux, ne rêverait que d’abuser des corps féminins : « Le mari qui viole régulièrement sa femme s’assure de la terroriser et de l’isoler suffisamment pour qu’elle n’en parle à personne. Le chef de rayon qui harcèle sexuellement ses employées entretiendra une atmosphère suffisamment pesante pour que tous ceux au courant se taisent par peur de perdre leur emploi. » Conclusion : « La culture du viol est partout, chez vous, chez moi, cher lecteur, dans les émissions que nous regardons, dans les livres que nous lisons, les conversations avec nos proches, dans nos institutions. Si difficile que ce soit à admettre, nous participons tous à la culture du viol. » Tel est le message qu’un certain féminisme, rabâchant des thèses nord-américaines déjà anciennes, diffuse sans relâche depuis quelques années : ainsi que l’exprime l’ancienne présidente de l’Unef, Caroline De Haas, dans un entretien à L’Obs du 14 février 2018, « un homme sur deux ou trois est un agresseur ». Pour citer le sociologue Éric Fassin : « Il s’agit de penser la violence sexuelle en termes culturels et non individuels, non pas comme une exception pathologique mais comme une pratique inscrite dans la norme qui la rend possible en la tolérant, voire en l’encourageant. » En d’autres termes, le viol n’est pas un écart mais une confirmation de la norme qui le porte en lui comme la nuée porte l’orage. Le même Éric Fassin, après les agressions dont avaient été victimes, la nuit de la Saint-Sylvestre 2015-2016, des femmes allemandes à la gare de Cologne et dans beaucoup d’autres villes de la République fédérale de la part de migrants d’Afrique du Nord, expliquait à la télévision : « Ce n’est pas parce que ces gens sont musulmans qu’ils ont commis ces actes. Il y a une finalité politique. À qui s’en sont-ils pris ? À des femmes allemandes, blanches. Ils ne sont pas allés violer des prostituées. Cela donne le sens de leur violence. » Nous voici rassurés. Agresser des femmes blanches, donc dominantes, et allemandes de surcroît, n’est pas si grave : c’est presque un acte de rébellion anti-impérialiste. Le même Éric Fassin a signé en 2017 une pétition contre la pénalisation du harcèlement de rue, craignant que le texte ne stigmatise les « racisés », c’est-à-dire les migrants. Tout ce qui est masculin est mauvais mais tous les hommes ne se valent pas en vilénie : ceux qui viennent de pays pauvres et dominés ont des circonstances atténuantes. Nous en reparlerons.
Le pénis, arme de destruction massive
Ce que disaient les féministes américaines dans les années 1970, 1980, 1990, des féministes françaises le répètent comme de bons perroquets dans les années 2010, 2020. En exergue de son livre sur la culture du viol à la française, Valérie Rey-Robert cite Andrea Dworkin : « Nous les femmes. Nous n’avons pas l’éternité devant nous (…). Nous sommes tout près de la mort. Toutes les femmes le sont. Et nous sommes tout près du viol et nous sommes tout près des coups. » (Pour rappel : en France, l’espérance de vie des femmes est de cinq ans supérieure à celle des hommes. Bref, les citoyennes françaises sont moins près de la mort que leurs homologues masculins, inégalité dont personne ne s’indigne.) Fasciné par le modèle américain, un certain néoféminisme à la française est dans une situation de décalque intégral par rapport à ce dernier. Nous autres Français avons tendance à reproduire, servilement, les pires défauts de nos amis américains et à négliger leurs immenses qualités.
L’ennemi est donc, aux États-Unis, le mâle blanc de plus de 50 ans puisqu’il détient le pouvoir économique, occupe les trois quarts des sièges dans les conseils d’administration et constitue plus de la moitié des élus. Tout irait mieux sans l’homme blanc qui conçoit et dirige le monde : il est la souillure qui abîme la pureté originelle du monde. Pour l’« afroféministe » Françoise Vergès, il n’est que deux types d’hommes, les prédateurs, toujours et majoritairement blancs, assistés de leurs femmes, et les « racisés » (entendez les Noirs et les Arabes mais pas les Asiatiques selon la rhétorique en cours). Le nouveau puritanisme ne diabolise plus la femme comme dans l’islam d’aujourd’hui ou le christianisme d’hier, mais l’homme. On a changé de malédiction mais non de mentalité. Tout en lui est nocif, à commencer par le mansplaining, cette détestable habitude qu’il a de parler aux femmes de manière condescendante (comme si des femmes ne faisaient pas preuve du même penchant les unes envers les autres). Mais aussi le mansterruption, cette propension des hommes à couper la parole dans une conversation ou encore le manspreading, habitude de certains de s’asseoir jambes écartées dans le métro ou le train. On se souvient que les féministes allemandes, dans les années 1970, voulaient déjà interdire aux hommes d’uriner debout, signe d’arrogance machiste.
Le deuxième sexe est par nature innocent même quand on l’accuse à son tour de harcèlement : ainsi lorsque la professeure Avital Ronell, qui occupe la chaire de littérature féministe à la New York University, fait l’objet, en 2017, d’une plainte de la part d’un de ses étudiants, tous ses collègues dont Judith Butler et le philosophe Slavoj Žižek signent une pétition pour la défendre et arguent de sa réputation et de son rang pour discréditer son misérable dénonciateur. Elle sera suspendue pour un an. L’homme, de par sa force physique, est naturellement coupable si bien que, comme les Juifs du Moyen Âge décrits par René Girard, on ne peut le dissocier de sa faute. Le combat contre lui est juste : même si des innocents sont, par accident, accusés à tort de viol ou de harcèlement, c’est le prix à payer pour une croisade indispensable. De toute façon, les femmes ont tellement de souffrances en retard depuis des millénaires qu’aucune injustice présente ne pourrait éponger cette dette : l’humanité entière est débitrice à leur égard et condamnerait-on tous les garçons vivants qu’on ne saurait rembourser le genre féminin. Être victime, pour une femme, est un statut social, presque ontologique.
C’est que l’homme est affublé d’une arme redoutable qui le condamne à l’agression : son pénis. « La violence, disait la féministe Andrea Dworkin, c’est le pénis ou le sperme qui en sort. Ce que le pénis peut faire, il doit le faire de force pour qu’un homme soit un homme. » Doté de cette malédiction qui lui pend entre les jambes, l’homme n’a dès l’enfance qu’une obsession : tuer, annihiler. « La sexualité mâle, ivre de son mépris intrinsèque pour toute vie, spécialement pour la vie des femmes, peut devenir sauvage, s’élancer à la poursuite de ses proies, utiliser la nuit comme couverture, trouver dans les ténèbres sa consolation, son sanctuaire. » Le lit conjugal est une zone de guerre, Kobané ou Stalingrad à l’horizontale. Faire l’amour, pour un garçon, est presque toujours synonyme de brutalité et, pour une femme, de souffrance. Le temps de l’innocence amoureuse n’a jamais existé : derrière les joutes érotiques, une guerre à bas bruit se livre chaque jour. Comme le conclut Laure Murat, professeure à l’université de Los Angeles : « Nous vivons dans une société globalisée qui, rigoriste ou libérale, religieuse ou non, musulmane, juive, chrétienne, met les femmes en danger. » Donc toutes les femmes sont en danger, à Raqqa comme à Beverly Hills, à Goma comme dans le 7e arrondissement de Paris, la grande bourgeoise comme la prolétaire. Vraiment ?