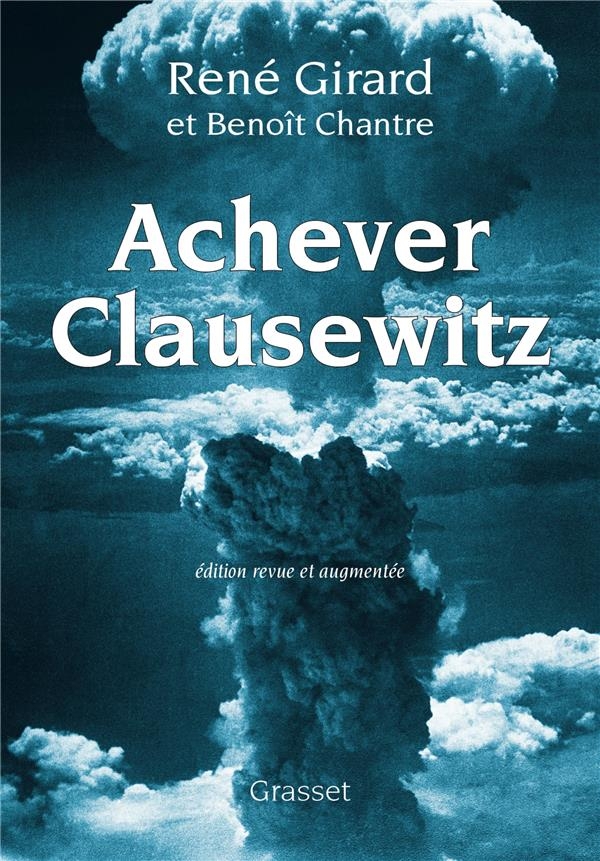Achever Clausewitz
Lorsqu’au printemps 2006, René Girard et Benoît Chantre décidèrent d’écrire un livre sur Carl von Clausewitz (1780-1831), la perspective d’une catastrophe nucléaire s’était bien éloignée des esprits. La Guerre froide semblait révolue. Quant à la « vieille Europe », elle feignait de penser qu’elle avait exorcisé ses conflits séculaires. Lancé en octobre 2007, Achever Clausewitz fut très bien accueilli et traduit en de nombreuses langues : un succès que ne garantissait pas a priori la violence de son propos. Délibérément apocalyptiques, ces entretiens sur la destruction de l’Europe, l’échec du christianisme historique et le crépuscule de l’Occident s’achevaient sur un plaidoyer pour la relation franco-allemande et les figures qui l’incarnèrent. Or personne n’attendait sur le terrain géopolitique un auteur qu’on croyait plus préoccupé par les origines de l’humanité que par la fin de l’histoire occidentale.
L’intérêt que ce livre continue de susciter, quinze ans après sa parution, tant dans les cercles militaires et stratégiques qu’auprès des littéraires, des philosophes ou des anthropologues, est l’occasion d’en publier une version revue et augmentée. Mais le contexte a beaucoup changé. En 2007, c’était les actes suicidaires du djihad que Girard et Chantre interrogeaient en relisant De la guerre. L’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, en février 2022, tout en s’inscrivant dans la brèche ouverte par le 11-Septembre, laisse présager un conflit d’une ampleur inédite depuis 1945. Nous voici entrés dans une nouvelle ère de la violence où se profile, avec une part de hasard beaucoup plus grande que dans les années 1960 et 1970, la possibilité d’une « guerre absolue », plus encore que d’une « guerre totale ». Ces entretiens riches et denses n’ont donc malheureusement pas pris une ride.
Extrait
Benoît Chantre : Votre œuvre, René Girard, est fondée sur la critique littéraire, l’étude du religieux dans les sociétés archaïques et une relecture anthropologique des Évangiles et de la tradition prophétique juive. Rien ne vous destinait a priori à vous passionner pour les écrits d’un général prussien, mort à Berlin en 1831 dans une certaine indifférence. Comment cet intérêt pour Carl von Clausewitz vous est-il venu ?
René Girard : De façon assez récente, par la découverte d’une édition américaine abrégée de son traité De la guerre, et la compréhension soudaine que ce général prussien, comme vous dites, avait eu des intuitions très proches des nôtres, et qui me permettaient enfin d’articuler les grands principes de ma théorie mimétique à l’histoire, en particulier celle des deux derniers siècles. Je croise bien sûr la guerre dans mes livres, plus particulièrement dans La Violence et le Sacré, mais d’un point de vue strictement anthropologique. Je ne pouvais pas l’aborder de façon théorique comme l’ont fait tous les grands stratèges, de Sunzi à Mao Tsé-toung, en passant par Machiavel, Guibert, Saxe ou Jomini. Je pense néanmoins que Clausewitz a parmi eux une place à part, car il se situe à la charnière de deux âges de la guerre, et témoigne d’une nouvelle situation faite à la violence : en ceci, son approche est beaucoup plus profonde, beaucoup moins technique que d’autres. C’est donc tout récemment que j’ai commencé à concevoir cette fin de la guerre comme un objet à part entière. Ce crépuscule d’une institution qui avait pour but de retenir et régler la violence, corrobore en effet mon hypothèse centrale, à savoir que nous assistons depuis environ trois siècles à un délitement de tous les rituels, de toutes les institutions. La guerre, par ses règles et ses codes, contribuait elle aussi à créer du sens en travaillant à de nouveaux équilibres, ceci sur une aire géographique de plus en plus large. Elle a cessé d’assurer ce rôle, disons grosso modo, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment ce jeu s’est-il soudain déréglé ? Comment la raison politique a-t-elle fini par devenir impuissante ? Voilà des questions qui vont nous intéresser au plus haut point.
Plus j’avançais dans la lecture du traité de Clausewitz, dont je me suis vite procuré la traduction française intégrale, plus j’ai été fasciné par le fait que c’était le drame du monde moderne qui se disait là, dans ces pages denses et parfois arides, où il n’est apparemment question que de théorie militaire. J’avais, bien sûr, parcouru le livre de Raymond Aron, Penser la guerre, Clausewitz1, quand il est paru à la fin des années 1970, mais j’étais alors trop absorbé dans mes propres recherches pour lui prêter vraiment attention. Je comprends maintenant que c’était aussi parce que la lecture rationaliste d’Aron me barrait l’entrée du texte de Clausewitz, qui dit tout autre chose que ce qu’Aron veut lui faire dire. Cet essai très brillant est marqué par son temps, on ne peut pas le lui reprocher ; disons, par l’époque de la guerre froide, où l’on croyait à la dissuasion nucléaire, au fait que la politique avait encore du sens. Elle n’en produit plus beaucoup aujourd’hui. C’est pourquoi je suis convaincu que nous sommes entrés dans une période où l’anthropologie va devenir un outil plus pertinent que les sciences politiques. Nous allons devoir changer radicalement notre interprétation des événements, cesser de penser en hommes des Lumières, envisager enfin la radicalité de la violence, et avec elle constituer un tout autre type de rationalité. Les événements l’exigent. C’est à cela qu’invite une lecture de Clausewitz aujourd’hui. D’autres viendront, je l’espère, pour continuer le chantier que je voudrais ouvrir par notre conversation.