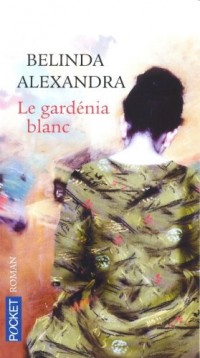Le gardénia blanc
Anya a grandi dans le cocon d'une petite communauté de Russes réfugiés en Chine. A la veille de ses 13 ans, la mort accidentelle de son père brise sa vie.
Alors que sa mère est déportée en URSS, Anya échappe de justesse à l'armée russe et s'enfuit à Shanghai. Elle y est recueillie par un ami de ses parents. Sulfureux patron d'une boite de nuit, ce riche protecteur lui offre une vie de luxe et d'artifices. La jeune Fille découvre la joie de s'habiller, de plaire et connaît, avec le séduisant Dimitri, ses premiers émois amoureux.
Grisée par sa nouvelle vie, Anya ne peut toutefois ignorer le vide profond laissé en elle par le départ de sa mère. Les bouleversements de l'Histoire lui laisseront-ils une chance de la retrouver ?
Extrait
Harbin, Chine
Selon nos croyances russes, quand un couteau tombe d'une table, ça veut dire qu'un visiteur mâle va venir, et si un oiseau entre dans une pièce, c'est que la mort est proche pour quelqu'un qui vous est cher. Ces événements se produisirent tous les deux en 1944, l'année précédant mon treizième anniversaire, mais aucun présage, aucun couteau tombé, aucun oiseau égaré n'était venu m'en avertir.
Le Général est apparu le dixième jour après la mort de mon père. Ma mère et moi étions occupées à retirer les tentures de soie noire dont nous avions recouvert les miroirs et les icônes pour les neuf jours de deuil. Le souvenir de ma mère à ce moment-là ne s'est jamais terni. La peau ivoire de son visage encadré par de fines bouclettes de cheveux noirs, les deux petites perles à ses oreilles et ses yeux étincelants couleur d'ambre composent encore une image parfaitement claire dans mon esprit : ma mère, veuve à trente-trois ans.
Je me souviens de ses longs doigts pliant le tissu sombre avec une lassitude qui ne lui était pas coutumière. Mais il est vrai que nous étions toutes les deux abasourdies par la disparition de mon père. Quand il avait quitté la maison ce matin fatal, j'étais loin de me douter que j'allais le revoir allongé dans un lourd cercueil en chêne, les yeux clos, le visage cireux déjà loin dans la mort. La partie inférieure de la bière était fermée, pour cacher ses jambes mutilées par la tôle broyée de la voiture.
La nuit où le corps de mon père fut déposé dans le salon, des bougies blanches entourant son cercueil, ma mère a verrouillé les portes du garage et les a condamnées avec une chaîne et un cadenas. Je la regardais depuis la fenêtre de ma chambre faire les cent pas devant le hangar, remuant les lèvres dans une incantation muette. Elle s'interrompait de temps en temps pour remettre ses cheveux derrière les oreilles comme si elle essayait d'entendre quelque chose, puis elle finissait par secouer la tête et reprenait ses allées et venues. Le lendemain matin, je me glissai dehors pour aller observer le cadenas et la chaîne. Je compris alors ce qu'elle avait voulu faire : elle avait retenu les portes du garage comme nous aurions retenu mon père si nous avions su que le laisser conduire sous la pluie battante signifiait le laisser partir pour toujours.
Dans les jours qui suivirent l'accident, notre affliction fut détournée par le flux constant des visites que nous rendaient nos amis russes et chinois. Ils allaient et venaient sans discontinuer, à pied ou en rickshaw, ayant délaissé leur ferme avoisinante ou leur maison de ville pour venir emplir notre demeure de l'arôme du poulet rôti et du murmure de leurs condoléances. Ceux de la campagne arrivaient les bras chargés de présents, du pain, des gâteaux ou des fleurs des champs ayant survécu aux premières gelées à Harbin, tandis que ceux de la ville nous apportaient de l'ivoire et de la soie, façon polie de nous donner de l'argent car, sans mon père, des temps difficiles nous attendaient, ma mère et moi.
Puis vint l'inhumation. Le prêtre, buriné et noueux comme un vieil arbre, traça un signe de croix dans l'air glacial avant que le couvercle fût cloué sur le cercueil. Les fossoyeurs, des Russes aux larges épaules, plantèrent leurs pelles dans le sol, jetant des mottes de terre gelées dans la tombe. Ils travaillèrent dur, la mâchoire serrée et les yeux baissés tandis que la sueur leur dégoulinait sur le front, par respect pour mon père ou pour gagner l'admiration de sa charmante veuve. Du début à la fin, nos voisins chinois se tinrent à distance respectueuse devant l'entrée du cimetière, compatissants mais considérant d'un oeil suspicieux notre coutume de mettre en terre nos êtres chers et de les abandonner à la merci des éléments.
Après quoi, le cortège funèbre nous raccompagna jusque chez nous, une maison en bois que mon père avait construite de ses propres mains après avoir fui la Russie et la révolution. Nous nous assîmes autour de gâteaux de semoule et du thé préparé dans le samovar. La maison n'était au départ qu'un petit bungalow avec un toit enduit de poix et des tuyaux de poêle qui dépassaient de l'auvent, mais après avoir épousé ma mère, mon père avait construit six nouvelles pièces et un étage qu'il avait remplis d'armoires laquées, de fauteuils antiques et de tapisseries. Il avait sculpté des châssis de fenêtres décorés, bâti une grosse cheminée et peint les murs du même jaune d'or que le palais d'été du tsar défunt. C'étaient les hommes comme mon père qui faisaient de Harbin ce qu'elle était : une ville chinoise pleine de Russes nobles exilés. Des gens qui tentaient de recréer leur monde perdu à grand renfort de sculptures sur glace et de bals hivernaux.