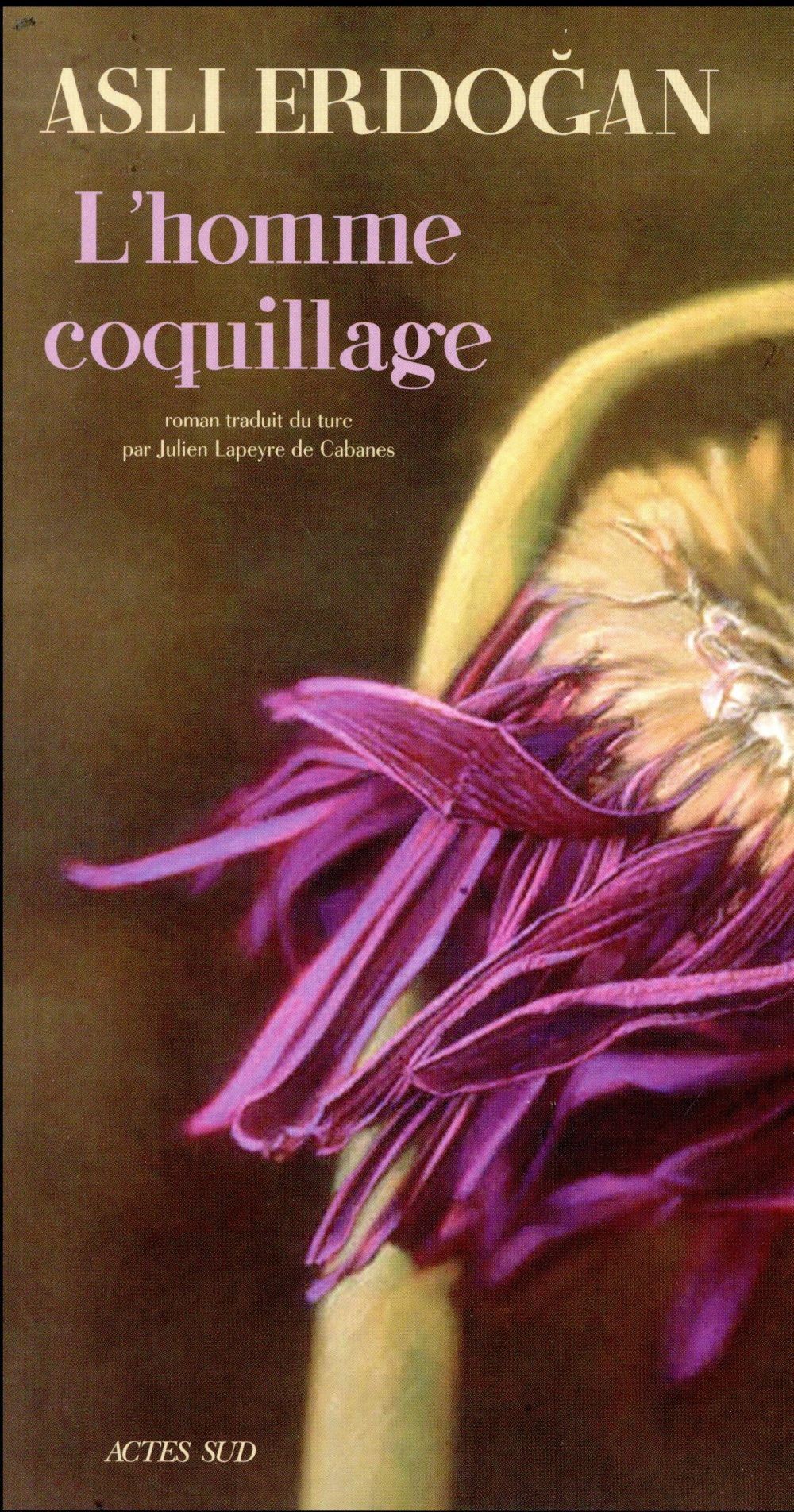L'homme coquillage
Une jeune chercheuse en physique nucléaire est invitée dans le cadre d'un séminaire aux Caraïbes. Très rapidement elle choisit d'échapper au groupe étriqué rassemblé dans un hôtel de luxe afin d'aller explorer les alentours en errant sur les plages encore sauvages et totalement désertes. C'est là qu'elle rencontre Tony, l'homme coquillage, un être au physique rugueux et quasi effrayant mais dont les cicatrices la fascinent immédiatement. Ce livre est le premier roman d'Asli Erdogan où déjà s'impose la force étrange de ses personnages féminins toujours penchés au bord de l'abîme, flirtant avec la mort et la terreur, toisant la peur.
La presse en parle
C’est une réflexion sur l’inégalité entre pays riches et pays pauvres, sur le racisme ordinaire, sur la contrition des occidentaux et le désir de revanche des anciens colonisés. Mais où se situent les Turcs sur cet échiquier de la souffrance ? C’est ce qu’Asli Erdogan tente de comprendre dans ce roman des occasions perdues.
Didier Jacob, L'Obs
Ce n’est pas racler les fonds de tiroirs que de sortir de premier roman d’Asli Erdogan de l’oubli. C’est lui offrir une juste lumière, mesurer sa clairvoyance, honorer sa ténacité, saluer son exigence. La sensibilité exacerbée, la détermination visionnaire, l’esprit de résistance : tout ce qui fera la valeur inestimable d’Asli Erdogan déjà contenu dans ce récit d’apprentissage autobiographique, implanté au fin fond des Caraïbes. Asli Erdogan a l’art de découper des scènes au scalpel, de les arracher du présent magnétique, pour les jauger ensuite avec un recul éclairé, et recevoir leur enseignement inépuisable. Cela s’appelle l’acuité au monde.
Marine Landrot, Télérama
Extrait
Je vais vous raconter l’histoire de l’Homme Coquillage, l’histoire d’une île tropicale, d’un amour éclos dans les marécages du crime, de la torture et de la violence, un amour aussi âpre que le terreau qui l’a vu naître. L’histoire d’une force qui rend fou, d’une passion faite des rêves les plus secrets et de désirs jamais assouvis, d’une amitié miraculeuse scellée aux frontières de la vie et de la mort, l’histoire de cette peur par où commencent tous les désastres, cette peur si représentative de l’être humain, et de sa lâcheté, sa solitude désespérée.
Sous les tropiques, sur cette île éloignée de tout, j’ai appris que l’enfer et le paradis ne font qu’un, que seul un assassin peut être prophète, et qu’un homme, comme dans les séances de magie noire, peut en devenir un autre, car le contraire absolu de l’homme, c’est encore lui-même.
Il s’est écoulé presque un an depuis cette histoire. Un soir de mars à Istanbul, assise auprès du poêle, je songe à la chaleur étou ante des tropiques, à l’incessant et triste balancement des palmiers, je songe à l’océan. L’océan versatile dont la colère millénaire fouette les récifs de corail. C’était la première fois que je le voyais, majestueux, inaccessible, plus grand encore que tout ce que je pouvais imaginer. La source d’une immensité aussi vaste que la vie elle-même. Un prophète, un assassin, un sorcier. Alors, à ce moment-là seulement où je me suis souvenue de l’océan, j’ai revu devant moi Tony, l’Homme Coquillage. L’Homme Coquillage, de petite taille, aux larges cicatrices et aux yeux très noirs. Puis tout dé le peu à peu dans mon esprit, les plages couvertes de palmiers, la jetée de bois à l’entrée du ghetto, les coquillages, le voyage jusqu’à la pointe aux cocotiers, ce voyage qui m’avait arrachée à moi-même pour m’emporter avec lui dans un monde interdit, à la rencontre d’un autre homme. La mort, la peur, l’horreur, le désir, la pluie, la danse, les eaux noires, le crime, les nuages de nuit, le désir. Et l’amour. Et la perte. Le couteau brillant à la lueur blême d’un feu de camp au milieu de la nuit.
L’Homme Coquillage qui m’a appris le chant de l’océan, Tony l’Homme Coquillage que j’ai aimé d’un amour profond, féroce et irréel.
L’été où j’ai rencontré Tony, j’étais au bout du rouleau. Depuis presque deux ans, je travaillais dans le plus grand laboratoire de physique nucléaire d’Europe. Pour mes collègues, ma famille, mes amis de Turquie (à dire vrai je n’en avais pas un seul), j’avais une situation enviable et digne d’éloges. J’avais accumulé les diplômes des meilleures écoles un peu comme on empile des serviettes, et réussi, alors très jeune, à vingt-cinq ans, à faire partie du premier contingent d’étudiants turcs acceptés en thèse dans ce gigantesque laboratoire où les femmes par ailleurs ne représentaient qu’une proportion d’à peine cinq pour cent de l’ensemble des chercheurs en physique. Comme j’avais fait de la danse classique pendant de nombreuses années, que j’avais publié des nouvelles dans de petites revues éphémères, et même remporté quelques prix littéraires, on avait dé ni ma personnalité comme “versatile”. À l’instar du tas de serviettes toujours, j’avais fini par devenir la somme de ces quelques réussites institutionnelles et de ces quelques traits personnels qu’il m’était possible de marchander auprès des autres. Quant à moi-même, incapable de me sortir de la dépression ni de m’attacher à aucune idée, croyance ou autre personne, j’étais quelqu’un de très seul, un être pessimiste et continuellement malheureux. J’avais depuis longtemps perdu l’enthousiasme de vivre, si tant est que je l’eusse jamais eu. Mon histoire personnelle n’avait à mes yeux qu’une seule et même tonalité : les désillusions. Mes années d’enfance, marquées par la violence et une pression familiale écrasante, expliquaient que j’eusse du monde une perception comparable à celle d’un champ de bataille où oppresseurs et opprimés luttaient sans fin, et c’était encore, me semble-t-il, la perception la moins malhonnête. On m’avait expliqué depuis ma plus tendre enfance que je connaîtrais l’amour – ou cette chose que l’on appelle “amour” – aussi longtemps que je serais intelligente et brillante scolairement, mais personne ne m’avait jamais enseigné comment y parvenir. Ceux qui étaient entrés dans ma vie s’étaient fait un devoir de me briser tout en me cajolant. (Par la suite je me suis faite à l’idée que c’était là une façon ordinaire qu’ont les hommes de traiter les femmes.) Et à cet âge-là, j’avais déjà fait le tour de toutes les maladies que les gens de constitution nerveuse attrapent au milieu de leur vie, colite, ulcères, asthme.
Pire encore, j’étais désespérée et aigrie comme une petite vieille qui sent venir la mort.
Le centre de recherche m’avait porté le coup fatal, comme la foudre abat sans peine un arbre déjà pourri de l’intérieur. La vaine fierté d’avoir été acceptée dans une telle institution s’était vite érodée, et il ne me restait pas d’autre choix que d’affronter la réalité. Cet endroit était, pour reprendre le jargon des physiciens eux-mêmes, un ghetto ou un monastère. De nous l’on attendait trois choses : travailler, travailler, travailler. Sans tomber malade, sans rien regretter, sans basculer dans la dépression, sans être amoureux, fonctionner sans accroc aussi parfaitement qu’un moteur d’avion. Sept jours par semaine, quatorze heures par jour, seize durant les périodes de tests ; rendre des rapports impeccables en vue de la prochaine réunion, faire des tours de garde enfermés dans des pièces minuscules et entièrement closes enfouies à cent mètres sous terre, passer ses lambeaux de nuits devant son ordinateur. J’avais beau être habituée à réviser des examens et à me consacrer pleinement à mon travail personnel, cet endroit me donnait l’impression d’être une paresseuse, une vraie tire-au-flanc. Quand bien même l’eussé-je voulu – et je ne le voulais pas – il m’eût été impossible de ressembler aux “super-cerveaux”, ces doctorants pleins d’ambition venus de Chine, du Japon ou d’Inde, qui ne faisaient que travailler comme des machines, ne lâchant leur ordinateur que le temps d’un sommeil forcé de trois ou quatre heures. Car l’existence ne m’était supportable qu’à certaines conditions : lire, écrire, danser de temps en temps, me perdre dans les rues. On me l’avait fait payer très cher, mon salaire avait été suspendu, ma carrière touchait déjà à sa fin.
Pour pouvoir survivre dans pareil endroit, il était nécessaire de n’avoir aucune passion, aucune relation en dehors du travail, il fallait apprendre à s’oublier soi-même, à négliger son corps, à réprimer la plupart de ses émotions. D’une manière ou d’une autre, chaque membre du laboratoire montrait des signes de délabrement psychique et d’immense solitude. Comme en prison, les relations humaines étaient limitées par un carcan de règles invisibles. Une ambition frénétique, l’espionnage, l’insensibilité, la paranoïa, l’insatisfaction sexuelle, l’alcoolisme généralisé, voire la schizophrénie. Un milieu putride. J’étais dans l’institution la plus productive mais aussi la plus inhumaine du genre humain, et telle une fleur plantée en mauvaise terre, je me desséchais à vue d’œil.
Maya, ma seule amie, résumait ainsi la situation : “En ces lieux, si en tournant la tête vous apercevez votre meilleur ami en train de se braquer un flingue sur la tempe, vous ne trouverez ni la force ni même l’envie d’intervenir.” J’ajoutais pour ma part : “Mais de toute façon, vous n’avez pas d’amis.” Nous avions en réalité beaucoup de chance, Maya et moi, d’avoir réussi à nouer et à maintenir une amitié extraordinaire. Maya était une folle, une écervelée, une Grecque, et même une vraie Grecque. Homère, les tragédies antiques, Cava s, la mer couleur de vin, tout ça vibrait dans ses grands yeux noirs. Elle récitait par cœur des vers de l’Iliade, de Macbeth et d’Omar Khayam. Elle parlait couramment trois langues et dans chacune d’elles savait écrire des poèmes d’une beauté stupé ante. Elle était très intelligente et sensible, qualités qui, lorsqu’elles sont réunies chez une femme, lui assurent de courir tout droit à la catastrophe. Depuis des années qu’on l’avait diagnostiquée “maniacodépressive”, Maya était obligée de suivre un traitement. De même que j’étais une ancienne ballerine, elle était peintre et débordait de talent. Elle aimait la physique, les poèmes, la danse, l’alcool, son chat, les hommes avec qui elle couchait, à la folie, passionnément, mortellement.