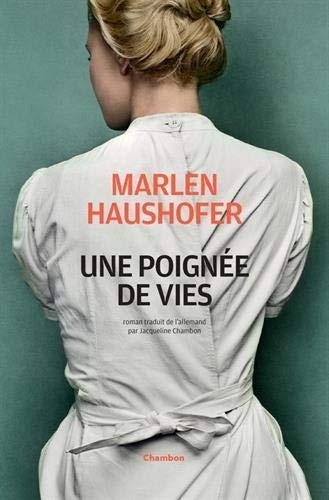Une poignée de vies
Deux décennies sont passées quand une femme revient dans la maison où elle a vécu avec sa famille, qu’elle a abandonnée pour vivre sa propre définition de la liberté. Elle ouvre une boîte qui la replonge dans son passé. Maintenant, et sans que celui-ci en soit conscient, elle est face à son fils…
Présentation de l'éditeur
1951, dans une petite ville d’Autriche. Deux décennies se sont écoulées lorsque Betty, que tout le monde croit morte, revient, incognito, dans la maison où elle a vécu avec sa famille. À l’invitation du jeune homme et de la belle-mère de ce dernier, qui l’accueillent et voient en elle un potentiel acquéreur, elle séjourne dans la chambre d’amis. Elle y trouve alors une boîte contenant de vieilles photos qui la replongent aussitôt dans son passé…
Publié en 1955, Une poignée de vies est le portrait incroyablement moderne, subtil et méticuleux d’une femme qui se sent depuis toujours prisonnière de la fascination qu’elle exerce et qui, ne parvenant pas à répondre aux attentions qu’on lui porte et que l’on attend d’elle en retour, se croit toxique. Fuir, et laisser derrière elle son mari aimant ainsi que son enfant, est le prix à payer pour survivre en obéissant au principe de liberté qu’elle place au-dessus de tout. Plutôt qu’un terne bonheur, une simple poignée de vies disséminées aux quatre vents.
Extrait
En mai 1951, dans une petite cité autrichienne, un certain Anton Pfluger mourut dans un accident de voiture. En se rendant en ville, sans raison apparente il rentra dans un arbre, avec pour conséquence une fracture du crâne et des blessures internes. Il ne reprit plus conscience. On supposa qu’il avait été pris d’un brusque malaise. Quelques jours avant, Anton Pfluger avait fêté son cinquantième anniversaire, sans doute avec quelques excès. Dans les semaines suivantes on s’aperçut que la situation financière qu’il avait laissée derrière lui n’était pas aussi bonne qu’on l’avait supposée.
La famille Pfluger possédait, depuis plusieurs générations, une petite fabrique de clous qu’on pensait prospère. Quand survint l’événement, son fils, qui se prénommait aussi Anton, mais qu’on appelait Toni, était un étudiant de vingt-deux ans. Sans ces études il aurait pu lui aussi vendre des clous, mais pour le prestige et parce qu’Anton souhaitait vivre dans la grande ville on lui avait permis de fréquenter l’université.
Ce jeune homme, qui ne s’intéressait pas le moins du monde au commerce, se retrouva soudain dans une situation difficile. Finalement il abandonna la direction de la fabrique au directeur adjoint qui s’était consacré aux clous depuis l’enfance et dont on pouvait espérer qu’il gérerait honnêtement l’entreprise. Quelques mois avant la mort du patron, sa fille s’était mariée et elle, ou peut-être son époux, exigeait de toucher sa part d’héritage.
Après avoir pris conseil et pour éviter une mesquine querelle de famille, Toni décida de vendre la fabrique de clous pour pouvoir payer sa part à sa sœur.
L’étonnant, dans cette affaire, fut que la veuve se rangea du côté de son beau-fils au lieu d’être du côté de sa propre fille. Toni Pfluger, en effet, était le fruit du premier mariage de son père avec une femme, qui s’était noyée dans la rivière à l’âge de vingt-cinq ans. Une année après cet accident, Anton Pfluger avait épousé la meilleure amie de sa femme ; il n’aurait pu donner une meilleure mère à son enfant.
Pour une raison quelconque, Mme Käthe Pfluger avait toujours préféré son beau-fils à sa fille.
Le père, toutefois, s’était beaucoup plus occupé de sa fille que de Toni qui, comme sa mère, avait un caractère difficile et entêté et montrait de l’attachement à sa belle-mère. Il ne repoussa jamais ses tendresses puis, en grandissant, se montra plein de galanterie et d’égards envers celle qui, par sa beauté, sa blondeur et sa douceur, séduisait tous les hommes.
Souvent, en parlant avec lui, elle retrouvait clairement cette distance que sa mère avait toujours conservée dans toutes ses amitiés. De cette mère, il avait hérité ce don de faire croire à son interlocuteur qu’on se confie à lui, alors qu’on lui cache l’essentiel.
Après leurs échanges, Käthe se sentait un peu oppressée. Elle caressait les cheveux dorés de son beau-fils et oubliait ses propres préoccupations en retrouvant les grands yeux gris de son amie dans le fin visage du garçon. Elle ignorait que le sentiment qu’elle éprouvait n’était autre que le mal du pays, mais elle avait appris à ne jamais y penser et se hâtait d’oublier une pensée déjà éprouvée, qu’elle avait toujours été incapable de s’expliquer.
Elle avait au moins préservé l’entente familiale, pensait-elle avec cette bienveillance qui lui avait permis de supporter l’humeur grincheuse de son mari et le caractère récalcitrant de sa fille.
À présent que son époux était mort et sa fille mariée, elle pouvait un peu se laisser aller. Plus personne n’était là pour lui dicter sa conduite. Elle pouvait manger les sucreries qu’elle aimait tant, rester chez elle en peignoir et, après le repas, s’allonger sur le divan avec un roman à l’eau de rose qui aurait provoqué les railleries de sa fille.
Le gentil Toni se gardait bien de la critiquer. Il lui apportait des fleurs et des confiseries et n’était pas irrité, à l’inverse de son père, lorsqu’elle invitait ses amies pour le goûter.
Il écoutait volontiers les derniers commérages, et faisait des remarques spirituelles et sans méchanceté ; elle trouvait donc qu’ils s’entendaient parfaitement.
Quand il lui proposa de licencier la bonne et de prendre à la place une femme de ménage, elle fut aussitôt d’accord. Elle se contenta de fermer les chambres inutilisées et de restreindre leur train de vie.
Quand elle lui avait demandé ce qu’il avait contre la bonne, Toni avait simplement répondu: «Elle dérange. »
Et Mme Käthe avait brusquement trouvé qu’il avait raison. Jamais elle n’aurait reconnu d’elle-même le léger désagrément qu’elle éprouvait parfois devant cette grosse face étrangère, mais depuis que Toni l’avait dit, cela lui sautait aux yeux.
Quand la bonne fut partie, il resta plus souvent à la maison. Elle l’entendait marcher dans sa chambre, puis il allait s’allonger au jardin, sous les arbres fruitiers, pour lire, rêver ou sommeiller.
Parfois il arrivait, l’aidait à dévider sa laine et divertissait ses amies, enchantées de sa présence, pendant un quart d’heure. Bref, il s’arrangeait pour que toutes l’envient d’avoir un tel beau-fils.
Toni lui proposa de vendre la maison et de louer un appartement en ville assez grand pour eux deux, et elle fut d’accord. La maison ne représentait rien pour elle, elle ne tenait qu’à une chose, ses habitudes : le café du matin, les bavardages, les romans, les sucreries et le cinéma une fois par semaine. Son corps plein et tendre irradiait le bien-être et le réclamait. Finalement Toni était la seule personne dont elle avait besoin pour son bonheur. Pour lui, elle aurait même renoncé à sa vie confortable sans hésiter, car il était, ou peut-être sa mère morte en lui, ce qui donnait à sa vie sa saveur et la minuscule et extrême nostalgie de l’inconnu.