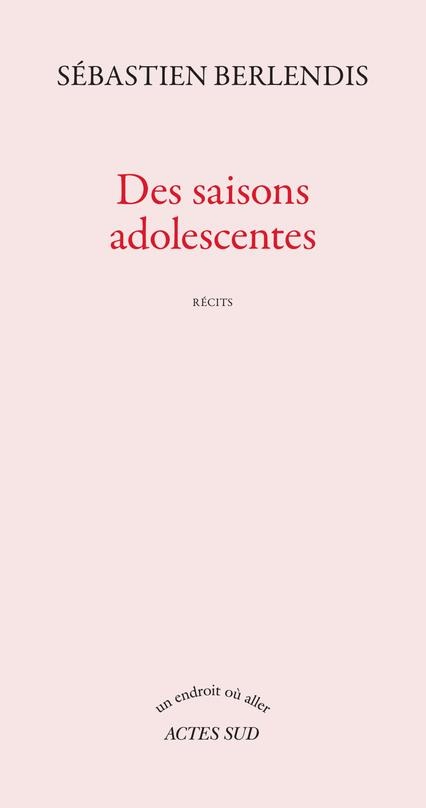Des saisons adolescentes
En classe de terminale, un professeur de philosophie propose à ses élèves de s’attacher au récit d’un seul souvenir ; de n’en choisir qu’un, comme si c’était le dernier, avant que tout ne disparaisse… Une trentaine de fragments, mélancoliques ou pleins d’ardeur, comme autant de séquences cinématographiques de ces états transitoires, qui forment le portrait sensible de l’adolescence.
Extrait
C’est un après-midi de mai dans un lycée de la périphérie lyonnaise. C’est jour de fête. Depuis des semaines, les élèves
réservent une partie de leurs heures libres à imaginer les déguisements, travailler les chorégraphies, définir le choix des musiques, inventer ce qui les rendra singuliers.
La veille, nous avons poursuivi un cours sur la question du temps, de sa possible maîtrise, de sa mémoire aussi. Une question qui, à première vue, en raison de leur âge et comme ils l’affirment en chœur, semble éloignée de leurs préoccupations premières.
Nous avons étudié un texte à la lisière de la philosophie et de la littérature. Pour expliquer notre rapport au temps, notre désir de le tenir, l’auteur prenait l’exemple de la photographie. L’image, écrit-il, ne se contente pas de cadrer un visage, un corps, elle n’enferme pas seulement un espace, un paysage, une chambre, elle cadre un temps, éternise un moment.
L’heure se termine, je demande aux élèves, sans préciser la raison, d’apporter pour le lendemain, outre leurs déguisements, leurs plus beaux papiers.
C’est un après-midi de mai et comme je le pressentais, personne n’est disposé à suivre un cours de philosophie. L’excitation de la fête anime toujours les corps, délie les langues, j’attends le silence, je prends la parole, j’évoque un texte argentin récemment mis en scène au théâtre. Je raconte l’histoire de ce jeune garçon qui perd la mémoire. Bientôt il ne pourra garder qu’un seul souvenir, dernier souvenir qu’il peut néanmoins choisir. Je propose aux élèves de se mettre à la place du jeune garçon et d’écrire sur leurs plus beaux papiers le souvenir qu’ils souhaiteraient conserver.
Très vite, la fête du matin s’éloigne, la demande provoque affolement, perplexité, enthousiasme. Je précise que le travail n’est pas obligatoire, je fais quelques remarques quant à la forme espérée, j’impose une écriture au présent. Alors que ses camarades ont déjà quitté la salle, une élève traîne, s’approche du bureau et me demande d’écrire également.
Depuis des semaines, la grisaille de la fin de l’hiver. Aujourd’hui, l’aube se lève tout à fait sur la colline de la Croix-Rousse. Fenêtres ouvertes dans la cuisine, les rideaux de gaze se froissent sous l’effet du vent, le soleil traverse les fleurs d’ajonc et dépose sur le mur une tache d’or.
Lorsqu’il quitte Lisbonne pour venir voir ses enfants, mon père habite l’appartement familial de la grande ville lyonnaise. Et ce matin les pièces gardent les traces des retrouvailles. Vaisselle en attente, tabac froid, cire de bougie sur les tables. Mon père dort, premier café bu trop vite, ma sœur à mes côtés attendra dix heures pour se réveiller, sa frange noire collée à ses yeux pleins de nuit. Je n’ai pas le temps, j’enfile les vêtements de la veille, ils traînent sur le parquet, j’écris un mot sur le ticket de caisse qui a déjà servi de liste de courses je rentre pour midi.
Je délaisse mes appareils numériques, j’emprunte le baladeur de mon père, je ne me lasse pas d’écouter les paroles toujours inédites de son chanteur préféré. Soleil et chaleur d’été, premiers bourgeons, odeurs de sucre, embouteillages de jour de marché, la colline me rappelle un vieux film espagnol.
Mes pas s’accordent à la musique, je prends aussi le rythme de la grande ville, je patiente devant le café où, malgré mes dix-sept ans, j’ai certaines habitudes ; je m’installe en terrasse, commande un deuxième expresso, double cette fois, et le sommeil disparaît en même temps que mon souffle se calme.
Un garçon, vingt-cinq ans environ, boucles brunes, un foulard de soie tombe sur son bras droit, nos tables se touchent, un garçon échange avec moi un regard rapide et doux, sous sa pommette gauche une petite fossette. Il porte une cigarette à sa bouche, ne l’allume pas tout de suite, gestes lents, réfléchis, gestes de pose qui, pourtant, ne gâchent pas mon plaisir. La tenue soignée contraste avec le désordre de ses cheveux. Je relève les miens, dégage mon cou, faible parfum d’amande, je sais que le soleil donne à mes yeux une couleur de noisette. Je l’observe, il m’observe, son regard glisse parfois sur les deux pans ouverts de ma robe rouge, la lumière tombe parfaitement dans le creux de sa nuque.
Nous continuons le jeu, personne n’osera un mot, midi approche, le disque tourne en boucle, délaissant les grands axes, j’ai pris la contre-allée, dit la chanson.