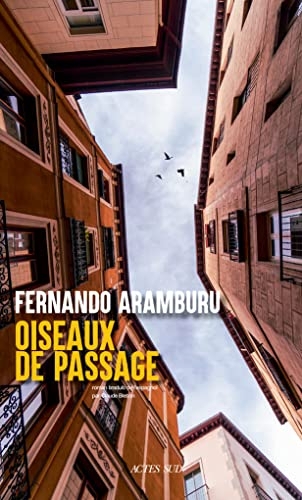Oiseaux de passage
Dotant un professeur de philo d'un stoïcisme féroce et joyeux, Fernando Aramburu donne à voir les vicissitudes d'un homme, apparemment sans qualités, qui entend mettre un terme à cette comédie tragique qu'est la vie. Pendant 365 jours, il consigne invariablement et sans filtre aucun les faits saillants de son existence : les rêves débridés et les petites misères d'un homme un peu dépassé par la marche du monde mais à la mauvaise foi inébranlable !
La presse en parle
Savoureuse évocation d’une époque triste, ce livre n’a rien d’édifiant ou de moralisateur. Il n’y est question ni de rédemption ni d’un soudain retour de flamme à l’égard de l’existence. Jusqu’à la pirouette finale, il se contente de dépeindre de façon désopilante une amitié inattendue entre Toni, Agueda et Patarsouille : trois quinquagénaires, fatigués ou abîmés, que les circonstances ont privé d’éclat comme de bonheur, et qui tentent de faire face ensemble à leurs insatisfactions. La plume goguenarde d’Aramburu en fait d’irrésistibles antihéros, de la trempe de ses personnages secondaires qu’on remarque au détour d’une page, et qui, à force d’être en marge de tout, finissent par prendre toute la lumière.
Ariane Singer, Le Monde des Livres
Le retour de Fernando Aramburu est magistral. Comme avec Patria, il confère à son œuvre un supplément d’âme. Miroir cruel de nos peines contemporaines, Oiseaux de passage n’est pas qu’un événement littéraire, c’est un phénomène philosophique et social, qui bouscule tous nos repères.
Léonard Desbrières, Le Parisien Week-end
Extrait
1. Un jour vient où, même si on est un empoté, on finit par comprendre des choses. Tel était mon cas au moment de l’adolescence, ou même un peu plus tard, car j’ai eu une croissance plutôt lente, et, à en croire Amalia, défectueuse.
La déception a succédé à l’étonnement, et depuis je traîne les pieds sur le sol de la vie. À une certaine époque, je m’identifiais aux limaces. Non parce qu’elles sont laides et visqueuses, ou parce que j’ai eu une sale journée, mais parce que ces bestioles ont une drôle de façon de se déplacer dans l’existence, caractérisée par l’indolence et la monotonie.
Je ne vais pas durer longtemps. Un an. Pourquoi un an ? Aucune idée. Mais c’est ma dernière limite. Amalia, à l’apogée de sa haine, me reprochait de n’avoir jamais mûri. Les femmes possédées par la rancœur ont coutume de cracher ce genre d’insultes. Ma mère, elle aussi, détestait mon père, ce que je comprends. Lui aussi se détestait, d’où sa propension à la violence. Ils nous ont donné un drôle d’exemple, à mon frère et à moi-même ! Ils salopent notre éducation, ils nous brisent intérieurement et espèrent qu’ensuite on sera droits, reconnaissants, affectueux, épanouis.
La vie ne me plaît pas. Si belle qu’elle soit, selon certains chanteurs et certains poètes, elle ne me plaît pas. Qu’on ne vienne pas me chanter les beautés des couchers de soleil, de la musique ou des rayures du tigre. Tous ces décors, aux chiottes ! Je trouve que la vie est une invention perverse, mal conçue et encore plus mal réalisée. J’aimerais beaucoup que Dieu existe pour lui demander des comptes. Pour lui dire en face ce qu’il est : un bon à rien. Dieu doit être un vieux beau qui, du haut de ses sommets cosmiques, passe son temps à contempler les espèces qui s’accouplent, s’affrontent et s’entredévorent. La seule excuse de Dieu, c’est qu’il n’existe pas. Et malgré cela, je lui refuse l’absolution.
Quand j’étais petit, j’aimais la vie. Je l’aimais beaucoup, même si je ne m’en rendais pas compte. Le soir, à peine couché, maman m’embrassait sur les paupières avant d’éteindre. Ce que je préférais chez ma mère, c’était son odeur. Mon père sentait mauvais. Pas mauvais au sens pestilentiel du terme, mais il se dégageait de lui, même quand il s’arrosait de parfum, une odeur qui déclenchait chez moi un rejet instinctif. Un jour où ma mère était clouée au lit par une de ses migraines, mon père, à la cuisine (je devais avoir sept ou huit ans), voyant que je refusais de manger ma tranche de foie et que j’avais des haut-le-cœur rien que de la regarder, sortit son énorme pénis et me dit, furibond : “Pour en avoir un comme ça un jour, tu vas devoir en bouffer, du foie.” Je ne sais pas s’il a fait pareil avec mon frère, beaucoup plus choyé que moi. Il semblerait que mes parents le trouvaient fragile. Lui n’est pas de cet avis, il considère que c’était moi le chouchou.
En grandissant, la vie a commencé à beaucoup moins me plaire, mais elle me plaisait encore. Maintenant, elle ne me plaît plus du tout, et je n’ai pas l’intention de déléguer à la nature le choix de l’heure à laquelle je devrai rendre les atomes que je lui ai empruntés. J’ai prévu de me suicider dans un an. J’ai même fixé la date : le mercredi 31 juillet au soir. C’est le délai que je m’accorde pour mettre mes affaires en ordre et comprendre pourquoi je ne veux pas rester en vie. J’espère que ma détermination est ferme. Pour le moment, elle l’est.
À certaines époques, je voulais être un homme au service d’un idéal, en pure perte. Il ne m’a pas été donné non plus de connaître l’amour véritable. J’ai feint avec habileté, parfois par compassion, parfois pour recevoir en récompense des mots aimables, un peu de compagnie ou un orgasme, à l’image, semble-t-il, de ce que faisaient et font les autres. Lors de l’épisode de la tranche de foie, mon père a peut-être voulu me manifester son amour. Le problème, c’est qu’il y a des choses qu’on ne comprend pas, parce qu’on ne les perçoit pas, même si elles sont là, et parce que l’amour imposé par la force, ça ne me convient pas. Suis-je un pauvre type, comme le répétait Amalia ? D’ailleurs, qui ne l’est pas ? L’ennui, c’est que je ne m’accepte pas comme je suis. Je n’aurai aucun regret à quitter ce monde. J’ai encore un visage avenant, en dépit de mes cinquante-quatre ans, et quelques qualités dont j’ai su tirer parti. J’ai la santé, je gagne bien ma vie, j’ai un accès facile à la sérénité. Peut-être m’a-t-il manqué une guerre, comme à papa. Lequel compensait son désir inassouvi de combattre en exerçant sa violence sur les siens, sur tout ce qui pouvait perturber son rythme vital et sa personne. Encore un pauvre type.