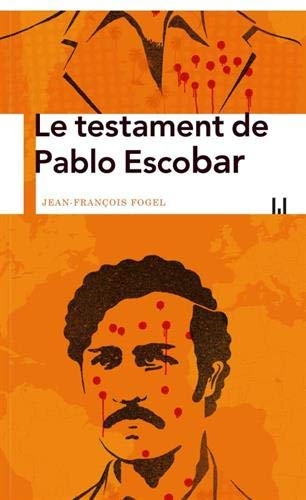Le testament de Pablo Escobar
Pablo Escobar représente la figure incarnée du mal. Le patron du cartel de Medellin a fait fortune en contrôlant la production de cocaïne dans le monde, usant de toutes les violences. Lorsqu’il fut abattu, en décembre 1993, on lui imputait plusieurs milliers de morts.
Ce qu’il possède de monstrueux témoigne d’un désarroi de l’univers hispano-américain. Dans le destin d’un criminel hors pair apparaissent le poids du passé, l’ombre des États-Unis, les difficultés des plus pauvres, l’inertie de la violence, le romanesque des caudillos, l’État fiction. Escobar est un homme qui raconte, comme Bolivar, comme les héros de Gabriel Garcia Marquez, un continent éloigné du monde.
Extrait
Cette fois, il n’a eu que le temps de mourir. Son unique garde du corps abattu d’entrée au rez-de-chaussée, une cachette hors d’atteinte au premier étage, son seul recours restait une fuite impossible par une fenêtre du deuxième étage. « Pablo ! Pablo ! Va-t’en ! », a crié une femme avant qu’il saute, pieds nus, sur le toit où une rafale de mitraillette l’a cueilli. Pablo Escobar, assassin, trafiquant de drogue, est décédé le 2 décembre 1993, à 15 h 06, dans le quartier La America, à Medellín, de 7 balles tirées par les membres d’un commando de 17 hommes venus l’arrêter plutôt mort que vif.
« Pour les Européens, affirme un personnage du romancier Gabriel Garcia Marquez, l’Amérique latine, c’est un homme avec une moustache, une guitare et un revolver. » Jusqu’au bout, Escobar a servi ce portrait-robot du bandit inspiré et violent ; l’ajout d’une barbe, l’absence de la guitare - il n’avait qu’un revolver 9 mm en main -, à l’instant de son dernier soupir, sont dus aux difficultés endurées par un prisonnier évadé depuis quatre cent quatre-vingt-dix-huit jours et contraint de se protéger avec un déguisement et des armes. Quant au reste, les photos de son cadavre ensanglanté montrent l’expression distante et sereine qui l’habita durant la décennie où il tint le rôle le plus en vue dans la plus cruelle des organisations criminelles, le « cartel de Medellín », producteur et distributeur de l’essentiel de la cocaïne dans le monde.
Telle une publicité, son visage revenait sans cesse sur les écrans de la télévision colombienne : des yeux noirs, petits, rapprochés, un regard minéral sur un nez droit et des lèvres minces. Un physique si commun - taille moyenne, chevelure sombre - qu’il était impossible de citer le moindre signe particulier aux Colombiens invités à le dénoncer. « On recherche Pablo Emilio Escobar Gaviria, demandé par la justice. À quiconque fournit un renseignement permettant sa capture, le gouvernement national offre comme récompense… » ; le temps aidant, ce montant atteint un milliard de pesos (7,8 millions de dollars), soit, nota un implacable observateur, cent cinquante et une années de traitement du Président du pays.
Pour valoir autant, il ne suffit pas de produire et d’acheminer de la cocaïne - même par centaines de tonnes. Et la pratique de l’assassinat ne suffit pas davantage à provoquer un tel intérêt - bien qu’en ce domaine il faille compter les victimes par milliers. Non, ce qui a fait le prix d’Escobar, au sens où se fait la cote d’une action, à la bourse du crime, c’est la brutalité qu’il finit par mettre dans tout ce qu’il entreprenait. Cet autocrate de la pire des mafias, ce capitaine d’industrie, chef d’armée, stratège géopolitique et desperado au service de sa seule cause, était avant tout un praticien de la violence. Un aventurier cynique dans l’action et capable d’une indifférence résolue à l’heure d’endurer des coups. Sa carrière et sa vie se sont fondues dans un déferlement de meurtres et d’actes de terrorisme hors de proportion avec toute destinée. Cela m’était apparu avec une sorte de férocité lumineuse, un matin de janvier 1988, en découvrant le désordre du quartier de Sainte-Marie-des-Anges, à El Poblado, où une voiture piégée - la première de l’histoire de Medellín - venait d’exploser devant un de ses domiciles.
C’était un immeuble sobre, blanc avec des balcons cernant chacun des huit étages : le Monaco. L’attentat en avait fait l’équivalent d’un séchoir à maïs ouvert à tous vents avec, pareille à un drapeau flottant au plus haut, la toile déchirée d’une escarpolette. Les huisseries de plus d’un demi-millier de villas à l’entour étaient descellées ; les tuiles romaines chahutaient sur tous les toits jusqu’à cinq cents mètres du cratère creusé par l’explosion. Des feuilles d’arbres hachées menu et des aiguilles de pin arrachées par le souffle formaient un tapis continu sur le sol des rues. Dans ce faubourg cossu de Medellín, ce désordre était, plus encore qu’un attentat, la proclamation d’un excès. Il y avait trop d’explosif utilisé contre une seule personne pour qu’elle-même ne soit pas trop puissante, trop riche, trop dangereuse.
La police estimait la charge à vingt kilos de dynamite, soit cinq fois moins que ce que contenait le camion piégé utilisé pour l’attentat contre le quotidien El Espectador à Bogotá. Là, c’était en septembre 1989, et depuis le hublot de l’avion qui, à ce moment précis, m’emmenait prendre des nouvelles d’Escobar, on voyait à travers la nuée de poussière que le grand bâtiment industriel, abritant rédaction, administration et imprimerie, n’était plus d’équerre. Les rouleaux de papier pour les rotatives restaient stockés à ciel ouvert. La façade était éventrée. Les abords, persillés de débris, ressemblaient à une plage de galets.