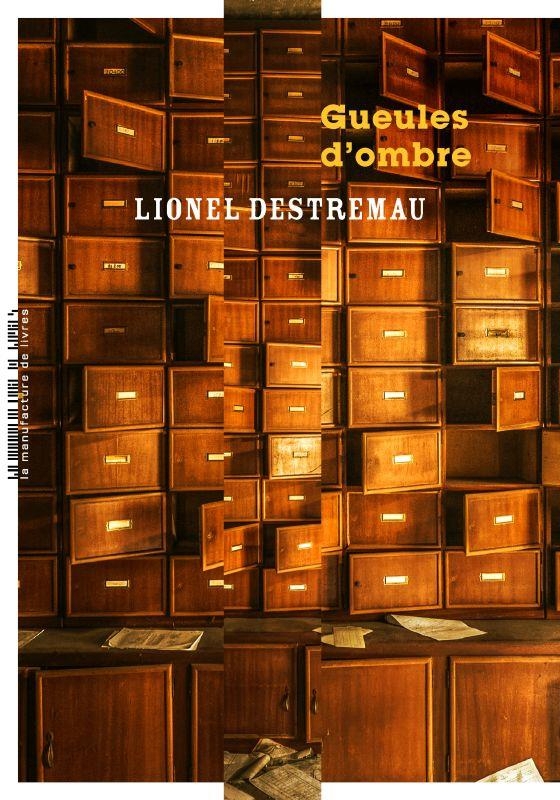Gueules d'ombre
À Caréna, l’enquêteur Siriem Plant est chargé par le Ministère des Anciens combattants de découvrir l’identité d’un mystérieux soldat plongé dans le coma. On ne sait d’où vient cet homme, quelle fut son histoire, ni même si le nom qu’il utilise, Carlus Turnay, est bien le sien. Et pourtant, des familles se bousculent pour reconnaître en lui un proche disparu. Plant n’a d’autre choix que de chercher des témoins parmi les anciens frères d’armes de l’inconnu. Mais les survivants ne sont pas légion et il devra arpenter les routes pour rencontrer celles qui attendaient le retour de ces gueules d’ombre aujourd’hui disparues - épouses, amantes, mères, sœurs... De femme en femme, il lui faudra reconstituer le puzzle de l’énigmatique Carlus Turnay.
Au fil de cette enquête insolite menée dans les décombres d’un pays fictif, Lionel Destremau impose, dès ce premier roman, son univers littéraire unique.
Extrait
Le froid envahissait tout. Je ne parvenais à chauffer l’appartement qu’entre deux coupures d’électricité. De temps à autre, je réussissais à récupérer un peu de bois que je brûlais dans la cheminée du salon, seul endroit où je réussissais à glaner un peu de chaleur. Je m’endormais alors sans avoir recours au vin, bercé par la moiteur ambiante. Ce matin-là, le voyant rouge des radiateurs était éteint, la centrale électrique avait dû effectuer de nouvelles réparations durant la nuit. Quand j’ouvris les yeux, la première chose que je vis fut le petit nuage de vapeur que mon haleine formait. Je sautai du lit, enfilai pantalon et chaussures, et je me réfugiai dans la cuisine. Dans ces moments-là, j’allumais tous les brûleurs de la gazinière pour attiédir un peu la pièce et le chat finissait par me rejoindre et se pelotonner sur une chaise. Alors que l’eau du café s’était mise à bouillir, quelqu’un sonna à la porte. Je n’attendais personne et il était encore tôt. À la seconde sonnerie, estimant que cela ne pouvait pas être une erreur, j’ouvris. Une estafette à demi frigorifiée s’impatientait et trépignait sur le palier. Sans un mot, il me tendit un pli et un stylo, me montrant, du bout du doigt dépassant de ses mitaines, où je devais signer, puis il descendit les marches au galop. Je regardai brièvement l’enveloppe et retournai dans la cuisine. Je décachetai, vis l’en-tête du courrier : la journée commençait mal.
À cette époque, recevoir une lettre du ministère des Anciens combattants n’était pas une aubaine. Tout en sirotant mon café, je relus ce qui n’était qu’une sorte de convocation mentionnant l’heure et le bureau où je devais me présenter. Je me demandais ce qu’ils me voulaient. Ça ne serait pas la première fois qu’un ancien combattant se retrouverait menotté à l’issue de ce genre de rendez-vous. La guerre était terminée depuis plus d’un an, mais la suspicion régnait encore dans tous les ministères. On voyait des espions partout, et je n’étais pas certain que parmi ceux qu’on avait arrêtés, tous faisaient partie de la fameuse cinquième colonne dont les journaux ne cessaient de nous rebattre les oreilles. Le moindre lien de parenté avec notre ancien ennemi, même au dixième degré, entachait votre bonne foi auprès d’un administrateur un peu trop zélé… J’espérais ne pas tomber sur un de ceux-là, mais je n’avais guère d’autre choix que de m’y rendre. Je tournai lentement ma cuillère dans le jus noir, en pensant vaguement à mon arrière-grand-mère qui n’avait jamais rien eu à se reprocher, sinon d’avoir épousé un frontalier. Je finis d’avaler mon café, déposai ma tasse dans l’évier, y laissai couler un peu d’eau en observant le gel qui gagnait les rebords du vasistas de la cuisine. Je tentai, en vain, de me remémorer le visage de cette arrière-grand-mère que j’avais croisée enfant et qui me parlait dans une langue inconnue. J’enfilai un pull et mon manteau, déposai quelques boulettes dans la gamelle du chat et me résignai à aller attendre le bus. Prendre un métro eût été bien plus commode, mais depuis qu’une bonne partie du réseau de la capitale était écroulé ou inondé, seules deux lignes restaient en activité. Et aucune de ces deux-là n’était proche de chez moi. J’attendis le bus vingt minutes, ce qui me permit de piquer une cigarette à un passant, de la savourer lentement, et quand je montai enfin à l’intérieur, j’avais les doigts engourdis et glacés.
Malgré les rues à demi dévastées et les ruines qui jonchaient les quartiers périphériques comme le mien, le centre de Caréna n’avait pas trop souffert. Quelques façades délabrées à droite et à gauche, un ou deux tas de gravats et de pierres là où s’élevaient autrefois des blocs administratifs. Mais pour l’essentiel, les grands immeubles bourgeois qui bordaient les avenues étaient intacts. Des drapeaux flottaient un peu partout aux balcons. Des lampions et des guirlandes de Noël pendaient aux arbres dénudés par l’hiver. Tout le monde semblait vouloir vivre comme si de rien n’était. Un sentiment ambigu s’emparait de moi, partagé entre deux émotions, deux réflexions, deux formes de lassitude aussi. Il y avait eu une guerre. Pour ceux qui ne l’avaient pas faite, il fallait oublier, passer à autre chose, aller de l’avant. C’était ce que le gouvernement clamait haut et fort. Je ne lui en voulais pas. Au fond, il avait raison : on devait bien se remettre sur pied d’une manière ou d’une autre. Mais cette même phrase ne cessait justement de me hanter : il y avait eu une guerre. On ne pouvait pas l’effacer d’un coup de chiffon. Et puis, on avait creusé bien loin dans l’horreur aussi, y prenant un malin plaisir. Jusque-là, nous nous considérions comme une nation civilisée, moderne. La guerre, comme tout le monde je l’avais déjà vue, de loin, sur un écran. Des films à grand spectacle, bourrés de héros et de bons sentiments, avec juste ce qu’il fallait de sang pour qu’on y croie. J’en avais lu des récits, dans les livres d’histoire, à l’école. Et ça ne m’avait pas empêché, des années plus tard, de prendre un fusil d’assaut ou de serrer un couteau dans ma main. Après tout, à l’heure du nucléaire, on continuait bien à se massacrer à coups de machettes et de lances dans certains pays. Alors, ça avait été notre tour d’avoir un nouveau quart d’heure de sauvagerie. Les livres d’histoire n’avaient servi à rien. On pouvait voir ça comme un terrible retour en arrière ou comme un simple hoquet dans l’évolution… ; l’homme incapable de sauter le pas, de dépasser sa propre violence, malgré sa science et ses progrès. N’étions-nous pas restés, sans le savoir, de « bons sauvages », rentrés dans le rang de la civilisation mais en apparence seulement ?… À voir tous les préparatifs de Noël dans les rues de Caréna, à écouter les discours et autres déclarations publiques des politiques, on pouvait s’interroger sur la capacité d’autocritique de notre belle nation. On était déjà passé à autre chose. Plus personne n’en avait rien à foutre des tas d’os qui pourrissaient encore au fond des charniers et des fosses communes. Et personne ne s’intéressait non plus à mes interrogations existentielles, sinon quelques intellos dont je ne comprenais pas la moitié des articles publiés dans la presse.