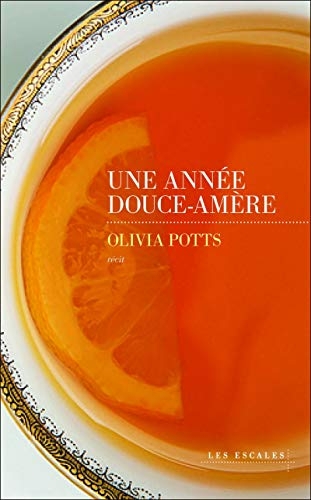Une année douce-amère
Comment le deuil, l’amour et la pâtisserie m’ont fait passer des salles d’audience au Cordon Bleu
Olivia Potts est une cheffe et une rédactrice culinaire anglaise réputée. Après avoir été avocate pénaliste durant cinq ans, elle a abandonné le barreau pour l’école du Cordon Bleu. Une année douce-amère est son premier ouvrage.
Présentation de l'éditeur
À la mort de sa mère, Olivia Potts, dévastée, décide de noyer son chagrin en confectionnant des pâtisseries. Avocate, elle rentre du travail épuisée puis se met aux fourneaux, prépare des banana breads et autres douceurs, y consacre tout son temps libre. Si ses gâteaux et ses crèmes anglaises sont bien souvent ratés, la cuisine lui offre un refuge et prend peu à peu une autre dimension. Et si cela devenait un moyen de construire une nouvelle vie, de donner du sens à son existence sans sa mère ?
Olivia concocte alors un plan, imagine un futur loin des magistrats et plus près des macarons. Elle quitte le barreau, s’inscrit au diplôme de pâtisserie du Cordon Bleu et plonge la tête la première dans le monde de la pâtisserie, de ses défis, ses frustrations et ses récompenses.
Truffé de recettes exquises, Une année douce-amère est un bijou d’humour et d’émotion, mais aussi un questionnement sur le deuil et les différentes formes qu’il peut prendre.
Extrait
Quand meurt un de nos proches, il se passe une chose étrange. Ce que l’on était en train de faire sur le moment prend une résonance particulière. On regardait peut‐être un épisode d’Emmerdale, on allait à un cours de Pilates, ou on achetait une certaine marque de biscuits au chocolat.
L’occupation n’a rien de forcément remarquable ; et de fait, le plus souvent, elle ne l’est pas. La mort a le chic de surgir aux moments les plus anodins. Mais ces moments composent l’essentiel de notre existence. Et donc, sans le vouloir, nous finissons par retourner à cette occupation, et par revivre le moment de cette mort, encore et encore. Emmerdale devient plus dur à regarder ; le Pilates perd de son attrait. Avec le temps, le chagrin s’atténue, ne nous fait plus l’effet d’un coup de poignard suffocant, mais d’une douleur sourde ; il cesse de se dresser face à nous, de nous boucher la vue, mais nous suit à un pas de distance, pré‐ sent, notable, mais banal. Et les biscuits ? Ils nous feront toujours revivre ce moment, avec une force à couper le souffle, à briser le cœur.
Il est raisonnable, dans ces conditions, de faire de son mieux pour éviter de se livrer à cette occupation. De résoudre le problème par la fuite, la plus précipitée pos‐ sible. Coronation Street provoque le même picotement de plaisir qu’Emmerdale ; personne n’aime vraiment le Pilates, de toute façon. Et ce ne sont pas les différentes sortes de biscuits qui manquent. L’ennui, c’est lorsqu’on s’aperçoit, non sans surprise, que l’occupation contaminée est précisément celle à laquelle on veut se livrer jusqu’à la fin de ses jours.
Quand ma mère est morte, je faisais la cuisine. Je n’étais pas très douée. En général, je ne cuisinais pas. Je man‐ geais des sandwichs de quelque chaîne de magasins milieu de gamme, des raviolis de supermarché et plus de kebabs à emporter que je ne voulais bien l’admettre. Mes rares incursions accidentelles dans une cuisine avaient eu pour résultat des cakes avachis, des biscuits brûlés et des ragoûts filandreux. Mais je sortais avec un homme depuis peu – un homme qui adorait faire la cuisine, et que j’adorais impressionner. Un week‐end, il a proposé que nous pré‐ parions quelque chose ensemble pour des amis. J’ai pensé, Oh, non, c’est une très mauvaise idée. Mais je lui ai dit, « Quelle bonne idée ! » Et je me suis retrouvée dans une cuisine qui n’était pas la mienne, à préparer un gâteau aux côtés d’un homme que je ne connaissais pas.
Pendant ce temps, à 450 kilomètres de là, ma mère était mourante.
J’avais discuté avec elle au téléphone, un peu plus tôt dans la journée. Je lui avais parlé de cet homme, et des défauts qu’il me semblait avoir : il n’était pas sûr de vouloir des enfants, était récemment redevenu végétarien, détail que j’avais inexplicablement pris comme un affront. « Ne t’en fais pas, ma chérie », avait répondu maman. « Fais‐le venir à la maison pour lui présenter ta mère : je parlerai de tes hanches faites pour porter des enfants et lui prépa‐ rerai ma tourte du berger. Ça lui éclaircira les idées. Quand j’ai rencontré ton père, il portait un costume de velours bleu. Tout peut changer », avait‐elle conclu. J’avais ri et lui avais dit que ça ferait une bonne histoire à raconter si nous venions à nous marier. Elle avait bâillé et on s’était dit au revoir.
Je ne savais pas encore ce que je finirais par savoir seize heures plus tard : que ce bâillement sonnait le glas de ma mère, était son chant du cygne ; ce bâillement – si commun, si banal – indiquait qu’elle manquait d’oxygène. Signifiait qu’elle était mourante. Plus tard, je me repasserais cette conversation, ce bâillement, encore et encore. Son corps se préparait déjà pour ce qui allait arriver au cours des heures suivantes. Égoïstement, je ne lui avais pas demandé comment ça allait, mais lui avais promis de l’appeler le len‐ demain pour procéder à une dissection en règle du dîner. L’ironie de l’expression ne me viendrait qu’après coup.
Ma mère était à 450 kilomètres de là, et elle était mourante, mais ça, je l’ignorais. Alors j’ai bu, et j’ai ri, et j’ai fièrement servi le gâteau que j’avais préparé pour l’occasion – aux clémentines et aux amandes, le seul dont je connaissais la recette. Pompette, j’ai fait la vaisselle à moitié. L’homme qui n’était pas encore mon compagnon l’a refaite plus tard, sans commenter la piètre qualité du travail original, dans ce silence propre aux couples qui n’en ont pas encore officiellement le statut. J’avais fait la vaisselle à moitié, puis m’étais glissée dans un lit qui n’était pas le mien. Et à 450 kilomètres de là, ma mère était morte.