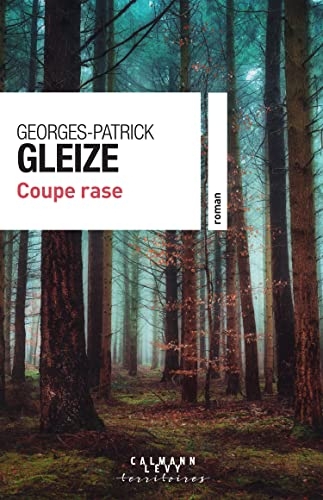Coupe rase
De sombres secrets hantent les forêts de Haute-Corrèze Quand Mathieu Champeix, militant écologiste médiatique, est découvert assassiné dans un bois de Mauriac-le-Vieux en Haute- Corrèze, une question est sur toutes les lèvres : quels intérêts ce trublion était-il venu déranger ?
Tandis que l'enquête de la gendarmerie piétine, Valérie Lafarge, journaliste dans un grand hebdo parisien, est envoyée sur place pour traiter l'affaire. Elle prend pension dans la maison d'hôtes de Monique Belcour. Selon Monique, Champeix s'intéressait à une histoire de coupe sauvage d'arbres séculaires au détriment de petits propriétaires forestiers.
Valérie cherche à en savoir plus auprès des habitants du bourg, mais c'est peu dire que sa curiosité est mal accueillie. Elle se sent observée, peut-être même suivie... Jusqu'au traquenard sinistre qui lui fait comprendre qu'à force de poser des questions, elle joue, elle aussi, sa peau...
À ses risques et périls, Valérie s'obstine. Qui fait régner la loi du silence à Mauriac ? Et pourquoi ?
Extrait
Macabre découverte
Le jour, blême et fade, tardait à s’affirmer comme s’il avait peur d’entrer sur le théâtre de la vie. La nature s’ébrouait de sa dernière averse. Un maigre rayon de soleil, chargé d’une insipide luminosité, perçait, entre deux cumulus ventrus, le ciel du Limousin d’une lumière matinale pisseuse. Le sentier grossièrement empierré, aux bas-côtés peuplés d’herbes folles, ondoyait entre deux haies d’aubépine qui frémissaient au vent de mai. Dans la grisaille humide et poisseuse, le labyrinthe de fleurs blanches constituait la seule note qui venait apporter une touche de gaieté dans la tristesse du matin. Par endroits, le chemin s’élargissait. Il se creusait alors de grandes ornières qu’une eau noire remplissait à n’en permettre de juger la profondeur. Malheur à celui dont le pied plongeait dans l’eau boueuse ! La chaussure, trempée d’eau saumâtre et glacée, lui garantissait un bon refroidissement.
Un floc sonore vint briser le silence du chemin. Dans le fossé herbeux où stagnait en permanence une dizaine de centimètres d’eau fétide, pressentant l’imminence d’un danger, une grenouille venait subrepticement de passer de son poste de chasse à une retraite plus sûre.
Au tournant en épingle à cheveux, une cascade de rires jaillit, précédant l’intrusion d’un groupe de sept promeneurs. Équipés de K-way aux couleurs vives, chaussés de brodequins dernier cri achetés à Decathlon, chacun un moderne bâton télescopique de marche à la main, ils avançaient d’un bon pas, le sac à dos à l’épaule, dans la fraîcheur matinale, nimbés du voile de leur transpiration. À les observer de plus près, les cheveux gris coupés court qui émergeaient des casquettes de toile couvrant leur tête identifiaient à coup sûr un groupe de jeunes retraités, fervents adeptes des sports de plein air en vogue chez les baby-boomers. Le pied aguerri, ils évitaient d’instinct les chausse-trappes du chemin, témoignant d’un professionnalisme que seule confère une pratique régulière.
Les trois hommes et les quatre femmes, tous membres du club des aînés, partageaient de longue date cette passion champêtre qui se nourrissait d’une amitié née soixante ans plus tôt, à l’orée des sixties, sur les bancs de la communale. Paul Astruc, Henri Dumas, Michel Vialhe, leurs épouses respectives Nicole, Annie, Catherine, et Danièle ne s’étaient jamais vraiment quittés. Ils avaient simplement évolué côte à côte, conjuguant les plaisirs et les aléas de la vie. Passant de la cour de récréation de l’école où les garçons tiraient les couettes des filles à la promenade sentimentale, main dans la main, dans le jardin public ; ils avaient construit ensemble leurs couples, faisant carrière les uns dans l’Éducation nationale, la banque et les PTT, les autres au Crédit agricole ou à l’Office national des forêts et continuaient à partager, les enfants ayant quitté le nid familial, le plaisir d’être réunis.
Depuis longtemps, blasés par l’actualité, gavés de ces infos qui passaient en boucle à la télé et à la radio, ils avaient délaissé les stériles conversations politiques style café du commerce où personne ne parvenait à imposer son point de vue, pour bavarder plus utilement sur le programme de leur prochain voyage avec le club du troisième âge, la meilleure façon de faire cuire une tête de veau ou les avantages comparés de la permaculture. Loin des combats politiques des forces militantes côtoyées dans leurs jeunes années, à la soixantaine rayonnante, ils cherchaient simplement à jouir du temps qui passe en bons épicuriens. Désormais ils se délectaient modestement de la lumière d’un lever de soleil sur les Monédières1 ou du bruit cristallin des cascades de Gimel2, ce beau site naturel qui, à douze kilomètres de Tulle, offre trois chutes successives sur le cours de la Montane, décrit par Abel Hugo, le frère de Victor, dans son ouvrage La France pittoresque, en 1883.
— Et au fait… L’autre jour à Limoges, demanda Henri à Paul, tu as déjeuné où finalement ?
— Au Marrakech, rue Léonard-Limosin.
— Encore !
— Pourquoi encore ?
— Parce qu’il me semble que vous y allez souvent avec Nicole.
— Pas plus d’une fois ou deux par an ! Quand nous allons voir son parrain.
— Celui qui est général de gendarmerie ?
— Celui-là même.
— Il se tient encore bien pour son âge ?
— Un peu d’arthrose, comme beaucoup de sa génération.
— Le port de l’uniforme, faut croire que ça conserve !
— Toujours aussi antimilitariste !
— Et ton resto ? C’est toujours si bien que ça ?
— Arrête-toi-z-y. Tu verras… Si tu aimes le couscous, tu ne seras pas déçu, je te promets.
— Oui, mais manger chaque fois pareil…
— Eh bien goûte leur tajine ! C’est une pure merveille.
— Soit, mais Annie et moi, quand on sort, on aime bien changer de cantine. Pourquoi aller toujours dans le même resto ?
— Vois-tu, Henri, ça nous rappelle nos vingt ans, quand on faisait notre service à la coopération, là-bas.
— Le temps béni des illusions de la jeunesse !
— Celles que nous avons perdues.
— Que veux-tu ? À l’aube des années soixante-dix, on avait encore l’espérance chevillée au corps !
— Té… En voilà un qui a encore mal garé sa voiture, fit Paul en apercevant l’arrière d’une Peugeot 308 SW grise à la hauteur de là où le chemin croisait une large piste forestière.
— Sans doute n’a-t-il pas voulu boucher le passage des engins de débardage, lui répondit Henri en observant la piste qui s’enfonçait dans la profondeur des bois où chênes et hêtres se parsemaient de rares mélèzes en décrivant un large S pour épouser la déclivité naturelle du terrain.
— Encore un enfoiré, tu veux dire ! Il aurait pu faire comme nous, laisser sa caisse au parking plutôt que de bloquer le chemin.
— Regarde… Il est immatriculé dans le 87 !
— Sûrement des gens de Limoges qui sont en randonnée.
— Pas sûr… À voir la buée sur les vitres, je parierai que la bagnole a passé la nuit dehors.
— À moins qu’ils ne soient partis à l’aube…
— Hum ! Ces types se croient tout permis sous prétexte qu’ils habitent dans de grandes villes.
— Il faut les comprendre. À vivre entre quatre murs dans leurs banlieues avec pour seul horizon le balcon du voisin, ils ont besoin d’espace et d’air pur.
— Ce n’est pas une raison pour se considérer en pays conquis !
Progressant à deux de front, le petit groupe de retraités marchait d’un bon pas, laissant par endroits dans la terre humide l’empreinte bien nette de la semelle crantée de leurs chaussures. Parfois, à leur passage, un merle s’enfuyait dans un tia-tia rageur, dérangé dans la construction de son nid printanier. Passé une légère pente qu’un massif de ronces tentait de conquérir depuis plusieurs saisons, le chemin faisait un coude serré. Une vingtaine de mètres plus loin, le sentier de randonnée recoupait la piste forestière qui devenait presque aussi large qu’une avenue. Défoncé par l’empreinte des pneus des porteurs qui y avaient laissé de profondes ornières, le chemin d’exploitation forestier balafrait l’espace boisé en une saignée profonde. De part et d’autre, ici, les coupes sélectives des meilleurs sujets à maturité avaient éclairci la forêt mixte pour ne laisser subsister qu’un taillis médiocre. Les couronnes des arbres n’étaient plus jointives, permettant à la lumière d’avril de pénétrer entre les feuilles tendres dans la chétive futaie. Découpant à larges pans le ciel, tels les rayons lumineux des images de première communion, la clarté conférait une ambiance quasi mystique au sous-bois, face à la beauté duquel un incroyant eût trouvé le chemin du Seigneur et de la foi.
Au détour d’un petit massif de buis, émergeant d’un tas de branches coupées quelques semaines plus tôt, l’image du talon d’un brodequin accrocha le regard d’Henri. Le retraité, qui progressait en tête, fronça instinctivement les sourcils et trois plis d’inquiétude zébrèrent la peau de son front. En une fraction de seconde, sa respiration se fit plus haletante et il posa la main sur l’avant-bras de son ami qui marchait à ses côtés pour le ralentir. Paul leva vers lui un regard interrogatif. Les deux hommes s’arrêtèrent, bientôt rejoints par le reste de la troupe. Sans prononcer une parole, Henri, d’un geste, désigna à son vieux compère la semelle en caoutchouc d’une anachronique chaussure qui débordait des branchages aux feuilles flétries.
— Hé… Regarde… Là….
— Où ça ?
— Devant toi. Sous les branches…
— Quoi ?
— Une godasse… Tu la vois ?
— Ah oui… Qui a bien pu l’abandonner là ? C’est un drôle d’endroit pour s’en débarrasser !
— S’en débarrasser ? Tu rigoles…
— Que veux-tu dire ?
— Qu’elle appartient sûrement à un pied !
— Et tu penses que…
— Oui… Il y a quelqu’un dessous !
— Oh merde…
— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Nicole qui arrivait à leur hauteur en racontant le dernier film qu’elle avait vu au cinéma à sa copine Danièle.
— Un macchabée, lâcha Henri.