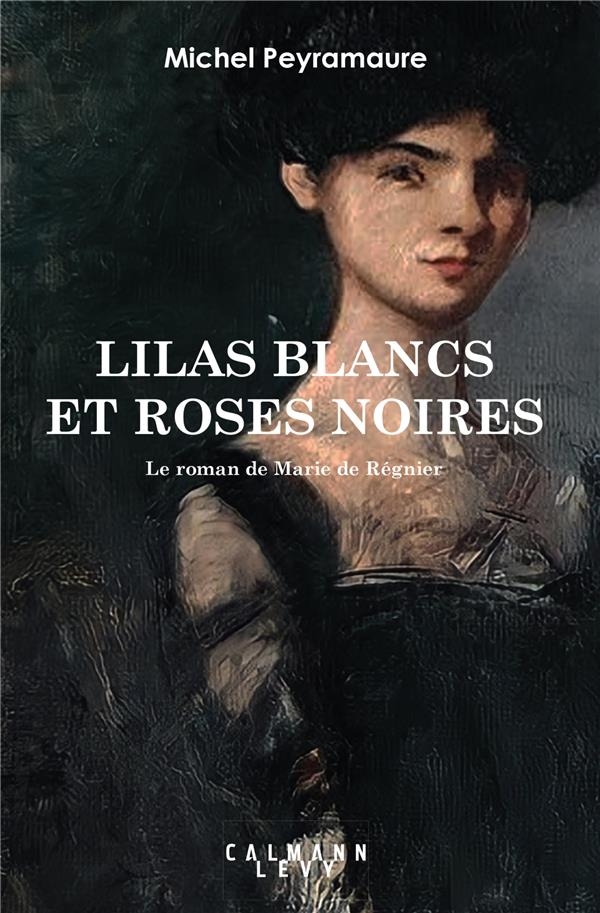Lilas blancs et roses noires: Le roman de Marie de Régnier
Femme de lettres, femme du monde, femme fatale, Marie de Régnier brilla de tout l’éclat de sa grâce et de son esprit sur la vie littéraire française de la Belle Époque aux Années folles.
Fille de José-Maria de Heredia, l’un des maîtres du mouvement parnassien, promoteur de l’Art pour l’Art, elle est courtisée dans le cénacle de son père par deux jeunes poètes : Henri de Régnier et Pierre Louÿs. Mariée à Henri, le plus fortuné des deux, c’est de Pierre qu’elle est éprise et dont elle devient l’amante. Elle aura à ses pieds beaucoup d’autres écrivains comme Gabriele d’Annunzio ou Henry Bernstein, nouera des idylles féminines qui ne manqueront pas de scandaliser.
Elle-même poétesse délicate, romancière à succès, elle est admirée en son temps à l’égal de Colette. Donnant la parole à la soeur aînée de Marie, Hélène, Michel Peyramaure nous fait entrer dans l’intimité d’une femme extraordinairement libre, vivante, sensuelle, dont la vie tumultueuse se lit comme un roman.
Extrait
Récit d’Hélène Doumic,
sœur aînée de Marie
La pénombre enveloppe encore la chambre et au creux du berceau s’entrouvre un gros coquillage de chair rose posé sur un sable de dentelles et de soie, sous une haute voilure de gaze.
À peine née, ma sœur, Marie, nous a habitués à ses longs sommeils du matin que je ne me lasse pas d’observer, dans l’attente de son premier sourire et de ses premiers mouvements, vifs comme des battements d’ailes. Papa Dia, notre père, n’est pas loin, aussi attentif que moi à ce spectacle banal, empreint d’une émotion, dans l’attente du premier gloussement de l’oiselet. Assis sur des tabourets, de chaque côté de cette nef nuptiale, nous assistons en silence à cette parousie quotidienne. J’ignore si notre père eut le même comportement pour mes premiers jours, quatre ans auparavant, et si, comme ce matin, cet homme aux yeux étonnés, avait crispé une main sur le bord du berceau, l’autre tenant la grosse pipe froide de merisier piquée dans sa barbe comme une branche morte sur un tapis de bruyère grise.
Ce matin-là, Papa Dia paraissait pressé de quitter notre appartement de la rue de Berry pour aller retrouver ses amis du Cénacle parnassien, cercle regroupant les meilleurs poètes de notre temps, qui, à voix haute, y peaufinaient leurs rimes, et sur lesquels régnaient Leconte de Lisle et mon père, José-Maria de Heredia, grands prêtres de ce sanctuaire.
Avant de revenir à mes jeux, j’ai assisté aux soins donnés à Marie par notre femme de chambre, Hermine, dans le soleil illuminant la nurserie.
Malgré mon jeune âge, j’avais avec notre mère, née Louise Despaigne, Espagnole née à Cuba, de même que son époux, des rapports exempts de l’affection que j’aurais pu attendre d’elle. J’éprouvais envers son autorité un sentiment complexe fait de respect mais aussi d’acrimonie lorsque, sans motif, ses serres m’arrachaient mes jouets. Dans sa rigueur d’abbesse, beau visage froid sous un léger voile créole, regard sombre, tenue sobre et terne, elle supportait mal l’affection que je vouais à Marie. Quand je prenais ma petite sœur sur mes genoux, attentive aux premiers mots succédant aux balbutiements, elle lâchait d’une voix revêche :
« Hélène, vas-tu cesser de la considérer comme une poupée ! Va plutôt jouer au cerceau dans le jardin et cesse de crier ou de chantonner, ça m’agace ! »
Mes rapports avec Papa Dia étaient d’une nature différente. Je n’attendais pas de lui une affection expansive, et celle, fluctuante, qu’il me témoignait me convenait. Refusant le secours d’un écolâtre pour assurer mon éducation – plus tard celle de Marie et de notre cadette, Louise – il avait préféré s’en charger lui-même, mais de manière peu orthodoxe. Il y consacrait quelques heures de temps à autre, donnant une large part à la poésie, sa raison de vivre. Ma mémoire n’a rien conservé des premiers vers qu’il me faisait ânonner. Ses poèmes, je les relus plus tard dans son premier et unique recueil, sous le titre de Trophées, ouvrage, qui lui a valu, outre une notoriété internationale, sa présence sous la Coupole. De haute taille, visage de créole couleur de cuir, cheveux et barbe bruns, mine sévère, il aimait se donner la prestance des conquistadores, ses ancêtres, dont il conservait pieusement reliques et portraits dans son bureau imprégné de l’odeur opiacée du tabac des tropiques et des cigares. À Cuba, sa famille et celle de notre mère avaient vécu dans l’opulence grâce à d’immenses plantations de café. Dans Paris, capitale des lettres, de l’aisance et des plaisirs, où il avait choisi de vivre, la fortune dont il jouissait allait fondre peu à peu comme neige au soleil.
L’année 1878 avait apporté, dans notre nouveau domicile de la rue Balzac, une joie mêlée de déception, notre mère ayant accouché d’une troisième fille, Louise, surnommée Loulouse. Notre père a été déçu dans son espoir d’un héritier capable de perpétuer le nom et les traditions ancestrales des Heredia, mais il avait à peine passé la trentaine et sa virilité s’affirmait intra – et surtout extra – muros si bien que la voie dynastique restait ouverte.
Dans notre adolescence, nous avons parfois été témoins – par portes entrebâillées – de scènes violentes, lorsque José-Maria, après une séance au Cénacle, s’étant attardé dans le Paris nocturne des plaisirs, revenait, titubant et bourse vide, suite aux heures vouées aux tripots louches du Palais-Royal, ou dans un bordel de luxe, le célèbre Chabanais. Le lendemain, plus rien ne paraissait subsister en lui de ces dévergondages lorsque, pour échapper aux invectives de notre mère, il s’installait à sa table de travail, entre mes sœurs et moi, ses élèves. Il bourrait sa pipe, l’allumait en chantonnant un air à la mode et s’amusait à nous inonder le visage de bouffées suffocantes.
« Alors, les filles, nous lançait-il, où en étions-nous ? Hélène, as-tu médité sur l’histoire de Jason et les Argonautes ? Et toi, Maricote – le surnom qu’il avait donné à Marie – relis-moi ta composition sur le printemps, en évitant si possible l’emphase et les fautes d’orthographe ! »
Il s’était abstenu, peut-être à tort, de nous faire donner un enseignement traditionnel qui nous eût armées pour affronter la haute société dont nous dépendions. Quand son épouse lui reprochait cet enseignement qu’elle jugeait superflu, il rétorquait violemment, disant qu’il se refusait à nous procurer « une éducation bourgeoise de filles-à-marier » ! Notre mère jugeait au contraire que le procédé éducatif de son époux risquait de nous être nuisible, à mes sœurs et à moi. Gavées d’histoire antique et de poésie, nous serions incapables, le moment venu, de répondre aux conventions matrimoniales. Nous avons réussi, notre mère et nous, non sans peine, à lui faire reconnaître l’insuffisance de cet enseignement pour nous confier, adolescentes, sinon à un précepteur, du moins à un collège d’enseignement religieux.
Un attachement singulier allait caractériser les rapports entre ma cadette et moi. Il est vrai que je m’en étais « amusée comme d’une poupée » jusqu’à ses premiers pas, au sortir de sa litière. Dès qu’elle fut en mesure d’entretenir avec moi une conversation d’adulte, je me suis sentie prise pour elle d’une affection d’allure maternelle compensant celle que nous refusait notre mère. Ce sentiment allait vite s’affirmer, faisant de moi un mentor capable de maîtriser les caprices de Maricote et, plus tard, ceux de Louise. Elles ne m’ont jamais reproché cet attachement viscéral, si bien que notre existence a été exempte de conflits ou de brouilles risquant de provoquer entre nous une rupture dont nous aurions souffert. Cette parfaite sororité allait provoquer l’admiration de nos proches et, plus tard, celle de nos nombreux amis, aux yeux de qui nous passions pour des « infantes royales ».
Durant toute notre adolescence, nous avons, Marie et moi, été subjuguées par la nostalgie des tropiques dont notre père nous abreuvait à travers son brouillard de tabac opiacé. De sa voix grave et hésitante, martelant les finales de ses phrases, il nous parlait des plantations de La Fortuna et du Potosi, des esclaves, des fêtes de nuit dans le parc autour d’un feu de cannes. Parfois, en s’accompagnant à la guitare, il entonnait des punto guajiro, berceuses de son enfance dans les Caraïbes.
Il avait ramené de son île un dessin qu’il avait fait encadrer, montrant sa demeure blanche à longue terrasse et les cases réservées aux esclaves. Entre deux palmiers géants, la façade s’incrustait dans une flore exubérante, faite d’essences qu’il nommait avec une expression de jouissance, en se lissant la barbe, par leurs noms indigènes. Le jour où je lui demandais s’il avait l’intention de retourner dans son île, il avait paru troublé et m’avait répondu d’un seul mot, jeté comme une pierre, comme s’il voulait rompre avec ses nostalgies : « Jamais ! »
Quoi qu’il en dise, il n’avait pas oublié son île. Certains de ses poèmes des Trophées en témoignent. Il lui arrivait, en raison de son bégaiement, de donner treize pieds à un alexandrin ou de sauter un vers…
Dire qu’entre Marie et moi régnait une entente parfaite serait exagéré. Lorsque, sur les conseils de notre père, je m’attachais à lui donner le sujet d’un thème à exploiter, elle semblait prendre plaisir à s’en évader, comme pour me narguer. Si je lui demandais de décrire une rose, elle évoquait des pâquerettes ou regimbait, jetait sa plume et boudait devant la fenêtre en me faisant comprendre que mon rôle d’aînesse avait des limites que j’outrepassais. Je ne prenais pas ombrage de ces accrochages qui se terminaient par des rires et des embrassades, persuadée que son talent d’écriture dépassait le mien.
J’en eus la certitude le jour où, âgée de neuf ans, elle me montra quelques vers de sa main, où je ne relevai que quelques fautes de prosodie. Je les fis lire à notre père ; il essuya son monocle avec son mouchoir et, sans un mot, embrassa le « petit prodige ».
J’ai gardé l’image sereine d’une soirée à domicile, l’été de l’année 1884, Papa Dia ayant réuni quelques poètes et leurs épouses – ou muses – autour de Leconte de Lisle, le plus âgé d’entre eux. Nous nous tînmes à l’écart, Marie et moi, devant la fenêtre ouverte sur le jardin, un livre sur les genoux, mais de manière à ne rien perdre des conversations. Sur la fin du repas, tandis que les dames se retiraient dans le boudoir pour papoter en buvant du café, ces messieurs échangeaient des propos plus sérieux dans une épaisse tabagie.
Né sur l’île Bourbon, devenue l’île de la Réunion, fils d’un chirurgien des armées impériales d’origine bretonne, Charles Leconte de Lisle, élevé dans la plantation sucrière de Saint-Paul était parti, à dix-huit ans, faire son droit à Paris. Fervent républicain et anti-esclavagiste, mais déçu par la politique, il s’était tourné vers la poésie, sa passion, qu’il nourrissait d’une profonde nostalgie pour ses origines. Il était devenu le chef de file des Parnassiens, ces poètes qui, dans la foulée de Théophile Gautier, prônaient comme nouvelle esthétique la valeur suprême du « beau idéal ». Ce personnage nous fascinait. Ayant dépassé la soixantaine, il imposait par son air de grand seigneur : visage de marbre portant un monocle, large front auréolé de longs cheveux blancs, tenue élégante et l’élocution d’un abbé. Dans mon jeune âge, une première lecture, celle de ses Poèmes antiques m’avait laissée indifférente, de même que ses Poèmes barbares. Je ne parvenais pas à déceler, sous la perfection de ses vers, la moindre trace d’émotion. Plus tard, en revanche, j’avais apprécié son poème Les Étoiles mortelles.
Au cours de cette soirée, je vis Marie se lever brusquement et, sans un mot, tendre une feuille à Leconte de Lisle. Il ajusta son monocle, en prit connaissance en hochant la tête, lui demanda son âge et si elle était vraiment l’auteur de cette ode au myosotis, ce qu’elle lui confirma.
« Voilà, dit-il, qui me surprend ! Écrire un tel poème à ton âge, diantre… Je salue en toi une grande poétesse en herbe. Je n’ai relevé dans ton poème qu’un faux alexandrin et une rime pauvre. J’aimerais lire d’autres vers de toi. Ton Papa Dia se chargera de me les faire parvenir. »
Il répondit à un premier envoi par un de ses propres poèmes écrit de sa main et assorti de quelques mots : « Je t’aime beaucoup, ma chère enfant, et je t’embrasse de tout mon cœur. Ton vieil ami. »
Elle répondit par une simple phrase :
« Monsieur, moi aussi je vous aime. »