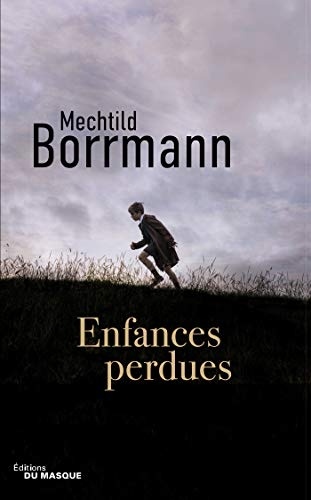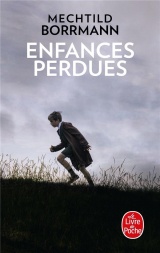Enfances perdues
Velda, 1947. Henni Schöning habite avec sa famille dans un petit village allemand proche de la frontière belge. Son père se réfugie dans la religion et s’intéresse de moins en moins aux siens depuis son retour de la guerre. Quand sa mère meurt subitement, la jeune fille de quatorze ans se retrouve alors responsable de ses frères et de sa sœur. Pour gagner un peu d’argent, elle se lance dans la contrebande de café, comme la plupart des familles de cette région juste après la guerre. Elle connaît les chemins qui traversent les Hautes Fagnes, une zone marécageuse pleine de dangers, et y guide les trafiquants, pour la plupart des enfants, pendant la nuit. Mais de plus en plus de bandes organisées prennent le contrôle du trafic de café, et les douaniers ont désormais ordre de tirer sur les contrebandiers. Une nuit, l’inimaginable se produit : la sœur de Henni est tuée.
Henni est envoyée en maison de redressement et ses frères cadets, Matthias et Fried, sont placés dans un orphelinat catholique où Matthias meurt d’une pneumonie. Henni n’apprendra que des années plus tard les véritables circonstances de ce décès lors d’une audience au tribunal. Peu après, la sœur Angelika, l’ancienne directrice de l’orphelinat, est retrouvée morte, et Henni se trouve à son tour face au tribunal, accusée de son meurtre. Au mépris de tous les obstacles, elle se lance dans une lutte pour la vérité, la justice et la dignité.
Extrait
Velda, automne 1970
Mercredi, nouveau jour d’audience. Le jugement doit être prononcé dans quinze jours. « Au nom du peuple », dira le juge avant de rendre la justice.
Le procès intéresse beaucoup la presse. Le quotidien local a évoqué une « culpabilité prouvée » et des « preuves manifestes », un journal national écrit : « Les mensonges de Henriette B. » On lit plus bas que Henriette (tout le monde l’appelait Henni) avait commis des actes de délinquance dès l’âge de dix-sept ans et, depuis, avait souvent eu affaire à la police et à la justice.
L’eau bout sur la gazinière. Elsa Brennecke s’appuie des deux mains sur la table de la cuisine, se penche vers l’avant et se lève.
— C’est comme ça. Ils se donnent pas grand mal, ils arrangent les choses à leur manière. On cache un détail ici, on en ajoute un là, et hop, voilà une vérité toute neuve.
Sam, le bâtard couché sous la table, dresse un instant le museau, l’écoute, puis repose la tête sur ses pattes avant. La jambe gauche d’Elsa est un peu plus courte que la droite. Quand elle était petite, ses parents ne s’en étaient pas souciés. Elle traînait un peu la patte, mais son père disait : « Bah, ça s’arrangera. » Quand, plus tard, elle s’était mise à boiter pour de bon et à se plaindre de douleurs, on l’avait enfin envoyée chez le médecin. Trop tard. Son bassin était déjà de travers et sa colonne vertébrale avait rééquilibré les choses en se tordant sur le côté. Depuis, elle porte un rehausseur sous sa chaussure gauche. Une semelle orthopédique. Ça lui facilite la marche mais le mal est fait. D’année en année, sa hanche et son dos la font de plus en plus souffrir.
Elle clopine vers la cuisinière dans ses chaussons à carreaux gris tout usés. La thermos qu’elle s’est offerte trois ans plus tôt est posée sur le frigo. Depuis qu’elle l’a, elle se prépare une cafetière entière le matin et le café reste chaud jusque dans l’après-midi. Elle pose sur la thermos le porte-filtre de porcelaine muni d’un filtre en papier, y met quelques cuillérées de café moulu et verse l’eau bouillante. L’arôme envahit la modeste cuisine.
Au fil des années, ils avaient acheté neufs la table en formica gris et blanc, le frigo et la cuisinière. Son Heinz avait bien voulu d’elle malgré ses jambes bancales, et il avait été un bon mari. Il travaillait à la scierie et elle arrondissait leurs fins de mois grâce au terrain attenant à la maison, un grand jardin potager qui produisait bien plus qu’il ne leur en fallait. Tous les samedis, elle vendait des fruits et légumes au marché de Montjoie. Le soir, elle faisait ses comptes, notait la somme gagnée dans un petit carnet et glissait l’argent dans une boîte en fer-blanc avec un paysage enneigé sur le couvercle. « Printen d’Aix-la-Chapelle1 », lisait-on sur le côté, et Heinz demandait parfois en blaguant : « Il y a combien de printen, là-dedans ? »
Ils auraient voulu beaucoup d’enfants, mais ça n’avait pas marché. Après deux fausses couches au sixième mois, on constata que le bassin de travers d’Elsa empêchait son corps de mener une grossesse à terme. Heinz était resté quand même. Ils avaient mené une vie tranquille, mais sept ans plus tôt, à tout juste trente-trois ans, il était mort. D’un coup, comme ça ! Quelques jours avant, il s’était plaint de douleurs dans la poitrine. « Va donc voir le docteur », lui avait-elle répété, mais il avait seulement répondu : « C’est venu tout seul, ça repartira tout seul. » Voilà comment il était, son Heinz. Il s’était effondré un matin, à son poste à la scierie. Quand on lui avait enfin annoncé la nouvelle et qu’elle était arrivée à la clinique, l’après-midi, il était déjà dans un cercueil à la chapelle de l’hôpital. Elle lui avait caressé le visage, incapable d’y croire. Ça ne pouvait pas être lui, pas son Heinz, son bonhomme toujours si costaud et jamais malade !
« Tu ne peux pas m’abandonner comme ça », lui avait-elle murmuré. Et pourtant, c’était ce qu’il avait fait, la laissant veuve à trente ans. Quatre jours plus tard, au cimetière, lorsque les villageois étaient venus lui serrer la main pour lui présenter leurs condoléances, elle avait compris : la compassion qu’elle lisait dans leurs yeux n’était pas seulement inspirée par sa perte, mais aussi par son avenir tout tracé. Elle n’était pas une beauté, elle boitait et elle ne pouvait pas avoir d’enfant. Les jours suivants, elle avait beaucoup pleuré, sur Heinz et sur elle-même. Sur Heinz parce qu’il lui manquait, et sur elle-même parce que, à juste trente ans, elle devinait que désormais elle ne serait plus que la veuve Brennecke, pour le restant de ses jours.
Elle pose le porte-filtre dans l’évier, prend une tasse dans l’armoire et se sert. Puis elle visse le bouchon sur la thermos et la met un instant la tête en bas pour s’assurer qu’elle est bien fermée.
Elle tenait de ses parents l’évier en faïence et le buffet en chêne avec ses portes galbées et ses tiroirs-verseurs en verre pour le sucre, la farine et le sel. Le banc d’angle à la garniture bleue élimée avait toujours été là, lui aussi. Sur la fin, ils avaient économisé pour s’acheter l’évier en inox dont elle rêvait, mais l’enterrement de Heinz avait dévoré leurs économies.
Après ça, il ne lui était plus rien resté à mettre de côté. Elle avait trouvé un poste de vendeuse dans une papeterie de Montjoie mais avait dû démissionner : rester debout toute la journée était trop douloureux. Sa petite pension de veuve et ses ventes hebdomadaires au marché lui permettent tout juste de joindre les deux bouts.
Ces dernières semaines, elle a délaissé son jardin pour aller chaque jour à Aix assister aux débats. La thermos lui a bien servi. Le matin, elle partait à 7 heures. Un quart d’heure à pied jusqu’à l’arrêt de bus, le premier bus jusqu’à la gare de Montjoie, le train jusqu’à Aix et un autre quart d’heure de marche pour atteindre le tribunal. La route était longue, mais elle n’avait pas manqué un seul jour du procès et, quand les policiers surgissaient avec Henni par l’entrée latérale pour la mener au banc des accusés, elle lui adressait à chaque fois un signe de tête, un hochement bref, discrète manière de lui dire : ne perds pas courage !
Une fois, elle avait trouvé une place tout près du banc des accusés. Henni s’était tournée vers elle pour lui souffler :
« Elsa, tu n’as pas à faire tout ce chemin tous les jours !
— Si, avait-elle répliqué, si, Henni, je dois le faire. »
J’aurais dû le faire il y a vingt ans, avait-elle poursuivi intérieurement, mais ça, elle ne l’avait pas dit.
Georg, le mari de Henni, était toujours dans le prétoire quand elle arrivait. Il semblait avoir pris dix ans d’un coup.
Elsa revient vers la table en boitillant et s’assied. Elle ôte sa pantoufle droite et caresse doucement la fourrure de Sam du bout du pied. Elle parle à son chien, comme elle le fait depuis des années. Sam est très doué pour écouter.
— Le Georg, il fait peine à voir. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. « Mais pourquoi est-ce qu’elle ne se défend pas ? », voilà ce qu’il m’a demandé. Qu’est-ce que tu veux que je réponde ? Elle ne réagit même pas aux questions du juge. Et les gens lui en veulent à cause de ça.
Elsa les avait entendus parler pendant la pause.
« Si elle était innocente, elle se défendrait, avait dit une femme.
— Qu’est-ce que vous en savez ? avait rétorqué Elsa. Rien, vous ne savez rien du tout, voilà ! »
Elle boit une gorgée de café.
— C’est comme ça que les gens pensent, Sam, dit-elle à son chien d’une voix douce. On ne peut rien y faire.
Apparemment, Henni n’avait rien dit non plus à son avocat, maître Grüner. Pendant les débats, il paraissait débordé, presque impuissant. Alors le silence de Henni, et tous ces témoins aux souvenirs très personnels… Les vérités partielles, les récits fragmentaires, les petits embellissements avec lesquels ils se rendaient intéressants. « Ouï-dire. » C’était la seule objection de maître Grüner, il ne cessait de la répéter. Au début, il lançait encore d’une voix sonore son « Objection ! Ouï-dire ! », mais ses protestations s’affaiblissaient de jour en jour.
Pendant les dépositions des témoins, Henni gardait la tête haute, les yeux parfois traversés d’une légère stupéfaction. Pas de rancœur, pas d’indignation. Elle était assise là, comme la spectatrice d’une pièce de théâtre.
Elsa remet sa pantoufle et s’approche de la fenêtre en clopinant, sa tasse à la main.
— À moins d’un miracle, ils vont la condamner, murmure-t-elle en regardant dehors.
Les villageois, eux, l’avaient déjà fait. À l’épicerie de Marion Pfaff, où Elsa faisait ses courses chaque vendredi, les langues allaient bon train. Penser qu’une femme d’ici avait fait une chose pareille ! Ça ne collait pas à leur petit monde bien rangé. La Marion ne faisait pas mystère de son opinion et répétait à qui voulait l’entendre : « Gamine déjà, elle n’en ratait pas une. Et puis une fois jeune fille… Enfin, on sait bien où elle s’est retrouvée après. Voilà où ça mène, les mauvaises fréquentations ! » Ça avait quelque chose de rassurant. Ça prouvait que ce n’était pas leur village qui avait produit une femme comme ça.
Elsa regarde Sam.
— Quelle sale bande d’hypocrites, tous autant qu’ils sont. Elle leur a bien rendu service, à l’époque, son audace et son intrépidité leur ont fait empocher une fortune. Et après… Après, ils ont prétendu qu’elle n’en avait jamais assez, alors qu’ils savaient parfaitement pourquoi elle retournait à chaque fois sur le plateau.
Voilà ce qu’elle allait raconter à Jürgen Loose. Elle lui parlerait de la Henni qu’on ne voyait pas au prétoire. Le jeune homme assistait à toutes les audiences et, l’après-midi, il retournait à pied à la gare, comme elle. Sur le chemin, il lui avait adressé la parole. « Jürgen Loose », s’était-il présenté avant de lui demander si elle était une connaissance de Henriette Bernhard. Elle avait poursuivi sa route sans répondre et il lui avait emboîté le pas en bavardant. Il était en fac de droit, avec le droit pénal comme matière principale, et suivait le procès à des fins d’études. Le défenseur faisait pâle figure, mais il fallait reconnaître que sa cliente ne lui facilitait pas la tâche. Il avait parlé de stratégie de défense en employant tout un tas de termes juridiques. Elle l’avait trouvé prétentieux.
« Mme Bernhard n’est vraiment pas quelqu’un de facile. Enfin, elle n’aide pas du tout son avocat. Pourquoi est-ce qu’elle n’explique pas pourquoi elle a fait ça ? Il pourrait sûrement lui obtenir des circonstances atténuantes. »
Elsa s’était mise en colère.
« Tiens donc ! Et qu’est-ce qui vous rend aussi certain qu’elle l’ait fait ? »
Loose avait viré à l’écarlate et balbutié, embarrassé :
« Honnêtement, je dois reconnaître que je commence moi aussi à avoir des doutes. »
Ces aveux avaient paru sincères à Elsa, et elle s’était arrêtée.
« Comment je peux être sûre que vous n’êtes pas d’un de ces journaux ? »
Il avait extirpé sa carte d’étudiant de son sac en bandoulière et la lui avait tendue. Il avait vingt et un ans. Depuis ce jour, ils parcouraient ensemble le chemin menant du tribunal à la gare. Il avait vite abandonné son jargon spécialisé, et, derrière les grands mots, Elsa avait cru déceler un jeune homme sincèrement soucieux de vérité.
Elle l’avait invité la veille, Jürgen Loose allait venir chez elle cet après-midi. C’était peut-être une bêtise, mais ce procès traçait un portrait de Henni qui n’avait rien à voir avec la véritable Henni. Elle allait lui raconter qui elle était vraiment, ou plutôt qui elle avait été.
Elsa observe son grand jardin. Les feuilles mortes des arbres fruitiers recouvrent la pelouse comme un tapis brun-jaune. Au potager, elle a déjà retourné les parcelles récoltées. Les choux de Bruxelles et le chou frisé sont toujours là. Elle doit encore attendre, ils ont besoin d’un coup de gel. Mais il va falloir qu’elle ramasse les deux dernières rangées de patates avant que les nuits se fassent froides.
Elle regarde plus loin, au-delà du potager et de la rue, et observe la ruine d’en face. La façade grise aux fenêtres béantes, sans vitres, surmontées de grandes traces de suie qui montent jusqu’au toit effondré. La porte d’entrée barricadée de planches. Un panneau « Accès interdit » a été planté dans la rue. Le terrain est à l’abandon, les mauvaises herbes sont passées sous la haie de hêtres et envahissent la rue. Ça fait longtemps déjà que la maison et le jardin sont dans cet état lamentable, depuis bien avant l’incendie. Sur la fin, le père de Henni ne s’occupait plus de rien.
Elle pose sa tasse vide dans l’évier.
— Viens, Sam. Le temps reste au sec et il faut ramasser les patates. Je peux encore faire ça avant que le jeune homme arrive.
Le chien la rejoint aussitôt en remuant joyeusement la queue.