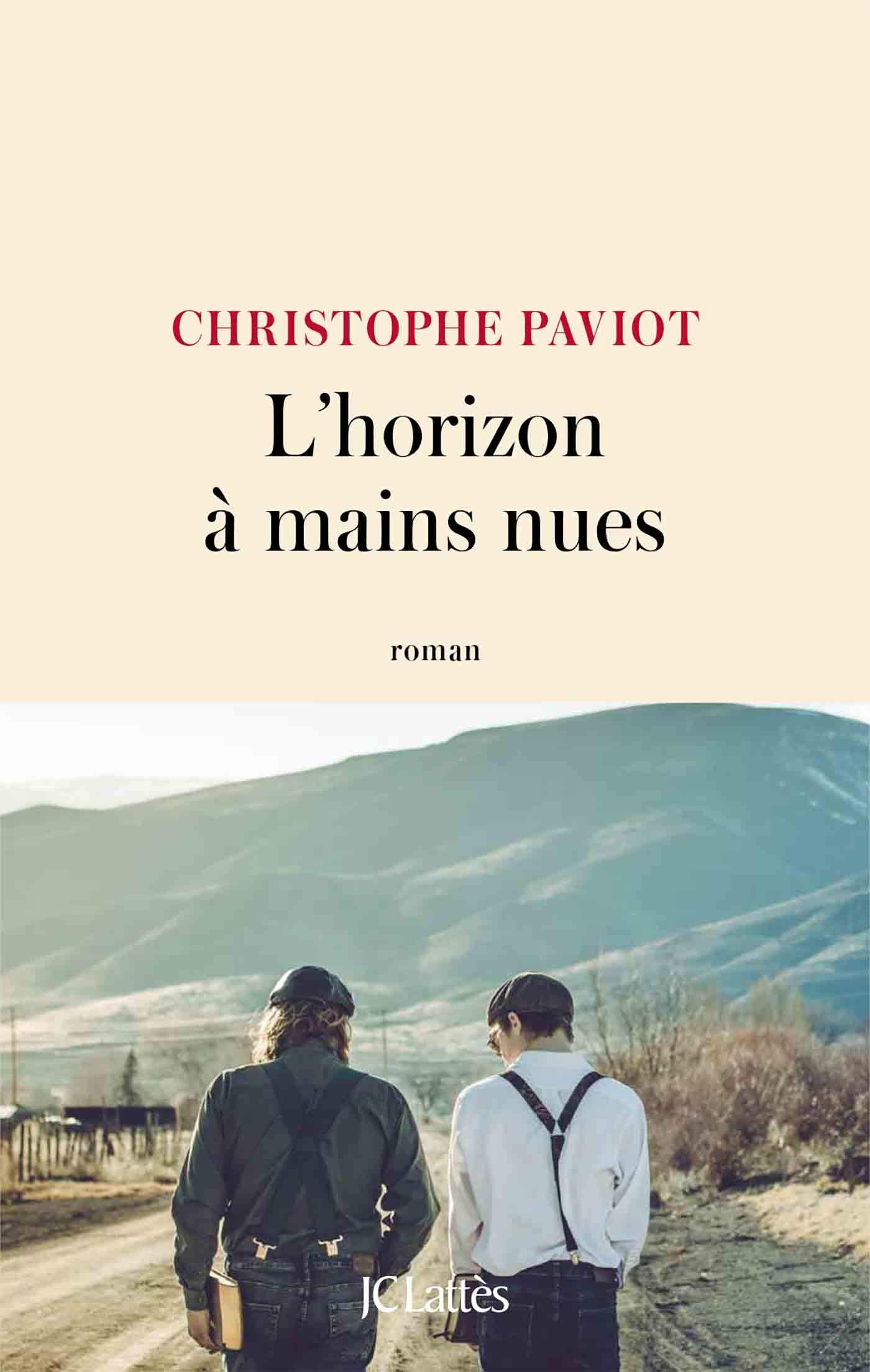L'horizon à mains nues
Howard et Gary vivent à Sweetwater, au Texas. Les deux frères sont inséparables. Solitaires, ils n’aiment qu’une chose, les crotales, ces serpents venimeux qu’ils chassent à l’aide d’une pince, comme leur a appris leur père. Ils ont onze et douze ans quand leur père meurt. Ils ignorent que leur monde a pris fin, que leurs proches ne parleront plus ni de l’accident ni de leur père, que leur mère se taira, elle aussi. Dans ce bout de pays paumé, au milieu de rien, la blessure ne cessera d’enfler. Alors ils deviendront les frères Shelby.
L’horizon à mains nues est l’histoire de deux frères qui s’élèvent seuls, obéissent à leurs propres lois et deviennent libres, sans jamais oublier leur père. Un livre comme un coup de poing, une odyssée américaine.
Vos avis
Je lis une bonne cinquantaine de livres par an, et il y a bien longtemps que je n’avais lu un truc pareil. J’ai pris une belle dose d’humanité, de tendresse et d’adrénaline. Cette histoire je ne l’avais lue nulle part ailleurs, ça nous change des pleurnicheries des auteurs de Saint-Germain. C’est bien écrit, on atterrit dans un bled paumé du Texas, mais ce n’est pas du tout comme on peut l’imaginer.
Laëtitia1982
Extrait
Howard recrache son dentifrice dans la nuque de son frère penché sous le robinet. Une mousse blanchâtre s’écoule dans le col de sa chemise à carreaux, Howard ricane. Il est l’aîné, seulement dix mois de différence avec Gary, mais ça lui suffit pour être l’aîné.
Gary se redresse et se blesse la joue avec le chrome calcifié du robinet. Il se hisse sur ses onze ans et déclenche son poing vers le foie de son frère qui s’épanche sur le carrelage, à genoux. Il aide Howard à se relever aussitôt. La peur. Non pas celle de son père – il est parti à l’aube, oubliant d’embrasser leurs têtes réparties sur les draps mélangés – mais de sa mère. Peur de la voir surgir dans la salle de bains et de trouver les deux frangins en guerre à l’heure de s’enfuir à l’école.
Jason Shelby, leur père, avait escaladé le marchepied de son camion à 6 heures, le soleil déversait déjà une épaisseur molle et orangée sur le bleu circulaire de la nuit. Maintenant il roule dans la lumière dégraissée du matin, son camion-citerne, chargé à bloc, soulève les dernières flaques de poussière oubliées du vent. La radio de la cabine, aiguillée sur The Ranch, la station texane, diffuse « Six Days on the Road », la version des Flying Burrito Brothers emmenés par Gram Parsons peu de temps avant sa mort en 1973. Jason est songeur : « Le temps passe vite, déjà six ans, on est en 1979. Howard a douze ans, Gary onze, c’est dingue. » Hier soir encore, il les entendait se disputer pour des conneries. Gary, le plus jeune, voulant montrer sa force à son frère, lui avait alors asséné : « J’ai déjà compté jusqu’à 1000. » Howard, sans le regarder, lui avait rétorqué un truc comme : « Oui et moi, j’ai déjà compté jusqu’à l’infini. » « C’est quoi l’infini ? » avait demandé Gary. « C’est quand tu fermes ta gueule », lui avait répondu l’autre.
Jason sourit et serre son volant de ses grosses pognes cuirassées. Entre ses doigts, l’armature de bakélite paraît aussi fragile qu’un os de cuisse de poulet. Il regrette de ne pas avoir pris le temps d’embrasser ses gosses dans leur sommeil avant d’aller bosser ce matin, d’habitude il s’approche d’eux dans la pénombre et leur dépose un baiser au coin de l’œil, à l’amorce de ce renfoncement qui cisaille les paupières. Puis, il leur murmure tout bas : « Je vous aime et je vous aimerai toujours. » Il s’en veut, mais il songe déjà aux retrouvailles, vendredi prochain, quand sa semaine sera écoulée. En attendant, il est heureux. Les garçons ne posent pas de problèmes, ils parlent bien à leur mère et ils sont polis avec les adultes dans les commerces. Julia est toujours aussi belle, sa peau si blanche n’a pas fini de l’exciter. La maison n’est pas encore payée, mais il ne leur reste que quelques années à s’agripper aux échéances. Parfois c’est dur, mais Jason est toujours aux anges quand il jette de bons gros steaks sur la grille calcinée de son barbecue. Et rien ne remplacera jamais le moment où il gare son camion-citerne devant la baraque, et qu’il descend de la cabine après une bonne semaine.
Jason descend de son camion, le gars de la station-service l’attendait. La cuve n’était pas loin d’être vide. La poignée de main est ferme, Jason l’aime bien ce type, ça doit faire une quinzaine d’années qu’il bosse chez Texaco. Sa fille est bien mignonne, elle a failli remporter le prix Miss Snake Charmer à la foire de Sweetwater, la grande réunion annuelle autour des crotales. Jason balise le terrain avec des cônes de signalisation orange, et les dispose tout autour de la trappe de la cuve. Il étire déjà ses tuyaux, il n’a pas de temps à perdre, il doit aussi livrer à Midland et Odessa. Il ventouse la gueule du tuyau à sa citerne, il fixe le flexible de transfert à la cuve de stockage, et vérifie les clapets anti-arrachement. Il s’attarde sur le système de jaugeage de la cuve, presque à sec. Tout est OK, la manœuvre de dépotage peut commencer. Jason arme le bloc de vidange de la citerne, il ouvre la vanne, le flexible se raidit et envoie les premiers gallons d’essence sous la dalle de béton.
Il reste près du camion pour inspecter le bon déroulement des opérations, puis décide de rejoindre la boutique de la station. Le type installe des piles de pneus devant la vitrine, Jason réalise qu’il doit les sortir et les rentrer tous les jours, et quand on connaît le poids de ces saloperies-là, il se dit que ça doit bien lui sectionner les lombaires quand il s’allonge le soir en tricot de peau près de son mammifère. Il s’offre une tablette de Big Red, ses chewing-gums préférés, avec ce bon goût de cannelle qui pique la langue longtemps. Le mec lui demande des nouvelles de ses garçons, Jason lui répond que maintenant ils sont grands et qu’ils ne lui causent pas de problèmes à l’école. L’autre le regarde, et lui lance : « Et sinon, ils ont toujours envie de toucher les trains qui passent ? » Jason incline la tête, inquiet de ne pas comprendre. Alors le gars de la station lui raconte qu’un jour il les a surpris au bord des voies, à taper dans les rampes métalliques des wagons d’un train de marchandises en marche. Les vélos, couchés dans les caillasses du ballast, les attendaient. Jason Shelby acquiesce, il les a déjà vus faire, frapper les plateaux des trains qui traversent Sweetwater. L’autre raccompagne Jason près du camion-citerne.
La nuit a été courte pour certains, tellement courte qu’elle n’a pas existé. Ils n’ont pas vu la lune escalader son ellipse, ni les étoiles crever les ténèbres. Ils ont bu sous la lumière d’un porche, avachis dans le moelleux d’une balancelle, se racontant des histoires, s’embrassant au son d’une guitare. Quand les bouteilles ont commencé à jouer leur petite musique vide en roulant sur le plancher, ils ont tout balancé dans les fourrés et sont remontés dans la bagnole, une Chrysler Imperial, puis le conducteur a écrasé la pédale, soulevant un horizon de poussière à l’arrière de la caisse. Ils ont roulé entassés à sept. Trois filles, quatre garçons. Ça brame, ça gueule dans les virages, ils basculent d’un côté et de l’autre, écrabouillés comme dans un camion à bestiaux. Ils brandissent des casquettes dans les lueurs de l’aurore, une ultime bouteille est exhumée d’on ne sait où, ils se la refilent, effacent leur bouche d’un revers de main, et la passent au chauffeur qui réclame son tour. Trop peur d’être oublié dans l’histoire. Les contours du chargement, découpés sur la silhouette de la Terre, rappellent un tank rembourré de soldats braillards juste après la victoire, c’est l’anarchie de l’amour, de l’invincibilité et de la vie éternelle. Ils se blottissent contre les rebords métalliques de la décapotable, les garçons s’attardent sur les cuisses, ils regardent, ils s’empiffrent de cette vie sans colorant. Le type au volant marmonne qu’il faut refaire le plein, personne ne l’écoute, il enfonce sa pédale d’accélérateur à bloc, il est presque debout, comme s’il se tenait à la barre d’un hors-bord. Une longue ligne droite se déplie devant eux, pas celle de la vie, mais celle du bitume, de l’absence et de la mort. Apercevant un « T » au milieu d’une étoile blanche sur fond rouge, son cerveau mobilise quelques forces et interprète le logo d’une station essence Texaco. D’un coup de volant il s’engage sur la voie de dégagement, la bagnole fait irruption sur le terre-plein bétonné de la station, les roues crissent leur colère, il y a là deux mecs près d’un camion-citerne, ils ont juste le temps de relever la tête et d’être percutés par la Chrysler Imperial et ses occupants.
Jason Shelby et l’employé sont écrasés contre l’armature métallique du camion. La voiture arrache le flexible du carburant, les premiers gallons d’hydrocarbure se répandent autour de la cuve et s’embrasent presque instantanément, une nappe de feu se déploie sur le sol, une flaque bleue qui vire à l’orange l’instant d’après. La décapotable et le camion sont aimantés par les flammes, soudure mouvante. Les sept passagers de la Chrysler sont enveloppés de lumière, un halo brûlant les étreint, ils hurlent, ondulent, coincés dans la dentelle métallique de la carcasse, leurs yeux horrifiés appellent en vain, puis les corps se relâchent, retombent dans les flammes, éteints. Le corps est bien serviable, il a l’intelligence de se déconnecter, de se soustraire à une douleur trop violente, l’évanouissement se faufile alors en éclaireur vers la mort. Une fumée noire s’élève du site, l’explosion prévisible de la citerne soulève l’ossature de la voiture et disperse ses occupants sur la plateforme de béton. Shelby et son acolyte sont éjectés avec les autres et, comme eux, achèvent de se consumer d’un feu larvé, nourri de leurs propres graisses.
Sur la route, à bonne distance, quatre bagnoles se sont arrêtées, conducteurs et passagers ont quitté leur place et se tiennent debout, la main sur la portière. Une femme s’aventure dans la station, un homme lui crie de faire attention, ça pourrait encore exploser. Elle ne l’écoute pas, elle court jusqu’à la boutique, décroche le téléphone mural accroché près du comptoir et appelle les pompiers. Elle cherche le responsable des lieux, l’appelle un peu, file voir aux toilettes, se propulse dans le petit bureau à l’arrière de la boutique, personne. Une odeur d’hydrocarbure brûlé s’empare de l’atmosphère, la jeune femme porte une main à sa région nasale, elle ne sait pas combien ils sont, mais il y a des morts ici. De l’endroit où elle se tient, elle aperçoit des corps, des gens mis sur le dos, étrangement accoudés, les avant-bras relevés vers le ciel, les jambes repliées, écartées, comme pour un accouchement, l’accouchement de leur propre mort. Ils sont déjà calcinés, réduits à une croûte de carbone rugueuse.