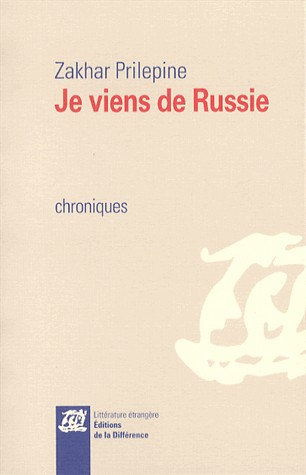Je viens de Russie
Zakhar Prilépine, que beaucoup considèrent en Russie comme le Maxime Gorki de notre temps, est, à 38 ans, l'auteur d'une dizaine de romans traduits dans plusieurs langues. San'kia, le plus célèbre d'entre eux, a fait de lui un gourou de la jeunesse. Ni ses idées politiques radicales ni son engagement dans le mouvement national-bolchevique de Limonov ne détournent de lui des millions de lecteurs. C'est qu'il empoigne la terrible réalité russe des « années zéro », de 2000 à aujourd'hui, sans pathos ni faux-semblants, avec une lucidité implacable servie par un immense talent. Il était temps d'offrir aux lecteurs français son Je viens de Russie, recueil de miniatures écrites à la volée, sur les genoux de l'actualité. Autant que le sous-texte de ses romans, elles forment un condensé merveilleusement spontané de ses émotions, de ses colères et de ses intuitions. Ainsi, ose-t-il avouer avec humour ses pulsions régicides dans « Comment je n'ai pas tué Eltsine ». Il y est donc question de politique, de littérature, d'histoire, d'amour, d'impressions de voyage, de tout ce qui le fait vivre et écrire à cent à l'heure. Il dit mieux que personne l'effroi que ressent la grande majorité des Russes devant « le magma incandescent qui cherche la sortie », autrement dit la menace d'effondrement général qu'il nomme Terra Tartarara. Mais, en contrepoint de cette version possible d'Apocalypse now, il dit tout son bonheur de « venir de Russie », ses sensations d'enfance provinciale qu'il garde aussi fraîches que la délicieuse brûlure de la neige dans les bottes. L'unité du livre tient à cet alliage subtil de pressentiments funestes et de jubilation infinie d'appartenir à cette terre.
Extrait
LE SANG CHANTE,
LA TERRE EST EN LIESSE
La terre et le sang - en parler aujourd'hui est insolite et presque inconvenant.
Les uns, allongés à plat ventre, fouissent le sol et arrachent des mottes de terre qu'ils accumulent sous eux dans un large mouvement de leurs bras avides et de leurs jambes puissantes. Ils sont toujours en état de guerre bien que personne ne leur tire dessus. Il suffirait d'un petit bombardement, pas long, pour voir lesquels d'entre eux continueront de fouiller la terre et lesquels, hallucination bruyante, disparaîtront.
Les autres font une moue de dégoût et déclarent :
«Quelle terre, mon Dieu ! Que tout cela est primitif. C'est vulgaire au bout du compte... Avez-vous des arguments un peu plus sérieux ? Qu'est-ce que vous avez, à part la terre ? Faites voir le contenu de vos poches.
- Non. Je n'ai pas d'autres arguments. A part la terre, je n'ai rien.»
Dans mes poches, traînent quelques bonbons acidulés couverts de miettes de tabac. La terre a des qualités indubitables. À la différence des hommes, elle se tait. On peut prêter l'oreille à son silence et en capter la nature : est-il sombre ? tendre ? majestueux ?
Le sang aussi est silencieux, son flux est semblable à celui du temps. On peut ouvrir les veines du temps, et alors il coule hors du corps et déborde dans l'eau chaude, dans la serviette roulée en boule, dans les cris des proches et l'horreur curieuse de ceux qui n'en sont pas.
Notre terre engloutit une infinité de coeurs russes. Je comprends bien pourquoi des hommes à la mine sévère éprouvent parfois le besoin de toucher la terre de leurs mains. Quand j'étais enfant, j'ai vu cette scène dans le film Dix-sept instants du printemps : plus tard, j'ai assisté quelquefois à des scènes de ce genre, mais c'est pire que regarder une femme en pleurs.
La conduite des premiers, ceux qui sont à plat ventre sur la terre, de même que celle des seconds, également évoqués précédemment, est dictée par la seule peur douloureuse, secrète, insupportable de la mort.
Les premiers veulent caresser la terre, l'amadouer : accueille-moi avec tendresse, accueille-moi plus tard, le plus tard possible, n'en parlons même pas maintenant.
Je ne voudrais pas vous induire en erreur mais il me semble que parfois, les premiers veulent appâter la terre avec les seconds en les laissant passer devant eux.
Les seconds disent :
«Je te hais, terre. Tu veux m'engloutir moi aussi, horrible terre noire.»
La terre et le sang, au fond, c'est la même chose. La terre, c'est le sang figé, concentré, total, une masse impossible à soulever, que l'on ne peut plus remettre en liberté. Nous portons notre sang dans notre corps léger que nous préparons pour la terre. Nous arrosons les fleurs et le blé.
Les seconds déclarent :
«Je ne veux pas de vos fleurs, elles ne sont pas belles, votre blé n'est pas bon, il est rance, étranger.
- Je ne donnerai pas mon sang à la terre, qu'elle se nourrisse comme elle veut.
- Pourquoi la terre russe est-elle ainsi faite qu'il faut toujours tuer ou mourir en son nom ?» demandent-ils.