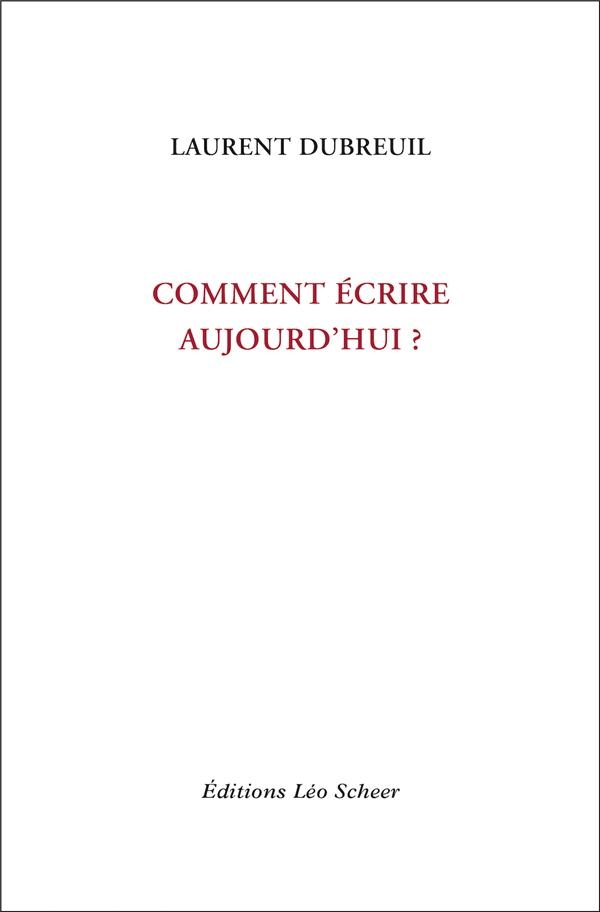Comment écrire aujourd'hui ?
Dans ce vrai-faux manuel d’écriture littéraire, Laurent Dubreuil nous donne quelques clefs pour approcher ce rêve que nous avons tous : devenir écrivain.
Laurent Dubreuil est professeur de littérature comparée aux États-Unis.
Présentation de l'éditeur
Vrai faux manuel d’écriture littéraire, cet ouvrage parle de ce qui se publie aujourd’hui en français, et pas seulement. Son propos est organisé selon la fiction d’un « how-to ». Comment éviter les phrases de rien. Comment lire. Comment dialoguer. Comment payer ses dettes. Comment être publié – ou pas… Ces pages sont animées d’une même expérience d’écrivain, de lecteur, de chercheur.
Beaucoup d’œuvres admirables sont citées ; et aussi quelques textes plus lamentables. Eh ! il faut bien faire des différences. Pourtant, loin du jeu de massacre, ce guide d’écriture est une contribution singulière à l’œuvre future de la littérature.
Extrait
De l’écrivain
Ce pourrait être l’enfance de l’art. Par le jeu des enfants se construiraient d’abord des mondes, des récits. Ils communiqueraient, grâce à certains personnages ou émotions, passant d’une histoire à l’autre. Il y aurait une voix reconnaissable, voire plusieurs. Telle princesse parlerait ainsi, les meilleurs dénouements se ressembleraient un peu, le goût se marquerait pour cette passion-ci plutôt que celle-là. Les fictions, à force, grandiraient au-delà du jeu vivant, se fixant en des mots répétés par la mémoire ou notés sur une page. Et, peu à peu, du jeu puéril naîtrait l’écrivain.
Je ne sais si je crois aujourd’hui à une pareille explication, mais je me rappelle avoir exactement pensé cette théorie quand j’avais treize ans à peu près, c’est-à-dire quand je commençai de jouer moins. Je me souviens également que, lors de mon premier anniversaire de collège, mes camarades conviés à la fête s’étonnèrent que je reçoive encore autant de jouets, qui, à la différence des jeux de société et des jeux électroniques, requéraient de l’imagination et admettaient la solitude. La parole du consensus me disait que suivre des règles préétablies et passer du temps avec les autres constituaient des preuves de « maturité intellectuelle ». De ce groupe de gamins aléatoirement assemblés en novembre 1984 sortiraient ensuite des cadres moyens, des petits fonctionnaires et des boutiquiers, mais, en effet, pas d’autre écrivain. Je ne dis pas maintenant – je n’aurais pas non plus soutenu adolescent – que jouer beaucoup et après l’heure suffise à indiquer un destin ni un talent littéraires, car il faut à la fois une ambition narrative et créatrice, et, fort tôt, un débordement vers l’écrit. Sans l’ambition verbale, on en resterait au mieux à une pratique, en deçà d’une poétique. Je peux dire en tout cas qu’à l’âge de cinq ans, avant de savoir écrire, je dictais à ma mère les légendes à mettre au-dessous des images que j’avais dessinées sur des feuilles margées, reliées par du scotch en cahiers. Il y était question d’un jeune garçon aux accointances extraterrestres, et aussi, de façon plus surprenante, de deux arbres déracinés qui lui servaient d’amis. Allez y voir vous-mêmes si vous ne me croyez pas, et fouillez le cagibi chez mes parents. Je suis certain que vous trouverez dans un cartable fripé les différents tomes des Aventures de Lampwick (qui, de mémoire, ne devait au mauvais sujet du Pinocchio de Walt Disney que son nom et point son caractère). Les nombreux autres ouvrages commis entre mes huit et quinze ans, et dépourvus d’illustrations, ont, eux, été jetés par mes soins dans la bouche béante du vorace vide-ordures.
Si l’hypothèse du jeu d’écriture s’avérait, elle signifierait d’abord une indistinction première, commune aux créateurs de cinéma, de théâtre, de bande dessinée, de feuilletons, de romans, de poèmes. De l’imagination ludique et prolifératrice comme d’une cellule souche. Cette biologie me plairait, qui expliquerait comment certains auteurs mobilisent leur pluripotente capacité. Mais que doit-il rester des jeux d’origine ? Rien que l’ivresse, aurais-je envie de répondre, et de préférence pas le flacon ; chez les écrivains. De cette prélittérature putative d’avant la conversion artistique, nous n’avons guère d’impressionnants vestiges. Le plus beau est sans doute le cycle inventé par les sœurs Brontë avec leur frère Patrick en leur enfance romantique, où les soldats de plomb devenaient les Douze de Glass Town, cette cité ensuite nommée Verreopolis ou Verdopolis, et peuplée par Walter Scott, le Marquis de Douro, Édouard de Crack. Ubu roi est l’autre monument d’un génie collectif et ludique, chez les « grands » du collège cette fois, et tout de même retouché par l’adulte Alfred Jarry. Sinon, les témoignages de la transition vers l’art de l’écriture se font rares. Quand ils apparaissent tels quels, ils gênent ou font plus sourire qu’ils ne ravissent. Pensons à l’île W en forme de crâne de mouton où vivent et meurent des athlètes en squelettes. Fidèle, Georges Perec transcrit dans ce livre un souvenir d’enfance mais il n’en capte pas la jeune énergie qui permettait alors au petit Georges d’ouvrir tout à fait le réel. Perec vieilli se contente de la remémoration de l’imaginaire puéril, il en perd le vertige, puis il l’explique autobiographiquement par l’incidence de l’Extermination et d’Auschwitz. Au lieu d’une folle volonté d’exotisme chez un enfant au-delà même de ses propres capacités mentales, à quoi il faudrait rendre hommage par tout autre chose, on en revient à une relation entre le cas particulier (Georges rêvant) et le général (l’Histoire). Perec fait donc erreur sur la valeur de sa prélittérature individuelle, comme il se trompe ailleurs sur la poétique, qu’il prend souvent pour la sécrétion de la règle, soit, essentiellement, un jeu de société. Tiens.
Il ne nous faut pas répertorier ni adapter nos souvenirs ludiques ; il convient d’en garder l’extrême songerie, qui fait admettre à la petite fille claquemurée du Yorkshire ou à l’adolescent breton qu’ils ont la ressource de leur génie avant d’en avoir livré aucune preuve. On essaie de se prouver tel, et bien loin de ses limites. Là seulement point une volonté artistique, qui, oui, peut-être, « ne sera pas à la hauteur », qui nous doit cependant guider. Pour commencer, être écrivain reviendrait à donner une réponse à quelque rêve s’outrepassant – rêvé par soi ou d’autres –, et ressentir un intense attrait pour l’expansion du jeu dans la vie et sa parole. Tout cela, toutefois, n’est que pour commencer, puisqu’il s’agit de faire ensuite, afin de continuer d’être écrivain. Cet indispensable début dont je parle n’est aucune fin. Je suis écrivain n’a rien à voir avec une identité « profonde » ni professionnelle. Je ne suis écrivain que par la promesse de l’être. Promesse esquissée, formulée, ensuite tenue ou lâchée, à constamment renouveler. Il arrive même que le vœu de l’un s’exauce par un autre : Neal Cassady fut écrivain parce qu’il permit à son ami Jack Kerouac de trouver la prose spontanée qui mènerait à On the Road, parce qu’il donna le tempo aux premiers grands poèmes d’Allen Ginsberg. Qui sait l’exact départ des poètes et de leurs muses ?
Les personnages sortent des livres et des plateaux, ils se mettent en quête d’auteurs. Les œuvres brûlées par autodafé perdurent dans le cœur de leurs admirateurs. Les lecteurs persistent autant que la vocation littéraire ; à leur disparition, tout s’effondrerait. Les phrases survivent jusqu’après la mort des langues qui les formèrent, muées en fragments, en proverbes, en citations. Les genres se transforment. Mais l’écrivain est discontinu. Il est né d’une promesse, il s’est exprimé comme tel, il est impermanent, il existe comme légende ou se confond avec son œuvre. L’écriture envahit le jeu qui envahit la vie ; entre les parties, seule demeure la promesse.