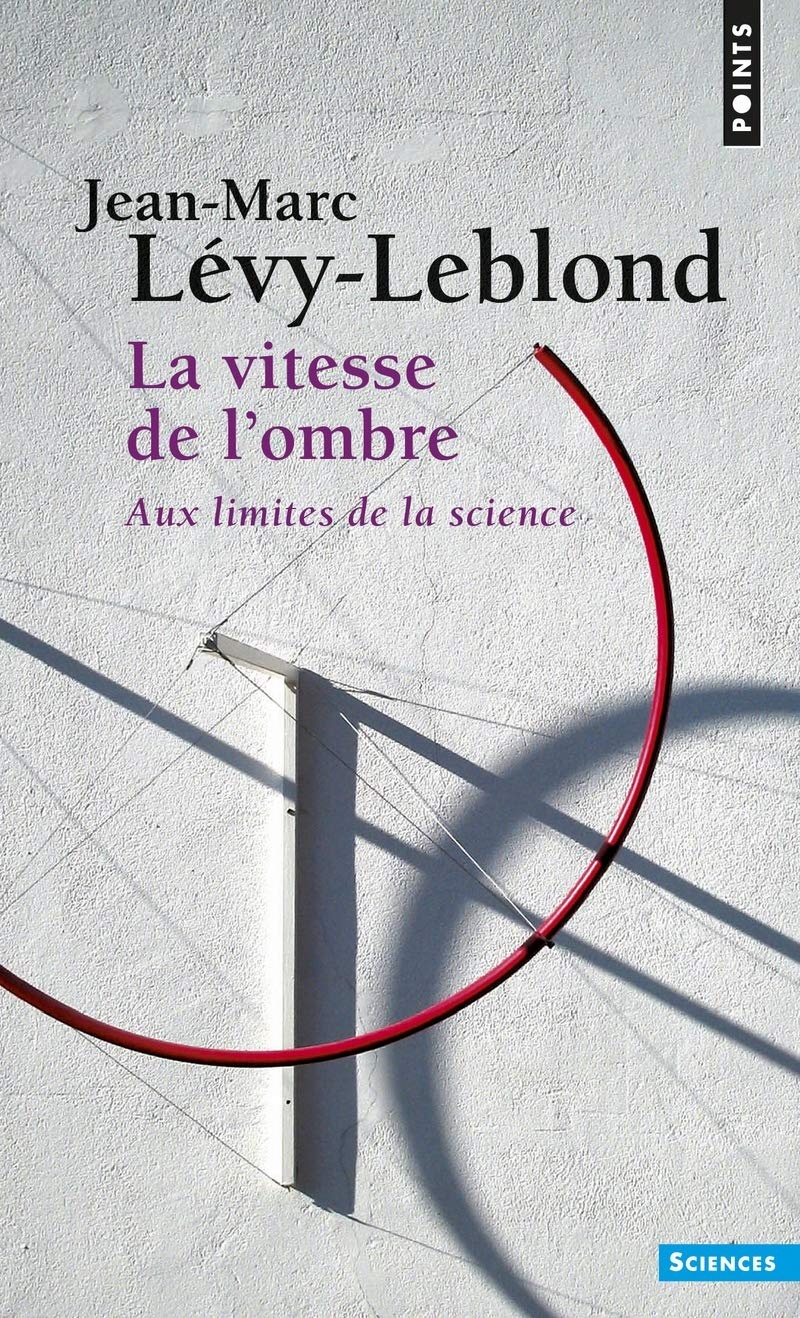La Vitesse de l'ombre
Les essais rassemblés ici visent à éclairer la nature, les enjeux et les limites de la science.
Pourquoi les physiciens, depuis quatre siècles, s'intéressent-ils à l'Enfer ? D'où vient le mythe des sept couleurs de l'arc-en-ciel ? Quelle est la portée des lettres de l'alphabet dans les formules de la physique ? Que nous disent les anecdotes qui courent sur les grands savants ? La science a-t-elle une universalité transculturelle ? Le partage du savoir ne demande-t-il pas aussi celui de l'ignorance? Y a-t-il une muse de la science ?
Le titre de ce livre, s'il trouve son origine dans le paradoxe qui permet d'assigner à l'ombre une vitesse supérieure à celle de la lumière, renvoie surtout à la crise du projet des Lumières et à la sombre perspective d'une technoscience qui ne délivrerait plus que d'obscures clartés.
Ce volume est augmenté de trois chapitres inédits.
Jean-Marc Lévy-Leblond est professeur émérite de l'université de Nice, physicien, essayiste et éditeur. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs artisans de la « mise en culture » des sciences.
Extrait
Les Lumières et les ombres de la science - Entre obscurantisme et aveuglement
Si bien des traits de notre monde sont annoncés par les Lumières, la vision que nous en avons est souvent par trop rétroactive et projette sur le dix‐huitième siècle des traits qui n’appartiennent qu’aux suivants. Sans doute l’hom‐ mage que nous rendons à ce passé gagnerait‐il à ce que nous ne le considérions pas comme une simple préfigura‐ tion de notre présent et distinguions mieux ce qui nous en sépare désormais1. Il en va ainsi de la science et de son rap‐ port à la technique, même si cette affirmation peut sembler paradoxale tant nous sommes accoutumés à voir dans les Lumières, et en particulier dans l’Encyclopédie, l’annonce des progrès techniques induits par les découvertes scienti‐ fiques. Mais, à bien le lire, ce « Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts & des Métiers », s’il accorde une égale dignité aux unes et aux autres, ne met guère en évidence leur interaction et ne propose nullement la fécondation des seconds par les premières qui a engendré notre moderne technoscience.
Un savoir sans pouvoir
C’est plus tôt cependant, à l’aube de la modernité, qu’avait été proclamée cette devise inaugurale : « Scientia et potentia humana in idem coincidunt », soit « Connais‐ sance et puissance sont pour l’homme une même chose », comme l’écrit Francis Bacon en 1620. Et, dans sa Nouvelle Atlantide, il décrit en 1626 une société utopique sous la forme d’une scientocratie exercée par la « Maison de Salomon » ; l’objectif déclaré de cette institution, à la fois académie des sciences et ministère de la recherche, est « la connaissance des causes et du mouvement secret des choses, et l’extension des frontières de la domination humaine, pour la réalisation de tout ce qui est possible ». À la même époque, cette conviction que le savoir, scien‐ tifique s’entend, confère le pouvoir, nul ne l’a mieux exprimé que Descartes :
[...] sitôt que j’ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, [...] elles m’ont fait voir qu’il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu’au lieu de cette philosophie spéculative, qu’on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, [...] nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, [par] l’invention d’une infinité d’artifices, qui feraient qu’on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent.
On a souvent insisté sur le caractère novateur de ce projet, qui fait du développement des techniques un corollaire de celui des sciences, mais on n’a guère sou‐ ligné son caractère totalement irréaliste, non seulement à l’époque, mais longtemps après encore. Si les sciences alors empruntent aux techniques existantes les moyens ins‐ trumentaux de l’expérimentation, elles sont loin de pouvoir leur rendre en retour un service conséquent. De fait, les nouvelles connaissances issues de la révolution scientifique des débuts du dix‐septième siècle resteront pratiquement sans aucune application concrète pendant près de deux siècles, et les progrès techniques garderont leur autonomie. À titre d’exemple : l’une des innovations majeures du dix‐ huitième siècle fut l’amélioration de la navigation maritime offerte par la mesure des longitudes. Or ce n’est pas la mécanique théorique ni l’astronomie, malgré les recherches des physiciens appliquées à cette fin (Galilée avait proposé d’utiliser l’observation des satellites de Jupiter qu’il avait découverts), qui apportèrent la solution, mais bien les per‐ fectionnements empiriques de l’horlogerie.
Rien peut‐être n’illustre aussi bien la relative stagnation des techniques à l’âge des Lumières que l’histoire de la lumière – artificielle, s’entend. Comment donc vivaient nos prédécesseurs après la tombée du jour ? En plein dix‐huitième siècle, on s’éclaire encore avec de faibles flammes, agitées et fuligineuses, comme depuis des millé‐ naires : torches de résine, lampes à huile et chandelles de suif ou de poix (les bougies de cire, ainsi nommées d’après la ville de Bougie qui longtemps avait fourni une cire fine spéciale, fument moins que les chandelles de suif, mais restent encore chères et réservées aux riches). Ces maigres éclairages sont les seuls disponibles dans les rues chichement éclairées de lanternes éparses, et dans les intérieurs munis de quelques bougeoirs. Imagine‐t‐on assez ce que c’est à cette époque que de se déplacer de nuit, ou d’écrire le soir ? Et que dire des spectacles, les scènes théâtrales n’étant éclairées, elles aussi, que de ces maigres flammes ?
De façon générale, les conditions de vie, tant domes‐ tiques que sociales, sont bien plus proches au dix‐huitième siècle de ce qu’elles étaient dans l’Antiquité que de ce qu’elles seront au vingtième siècle, et ce, dans tous les domaines – éclairage, hygiène, transports, nourriture, etc. Aussi n’est‐il guère surprenant que les hommes des Lumières soient nettement plus réservés quant au progrès technique et surtout quant à son lien avec le progrès scien‐ tifique que ne l’étaient les protagonistes de la révolution scientifique au siècle précédent. Relisons ainsi ce manifeste qu’est le « Discours préliminaire » de l’Encyclopédie, dû à la plume de D’Alembert – physicien et mathématicien, faut‐il le rappeler. Malgré une référence appuyée au chan‐ celier Bacon, mais qui concerne essentiellement le projet encyclopédique lui‐même, on n’y trouve guère affirmée la perspective d’un développement accéléré des Arts et Métiers (les techniques, dirions‐nous aujourd’hui) fondé sur les Sciences. Bien que ces trois domaines constituent la matière même de l’Encyclopédie, leur séparation est claire‐ ment marquée, et leur nature différenciée : « La spéculation et la pratique constituent la principale différence qui dis‐ tingue les Sciences d’avec les Arts. » Une brève allusion au fait que « les Sciences et les Arts se prêtent mutuellement secours » ne compense guère un évident scepticisme sur leurs relations – à tel point que le texte en vient à justifier la connaissance purement spéculative dans un passage qu’il vaut la peine de citer en détail :
Cependant, quelque chemin que les hommes [...] aient été capables de faire, excités par un objet aussi inté‐ ressant que celui de leur propre conservation ; l’expé‐ rience et l’observation de ce vaste Univers leur ont fait rencontrer bientôt des obstacles que leurs plus grands efforts n’ont pu franchir. L’esprit, accoutumé à la méditation, & avide d’en tirer quelque fruit, a dû trouver alors une espèce de ressource dans la décou‐ verte des propriétés des corps uniquement curieuses, découverte qui ne connaît point de bornes. En effet, si un grand nombre de connaissances agréables suf‐ fisait pour consoler de la privation d’une vérité utile, on pourrait dire que l’étude de la Nature, quand elle nous refuse le nécessaire, fournit du moins avec pro‐ fusion à nos plaisirs : c’est une espèce de superflu qui supplée, quoique très imparfaitement, à ce qui nous manque. De plus, dans l’ordre de nos besoins et des objets de nos passions, le plaisir tient une des premières places, et la curiosité est un besoin pour qui sait pen‐ ser, surtout lorsque ce désir inquiet est animé par une sorte de dépit de ne pouvoir entièrement se satisfaire. Nous devons donc un grand nombre de connaissances simplement agréables à l’impuissance malheureuse où nous sommes d’acquérir celles qui nous seraient d’une plus grande nécessité.
Obstacles infranchissables à la domination de ce « vaste Univers » et « impuissance malheureuse » à acquérir les connaissances les plus utiles, mais « désir inquiet » de la découverte de « propriétés uniquement curieuses » et « simplement agréables », le retrait par rapport à l’ambition de Bacon et Descartes est net. Au fond, Rousseau, dont on connaît la très sévère critique qu’il adresse aux Sciences comme aux Arts, est moins isolé qu’on ne le croit sou‐ vent ; d’ailleurs, n’a‐t‐il pas été encouragé par Diderot lui‐ même à soumettre son Discours sur les Sciences et les Arts au concours de l’Académie de Dijon ? Et le « Discours préliminaire » de l’Encyclopédie, s’il prend effectivement ses distances avec les thèses de Rousseau (dont l’ouvrage venait d’être publié et connaissait un immense succès), ne le fait qu’avec une extrême modération. Il ne faudrait enfin pas oublier cette « face cachée du siècle, pas toujours si rationnel », que montrent « le baquet magnétique de Mes‐ mer, les élucubrations de Cagliostro, la montée du mouve‐ ment ésotérique [...], l’œuvre philosophique des loges et la profusion d’une littérature vouée au fantastique ». Le siècle des Lumières avait ses ombres. Il le savait, sur sa fin en tout cas, comme le prouve la célèbre eau‐forte de Goya : « Le sommeil de la raison engendre les monstres » (1797) – cauchemars inévitables, car inéluctables compa‐ gnons des beaux rêves de la raison.