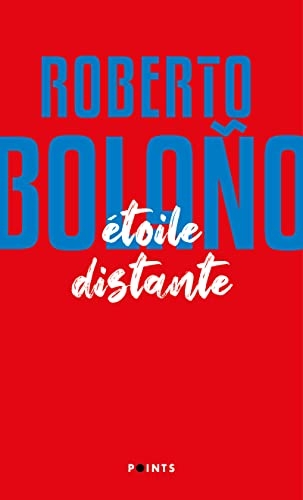Etoile distante
Dans le Chili estudiantin des années 1970, l'élégant et distant Alberto Ruiz-Tagle fascine tout l'atelier de poésie. Le coup d'État de Pinochet déchaîne sa créativité : poèmes macabres écrits dans le ciel par un avion, photographies d'une violence insoutenable, pièces de théâtre sadiques, jusqu'à son chef-d'œuvre ultime... le meurtre. Roberto Bolaño déploie sa singulière imagination dans cet étrange roman sur la démence et le mal.
Extrait
La première fois que j’ai vu Carlos Wieder ce devait être en 1971 ou peut-être en 1972, du temps où Salvador Allende était président du Chili.
À cette époque-là il se faisait appeler Alberto Ruiz-Tagle et fréquentait parfois l’atelier de poésie de Juan Stein, à Concepción, la capitale du Sud, comme on dit. Je ne peux pas dire que je le connaissais bien. Je le voyais une ou deux fois par semaine, quand il venait à l’atelier. Il ne parlait pas énormément. Moi oui. La plupart de ceux qui venaient parlaient beaucoup : pas seulement de poésie, mais de politique, de voyages (et personne n’imaginait en ce temps-là ce qu’ils seraient plus tard), de peinture, d’architecture, de photographie, de révolution et de lutte armée ; cette lutte armée qui devait nous apporter des temps nouveaux et une vie nouvelle, mais qui, pour la plupart d’entre nous, était une sorte de rêve ou, plus exactement, une sorte de clé qui nous ouvrirait la porte des rêves, les seuls qui justifiaient la peine de vivre. Nous savions bien sûr confusément que souvent les rêves se muent en cauchemars mais cela ne nous importait pas. Nous avions entre dix-sept et vingt-trois ans (moi j’en avais dix-huit) et nous étions presque tous étudiants à la faculté de lettres, sauf les sœurs Garmendia, qui suivaient des cours de sociologie et de psychologie, et Alberto Ruiz-Tagle qui, une fois, nous dit qu’il était autodidacte. Il y aurait beaucoup à dire sur le fait d’être autodidacte au Chili à l’époque qui a précédé les événements de 1973. La vérité, c’est qu’on n’aurait pas dit un autodidacte. Je veux dire : extérieurement il ne ressemblait pas à un autodidacte. Les autodidactes, au Chili, au début des années soixante-dix, dans la ville de Concepción, ne s’habillaient pas comme le faisait Alberto Ruiz-Tagle. Les autodidactes étaient pauvres. Certes il parlait bien comme un autodidacte. Il parlait comme, je suppose, nous parlons tous à présent, du moins ceux d’entre nous qui sont encore vivants (il parlait comme s’il vivait au beau milieu d’un nuage), mais il était trop bien habillé pour ne jamais avoir mis les pieds dans une université. Je ne veux pas dire qu’il était élégant – même si à sa manière il l’était – ni qu’il s’habillait d’une façon particulière ; ses goûts étaient éclectiques : parfois il faisait son entrée en costume trois-pièces-cravate, d’autres fois il arrivait en tenue de sport, il ne méprisait ni les blue-jeans ni les tee-shirts. Mais peu importait leur genre, les vêtements de Ruiz-Tagle étaient toujours chers et de marque. Bref, Ruiz-Tagle était élégant et moi en ce temps-là je ne croyais pas que les autodidactes chiliens, toujours entre l’asile de fous et le désespoir, pouvaient être élégants. Il dit une fois que son père ou son grand-père avait possédé une propriété du côté de Puerto Montt. Il racontait, ou alors c’est Verónica Garmendia qui nous l’avait raconté, qu’il avait abandonné les études à quinze ans pour se consacrer aux travaux des champs et à la lecture de la bibliothèque paternelle. Tous ceux qui assistaient à l’atelier de Juan Stein le tenaient pour un excellent cavalier. Je ne sais pourquoi, puisque aucun d’entre nous ne l’avait jamais vu à cheval. En réalité, toutes les suppositions que nous pouvions faire à propos de Ruiz-Tagle étaient prédéterminées par notre jalousie ou peut-être notre envie. Ruiz-Tagle était grand, mince mais robuste, et admirablement bâti. D’après Bibiano O’Ryan c’était un individu dont les traits étaient trop froids pour être beaux, mais bien sûr, cela Bibiano l’a affirmé a posteriori et comme ça c’est trop facile. Pourquoi étions-nous jaloux de Ruiz-Tagle ? Le pluriel est excessif. Disons que moi en tout cas j’étais jaloux. Peut-être Bibiano l’était-il aussi. La raison en était évidemment les sœurs Garmendia, jumelles monozygotes et vedettes indiscutables de l’atelier de poésie. Elles l’étaient si indiscutablement que parfois nous avions l’impression (je veux dire Bibiano et moi) que Stein dirigeait l’atelier à leur seule intention. Elles étaient, je le reconnais, les meilleures. Verónica et Angélica Garmendia, si semblables certains jours qu’il était impossible de les distinguer, et si différentes d’autres jours (mais surtout d’autres nuits) qu’elles paraissaient être deux étrangères absolues, si ce n’est deux ennemies. Stein les adorait. Il était le seul, avec Ruiz-Tagle, à reconnaître sans se tromper Verónica ou Angélica. J’ai le plus grand mal à parler d’elles. Quelquefois elles apparaissent dans mes cauchemars. Elles ont mon âge, peut-être un an de plus, elles sont minces, élancées, elles ont le teint mat, leurs cheveux noirs sont très longs, comme c’était la mode en ce temps-là, je crois.
Les sœurs Garmendia devinrent presque tout de suite des amies de Ruiz-Tagle. Celui-ci s’inscrivit à l’atelier de Stein en 1971 ou 1972. Personne ne l’avait vu auparavant, ni à l’université ni autre part. Stein ne lui demanda pas d’où il venait. Il le pria de lire trois poèmes et lui dit qu’ils n’étaient pas mauvais. (Seules les sœurs Garmendia avaient droit aux louanges sans réserve de Stein.) Et il resta parmi nous. Au début on ne fit pas beaucoup attention à lui. Mais lorsqu’on s’aperçut que les sœurs Garmendia se liaient avec lui, on essaya de devenir ses amis. Jusqu’alors son attitude avait été d’une cordialité distante. Ce n’était qu’envers les deux sœurs (et en cela il ressemblait à Stein) qu’il semblait éprouver une réelle sympathie, qu’il était plein de délicatesses et d’attentions. Quant à nous autres, je l’ai déjà dit, il nous traitait avec une « cordialité distante », c’est-à-dire qu’il nous saluait, nous souriait, quand nous lisions des poèmes son jugement critique était subtil et mesuré, il ne défendait jamais ses textes contre nos attaques (nous étions ordinairement destructeurs), et il nous écoutait, quand nous nous adressions à lui, avec quelque chose qu’aujourd’hui je ne me risquerais pas à nommer de l’attention, mais qui alors semblait en être.