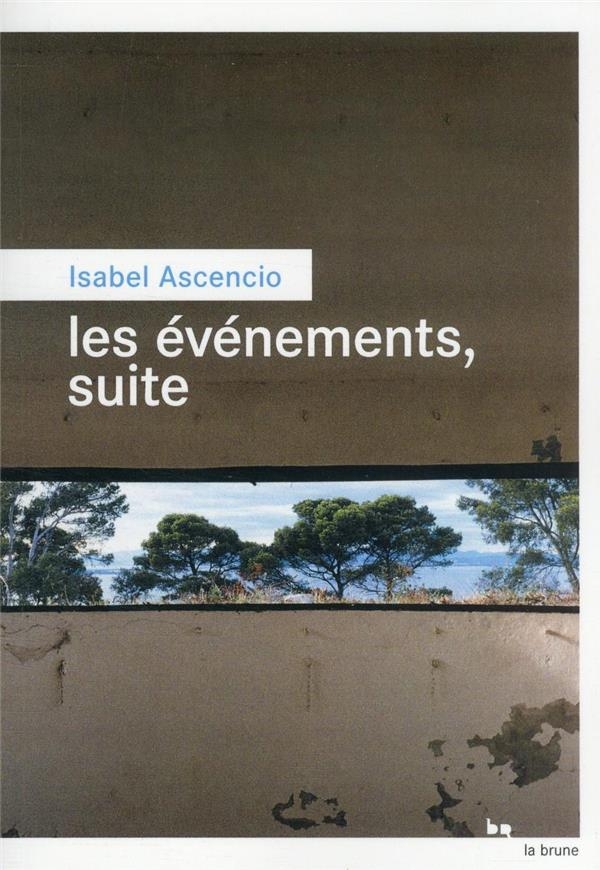Les évènements, suite
Après le décès de son père, Joëlle Leblanc remonte le fil des événements qui, quarante ans plus tôt, le 20 décembre 1975, ont conduit à la mort d'un homme et à l'effacement d'un autre, dans un petit village varois proche de la Méditerranée. Événements prenant eux-mêmes racine dans ceux qui, en Algérie, avaient abouti une décennie plus tôt à une indépendance. En une intense succession de flash-back, celle qui était alors une gamine d'une dizaine d'années raconte la séparation de ses parents, ce que devint son père et ce qui provoqua son exil à elle loin du territoire chéri de l'enfance.
À travers ce roman qui questionne avec acharnement l'articulation des destins, l'autrice sonde les mouvements d'une époque toute à ses révolutions et à ses meurtrissures, où les uns en terminent avec le pardon quand les autres en sont encore à le chercher. Une histoire à hauteur d'hommes, où la traîtrise, le remords, la lâcheté mènent un jeu d'ombres et de dupes. Dans un coin reculé de Provence plus traversé qu'on ne croit par l'histoire coloniale de la France, Isabel Ascencio montre aussi comment les événements d'Algérie toujours vifs dans les mémoires n'en finissent pas d'interroger ce que veut dire être chez soi.
Extrait
Nord
Mon père est mort de l’estomac dans le département du Nord, autant dire à mille cinq cent soixante-six kilomètres du lieu de sa naissance. Je dis mort de l’estomac encore que ce soit une approximation du point de vue médical vu que j’ai toujours connu mon père sans estomac, mangeant par petites quantités et avec détermination des aliments qu’il prenait le temps de réduire en bouillie dans l’assiette avant de les porter à sa bouche et de les mâcher longuement pour faciliter sa digestion. À le voir ainsi encombré trois fois par jour de cette nécessité de se nourrir, et toujours la peau sur les os malgré ses efforts, ceux qui le connurent un peu auraient pu prédire qu’à moins d’un accident, à force de se manger de l’intérieur, mon père mourrait d’une embolie ou d’un dérèglement d’organe en lien avec ses fonctions digestives.
S’il faut supposer une lointaine intervention chirurgicale qui lui relia directement l’œsophage au duodénum, je n’en ai jamais eu vent, pas plus que de la tumeur maligne ou pas qui la rendit nécessaire. L’estomac de mon père, ou plutôt son défaut d’estomac fait partie de ces événements d’avant ma naissance que personne n’a jamais jugé bon d’élucider pour moi. Mais depuis ce lointain temps d’enfance, disons jusqu’à mes onze ans où nous avons vécu père et fille dans le même village du Var, il contribue en grande part au souvenir que je garde de lui, celui d’un homme amputé, enclin à la rumination et profondément seul.
À la fin des années 1970, il s’est retiré dans le Nord, non pas exactement à Lille, mais à une poignée de kilomètres au sud de la capitale régionale, dans une de ces bourgades provinciales vidées par l’exode rural d’après-guerre qui connaissaient depuis peu un regain de population. Je ne prétends pas qu’il pesa bien lourd dans le renversement du solde migratoire de la ville, tout récemment divorcé comme il arrivait, sans famille sans rien, ni davantage au fil des décennies suivantes dans les projets municipaux de construction de logements de type barres à proportion moyenne qu’on vit fleurir au nord de la ville. Mais après un temps passé au centre-ville dans une maison de briques rouges caractéristique des anciennes cités ouvrières, c’est dans un de ces appartements à loyer modéré des quartiers neufs, pratique et sans charme particulier, qu’il alla vivre et mourir dans l’anonymat le plus total.
Quarante années durant, soit plus de la moitié de sa vie, mon père s’endormit et se réveilla donc sous le ciel maussade du Nord suite à une décision de justice qui l’avait laissé libre sur les marches du tribunal de Toulon, exempté de peine et abasourdi, lui qui n’avait pourtant cessé de clamer sa culpabilité dans ce que ma mère appellerait bientôt les événements du Castoul, comme à l’époque on disait communément ceux d’Algérie, et sans que j’aie jamais démêlé la dose d’ironie qu’elle y mettait.
Le 20 décembre 1975, à la veille de Noël, la DS de mon père provoqua un accident mortel à la sortie de ce village du Castoul où nous habitions, sur la ligne droite en direction de Signes. Personne ne fut témoin des faits, sinon Azzedine Taieb la victime, et les trois hommes qui regardaient encore la moto fumer quand les gendarmes les rejoignirent, chacun de part et d’autre de la DS comme s’ils venaient d’en sortir, à savoir le divisionnaire Garrigou bientôt en retraite de la police, son fils Michel, et Serge Leblanc, mon père. Les quatre noms figurent dans cet ordre sur la déposition que mon père signa le jour même à la gendarmerie du Castoul. Je l’ai retrouvée dans ses papiers en vidant ses affaires puisqu’il a bien fallu que je m’emploie les jours qui suivirent sa mort à vider le logis de mon père, une vieille feuille à en-tête, toute seule dans un tiroir de guéridon, où les caractères de l’antique machine à écrire ont creusé un relief plus durable que l’encre. Au brigadier Bèbe qui demande Est-ce que la voiture est à vous ? le procès-verbal stipule que mon père a répondu oui, et derechef à la question suivante, oui, qu’il était au volant. C’est à peine s’il concède un état second dans lequel il aurait enfoncé la pédale d’accélérateur, ainsi que le gendarme le précise à deux reprises. Une fois mon père sorti des locaux, j’imagine le brigadier Bèbe lisant la déposition à ses collègues, quatre ou cinq simples gendarmes aussi peu que lui habitués aux morts violentes sur le territoire de la commune, et glosant l’état second du chauffard comme on fait quand on n’a plus que la plaisanterie pour tenir les drames à distance. Et pourquoi pas le feu de l’action, dit-il, qu’on voudrait bien voir aussi dans le box des accusés, avec toutes les charges accumulées contre eux depuis que les tribunaux rendent la justice.
C’est par une forme d’expiation donc, qu’après le classement sans suite de l’affaire, mon père alla de lui-même s’assigner à résidence sous les ciels bouchés du Nord, renonçant aux voitures et aux trains, autant dire à l’espace. Après ses trente-cinq ans, on doit le voir couvrir exclusivement à pied ou à vélo le périmètre minuscule de sa barre d’immeuble au gymnase du quartier, trois rues, pas plus, entre lesquelles il tourna jusqu’à sa mort comme dans un préau de prison. De son propre chef, donc, il mit toute cette distance entre les lieux quotidiens de sa vie d’homme mûr et les paysages du Sud qu’il avait profondément chevillés au cœur, les vignobles sur les coteaux varois, le littoral méditerranéen depuis les calanques rouges de Marseille jusqu’au massif des Maures, et au-delà de tout, les rivages solaires de son Constantinois natal, de l’autre côté de la Méditerranée, en Algérie, comme il aurait ajouté volontairement l’exil à l’exil, se privant de la mer, la repoussant aussi loin de lui qu’il le pouvait, soit d’un écartement de compas incompressible de huit cent trente-six kilomètres c’est-à-dire si on y regarde bien la France entière prise à peine à l’est de son axe nord-sud.
On dira que je me trompe, qu’en traçant vers l’occident depuis la Flandre on débarque sur une plage à largement moins de cela. Mais s’il est une chose que je peux affirmer à propos de mon père, bien que je l’aie peu revu après le temps dont je parle, c’est que pour un Méridional comme lui, ni la Manche ni l’Atlantique n’ont à voir avec la mer. Je ne dis pas qu’il soit inconcevable, en quarante années de Nord, qu’il ait une fois ou deux pris le bus régional pour se rendre sur la côte normande, qu’il soit allé une fois ou deux entre Calais et Dieppe arpenter des plages interminables surplombées d’un ciel lourd et changeant, et que le col remonté et les mains dans les poches de son caban, il ait froncé les yeux dans le vent pour suivre le rouleau des vagues et les débordements d’écume sur leurs crêtes. Je dis seulement que cette expérience-là, de l’océan, si des fois mon père s’est autorisé à la vivre, à ramasser des coquillages tout humides de marée pour les tourner et retourner entre ses doigts, et puis levant les yeux pour suivre les voiliers comme font les natifs, ce fut encore et toujours en manière d’expiation. Parce qu’au regard des rivages méditerranéens frappés de soleils verticaux auxquels il avait définitivement renoncé, aucune plage au monde n’a jamais été pour lui de la moindre consolation.