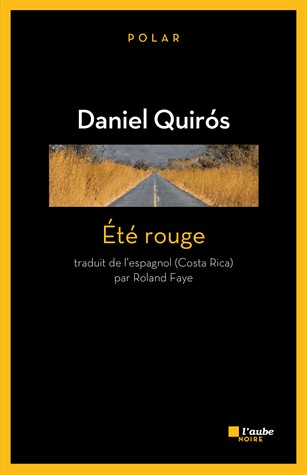Eté rouge
Côte du Pacifique, Costa Rica. Un Eden où les pinèdes sont massacrées afin de permettre la construction de villas luxueuses pour des investisseurs étrangers... et des caïds de la drogue. Un Eden où il fait terriblement chaud, où l'alcool ne peut faire oublier le sable, la poussière et le vent. C'est là, dans un tranquille village de pêcheurs, qu'est découvert sur la plage le cadavre d'une femme, surnommée l'Argentine. Don Chepe, ancien guérillero qui a lutté aux côtés des sandinistes, décide de retrouver l'assassin de son amie. Une enquête qui le conduit à découvrir les liens obscurs entre passé et présent, utopie et désenchantement... et à revisiter l'histoire de son pays.
Entre torpeur et violence, ce livre nous colle à la peau. Eté rouge a reçu le prix national de Littérature Aquileo J. Echeverria, la plus haute distinction littéraire du Costa Rica.
Extrait
La poussière. Je déteste la poussière. À cette époque de l'année, elle recouvre tout, comme une toile d'araignée omniprésente. Elle se mélange à la sueur et transforme la peau du visage en masque noirâtre. J'ai beau me nettoyer souvent avec le mouchoir blanc que j'ai toujours dans ma poche de pantalon, je sens en permanence ma peau râpeuse sous cette couche de poussière qui m'incommode, ce goût de terre sur mes lèvres craquelées, alors que je n'ai de cesse de les humidifier avec ma langue. Le mieux à faire ici, c'est de passer la journée au bar de dona Eulalia, d'où on peut voir la mer, qui envoie de temps à autre une rafale de vent : avec une cigarette et une bière bien fraîche, une journée devient alors quelque chose d'à peu près supportable.
Il n'entre pas grand monde dans ce bar. Il n'y a pas grand-chose à attendre d'un village de pêcheurs où vivent à peine trois cents personnes, et qu'un quelconque farceur a eu la riche idée de baptiser Paraíso. Vers la mi-journée, la salle se remplit un peu, avec l'arrivée des pêcheurs qui ont ancré leur barque sur la plage d'en face et qui, après avoir déchargé leur pêche, le plus souvent bien maigre, entrent dans le bar pour y manger un morceau et boire quelques bières avant d'aller vendre leurs poissons et leurs langoustes aux hôtels touristiques du coin. A part eux, les seuls clients sont quelques paysans, venus à cheval ou avec leur pick-up à plateforme en bois, des éleveurs qui font une halte avant d'aller visiter leur propriété et quelquefois un touriste perdu, généralement un surfeur californien circulant en 4x4 et se dirigeant vers une des plages du coin. Le problème avec les voitures, c'est qu'au passage elles soulèvent des nuages de poussière insupportables, qui pénètrent dans la salle du bar et font même fuir les mouches posées sur les tables. Après cela, dona Eulalia sort avec un tuyau et arrose la rue pour chasser la poussière. Comme il y a pénurie d'eau à cette période, je lui dirais bien quelque chose à ce sujet, mais après tout, qui s'en soucie ?
J'étais au bar la première fois que j'ai entendu parler du cadavre. La morte était une femme de Tamarindo, une certaine Ilana Echeverri, mais que tout le monde ici appelait «l'Argentine». Le corps avait été découvert au lever du jour par un pêcheur du village, Faustino Arias. Cela ne m'avait pas laissé indifférent, parce que je savais qui était cette femme. Nous nous étions connus quelques années plus tôt, peu de temps après que j'eus quitté la capitale pour m'installer à Paraiso, où j'avais construit une maison avec mes maigres économies d'ex-agent de l'I.N.S., la Compagnie nationale d'assurances, la seule du pays. Â l'I.N.S., j'étais un de ces types qu'on envoie enquêter sur les accidents de voiture et les déclarations de sinistres qu'effectuent les assurés. Il me restait encore pas mal d'années à faire avant de prétendre à la retraite, mais j'en avais déjà ma claque. J'en avais marre de la ville, de la pollution, des embouteillages quotidiens, de la délinquance nocturne, de la bureaucratie, de la corruption, de mon salaire de misère et des relations de plus en plus difficiles avec les assurés. De mon père, issu d'une famille d'éleveurs du Guanacaste, j'avais hérité d'un terrain proche de la mer, à deux kilomètres de Paraiso. En faisant mes comptes, j'en étais venu à me dire que je pouvais construire une maison potable où je pourrais oublier ce qu'avait été ma vie jusqu'alors.