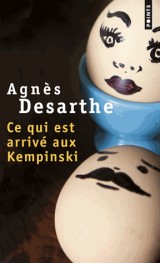Ce qui est arrivé aux Kempinski
« Mon âme, dit-elle. Mon âme, que vaut-elle ? Mon âme est une liste de courses. Mon âme est une déclaration d'impôts, un bulletin de notes au bas duquel ne figurent pas d'encouragements. Mon âme est le mode d'emploi du lave-vaisselle remplacé depuis huit ans, un bordereau de la poste datant de trois mois (le paquet est reparti, mais où, et que contenait-il ? Une rivière de diamants, sans doute). Mon âme est pleine de “Bonjour, madame”, “Au revoir, madame”, elle est salie par les corvées, corrompue par la fatigue de jours sans héroïsme, sans passion, sans péril. »
Qui parle ainsi ? Une femme à qui le diable a proposé un pacte. Mais le diable ferait bien de se méfier : dans le monde d'Agnès Desarthe, qui perd gagne, l'oubli est source de mémoire, les enfants engendrent leurs parents et le châtiment précède la faute.
En 14 histoires étourdissantes, Agnès Desarthe rend visible ce qui se cache derrière ce qui nous semble le plus familier. Comme une trame secrète où viendrait s'inscrire le paradoxe qui gouverne notre vie. Un sens constamment perdu, et retrouvé.
Extrait
Au milieu de la nuit, j'ai ouvert les yeux. Avant de me souvenir qui j'étais, où j'étais, qui dormait à côté de moi, j'ai senti ma gorge se serrer. L'angoisse a battu la conscience au sprint du réveil. Je n'étais encore qu'un bloc indéterminé d'humeurs, de chair et de sensations que déjà mon coeur pesait sur mon diaphragme.
Je n'ai pas fait mon piano, me suis-je dit. Demain j'ai cours et je n'ai pas ouvert mes partitions une seule fois cette semaine.
Je n'avais pas eu le temps, je n'avais pas eu envie. Je décidais de m'y mettre dès le matin et quelque chose, toujours, m'en détournait : un coup de téléphone, une tache sur le mur de la cuisine, une liste de courses. Le soir venu, je me disais : Demain. Demain, c'est sûr, je ferai mon piano. Dans les transports, j'y pensais un peu ; je tentais de me représenter les portées. Madame Greffuhle, mon professeur, m'a conseillé cette méthode fondée sur la mentalisation. Selon elle, l'effort fourni pour visualiser la partition contribue à provoquer les connexions neuronales nécessaires à l'exécution du morceau. Ce que madame Greffuhle déconseille, en revanche, c'est de procéder à cet exercice dans le métro ou dans le bus. Il faut, selon elle, y consacrer un temps ritualisé. «Comme pour la méditation...» Là, il faut que vous essayiez de vous imaginer sa voix. C'est elle qui parle de méditation. Elle a un très léger accent argentin et un enrouement chronique. «Un chat !» murmure-t-elle dans un souffle, avant d'amorcer une quinte de toux qui peut durer jusqu'à quarante secondes (c'est très long pour une quinte). «Comme pour la méditation, il faut décider du moment, le sanctuariser. Je ne me mets pas à mentaliser parce que je n'ai rien de mieux à faire, que je m'ennuie ou que j'attends à la caisse du supermarché (j'adore sa façon de prononcer "supermarché"). Je mentalise alors (elle hurle presque ce dernier mot) ALORS que j'ai autre chose à faire. Je crée une volonté adverse, plus forte que le petit devoir emmerdant (j'aime aussi beaucoup l'usage qu'elle fait des gros mots). Je passe devant le tas de linge à laver, devant le lit défait, devant la table à débarrasser en les ignorant et je m'installe face au piano. Je lève les mains au-dessus des touches et, à l'instant où le premier imbécile venu enfoncerait ses doigts sacrilèges dans l'ivoire de synthèse, je retiens le geste. Je laisse mes mains, à peine palpitantes, planer au-dessus du clavier, je ferme les yeux et je mentalise. Un quart d'heure minimum, sinon, ça ne donne rien. Il ne faut pas espérer de résultats à moins de quinze minutes.»
Madame Greffuhle sait toujours très exactement la masse et la qualité de travail que j'ai fournies pendant la semaine. Au début, je tentais le bluff. Une demi-heure avant de partir à mon cours, je travaillais trois mesures en boucle, avec des rythmes différents, à l'envers et à l'endroit, en me disant : Quand elle verra que je maîtrise complètement ce passage difficile, elle pensera que j'ai été appliquée et régulière. Elle se taisait, ne me félicitait pas, ne me démasquait pas, elle attendait. Et puis un jour, elle a dit : «Vous savez, Émeline, en musique, on parle beaucoup de tempo, qui n'est que le nom italien du temps. Le tempo au piano, c'est l'allure, bien sûr, ça, vous le savez, c'est même un de vos points forts, cette façon que vous avez de la tenir et d'à peine la contrarier pour faire éclore l'émotion, mais moi, je vous parle du temps, du temps qu'on passe à l'instrument ; une demi-heure avant de venir, ça ne suffit pas. Vous êtes douée, vous avez un bon poignet, vous pesez comme il faut sur les touches, le son est puissant et chaleureux, mais vous avez tendance à vous endormir sur vos lauriers. Et encore, quand je dis lauriers, c'est exagéré. Le temps que j'ai, moi, celui dont je dispose, n'est pas extensible, pas infini. Il est hors de question que je le perde. Vous comprenez ?» Le sourire qui a suivi me hantait. Il se reflétait dans le bois de mon piano quand je travaillais ; comme s'il s'y était imprimé. Depuis, j'avais pris la décision d'être plus sérieuse. Mais je ne tenais pas toujours mes promesses. La preuve, cette semaine, une fois encore, je n'ai pas fait mon piano. Depuis combien de temps n'ai-je pas eu un cours réellement satisfaisant ? Une leçon au terme de laquelle nous sentirions, madame Greffuhle et moi, qu'une nouvelle étape a été franchie. Parfois j'ai réussi à lui arracher une exclamation, un Ha ! de contentement et de surprise, suivi d'une interminable quinte de toux. Qu'y a-t-il donc de si compliqué pour moi à être studieuse et régulière ? J'ai un si grand désir de lui complaire, de l'étonner. Pour m'aiguillonner, il m'arrive de me rappeler notre premier rendez-vous.