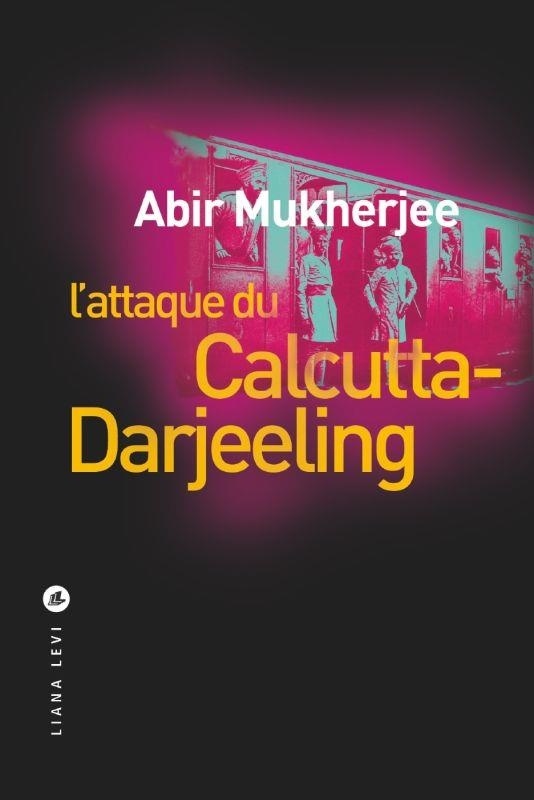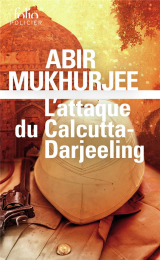L'attaque du Calcutta-Darjeeling
1919. La Grande Guerre vient de se terminer en Europe. Après cette parenthèse éprouvante, certains Britanniques espèrent retrouver fortune et grandeur dans les lointains pays de l’Empire, et tout particulièrement en Inde. Ancien de Scotland Yard, le capitaine Wyndham débarque à Calcutta et découvre que la ville possède toutes les qualités requises pour tuer un Britannique: chaleur moite, eau frelatée, insectes pernicieux et surtout, bien plus redoutable, la haine croissante des indigènes envers les colons. Est-ce cette haine qui a conduit à l’assassinat d’un haut fonctionnaire dans une ruelle mal famée, à proximité́ d’un bordel? C’est ce que va tenter de découvrir Wyndham, épaulé par un officier indien, le sergent Banerjee. De fumeries d’opium en villas coloniales, du bureau du vice-gouverneur aux wagons d’un train postal, il lui faudra déployer tout son talent de déduction, et avaler quelques couleuvres, avant de réussir à démêler cet imbroglio infernal.
Abir Mukherjee a grandi dans l’ouest de l’Écosse dans une famille d’immigrés indiens. Fan de romans policiers depuis l’adolescence, il a décidé de situer son premier roman à une période cruciale de l’histoire anglo-indienne, celle de l’entre-deux-guerres. Premier d’une série qui compte déjà quatre titres, ce roman a été traduit dans neuf pays.
La presse en parle
C’est passionnant, original, plein d’humour british et de clins d’œil aux Ecossais, Calcutta y est magistralement rendue, le contexte historique également.
Livres hebdo
«C’est passionnant, original, plein d’humour british et de clins d’œil aux Ecossais, Calcutta y est magistralement rendue, le contexte historique également.»
Livres hebdo
Extrait
Au moins, il est bien habillé. Cravate noire, smoking, tout le tremblement. Si vous devez vous faire tuer, autant laisser de vous l’image la plus flatteuse.
La puanteur qui se plante dans ma gorge me fait tousser. Dans quelques heures elle va devenir intolérable; assez forte pour retourner l’estomac d’un poissonnier de Calcutta. Je sors de ma poche un paquet de Capstan, j’en tapote une, je l’allume et j’inhale en laissant la fumée douce nettoyer mes poumons. La mort sent plus mauvais sous les tropiques. Comme la plupart des choses.
Il a été découvert par un petit vigile décharné au cours d’une de ses rondes. Le pauvre a failli en mourir de peur. Une heure plus tard il tremble encore. Il l’a découvert gisant dans une impasse sombre, ce que les gens du lieu appellent gullee, bordée sur trois côtés par des bâtiments délabrés, où le ciel n’est visible qu’en regardant en l’air et en se dévissant le cou. Le gamin doit avoir de bons yeux pour l’avoir repéré dans le noir. Mais peut-être s’est-il simplement fié à son nez.
Le corps gît sur le dos, tordu et à demi submergé par un cloaque à ciel ouvert. La gorge tranchée, les membres comme disloqués, et une grosse tache de sang brun sur un plastron empesé. Il manque des doigts à une main et un œil a été arraché de son orbite – cette ultime indignité est l’œuvre des gros corbeaux noirs qui montent encore une garde sévère sur les toits. Autrement dit, ce n’est pas une fin très digne pour un burra sahib.
J’ai quand même vu pire.
Enfin, il y a le message. Un bout de papier taché de sang, roulé en boule et enfoncé de force dans la bouche comme un bouchon de liège dans une bouteille. C’est un détail intéressant, et nouveau pour moi. Quand vous croyez avoir tout vu, c’est agréable de découvrir qu’un meurtrier peut encore vous surprendre.
Une foule d’autochtones s’est rassemblée. Une collection hétéroclite de badauds, de colporteurs et de femmes. Ils se bousculent pour s’approcher de plus en plus près, brûlant d’apercevoir le cadavre. La nouvelle s’est vite répandue. Comme toujours. Le meurtre est un bon divertissement dans le monde entier et là, à Black Town, on pourrait vendre des billets pour voir un sahib mort. J’observe pendant que Digby aboie à quelques agents locaux d’établir un cordon. Ces derniers à leur tour crient en direction de la foule et des voix étrangères les huent et leur lancent des insultes. Les agents jurent, ils brandissent leur lathi en bambou et frappent de tous côtés en repoussant peu à peu la populace.
Ma chemise me colle au dos. Il n’est pas encore neuf heures et la chaleur est déjà oppressante, même à l’ombre dans la ruelle. Je m’agenouille près du corps et je le tâte. La poche intérieure de la jaquette est gonflée et j’en tire le contenu : un portefeuille de cuir noir, des clefs et des pièces de monnaie. Je range les clefs et la monnaie dans le sac des pièces à conviction et m’intéresse au portefeuille. Il est vieux, mou et usé et a probablement coûté très cher quand il était neuf. À l’intérieur, froissée et écornée par des années de manipulation, une photo de femme. Elle a l’air jeune, probablement une vingtaine d’années, et porte des vêtements dont le style suggère que la photo a été prise il y a déjà un certain temps. Je la retourne. Les mots Ferries & Sons, Sauchiehall St., Glasgow sont imprimés au verso. Je la glisse dans ma poche. Pour le reste, le portefeuille est à peu près vide. Pas d’argent, pas de cartes de visite, quelques reçus. Rien pour indiquer l’identité de l’homme. Je le referme et le range dans le sac avec les autres objets avant de m’occuper de la boule de papier dans la bouche de la victime. Je la tire doucement pour ne pas déranger le corps plus que nécessaire. Elle sort facilement. Le papier est de bonne qualité. Épais, comme celui que l’on trouve dans un hôtel de classe. Je le défroisse. Trois lignes y sont griffonnées. À l’encre noire. Dans une langue orientale.
J’appelle Digby. C’est un fils mince et blond de l’Empire ; tout en moustache militaire et avec l’air d’un homme né pour commander. Il est aussi mon subordonné, ce qui n’est pas toujours visible. Dix ans dans la police impériale et, d’après lui du moins, sachant traiter avec les indigènes. Il s’approche en essuyant ses mains en sueur sur sa tunique et dit: «Inhabituel de trouver un cadavre de sahib dans cette partie de la ville.
– J’aurais pensé que c’était inhabituel d’en trouver où que ce soit dans Calcutta.»
Il hausse les épaules. « Vous seriez surpris, mon vieux. »
Je lui tends le bout de papier. «Que pensez-vous de ceci?»
Il examine le recto et le verso avec un excès d’attention avant de répondre : « Je pense que c’est du bengali... monsieur. »
Il a craché ce dernier mot. C’est compréhensible. Voir votre promotion vous échapper n’est jamais facile. Que ce soit au profit d’un outsider fraîchement débarqué de Londres est probablement encore pire. Mais c’est à lui de se tracasser. Pas à moi.