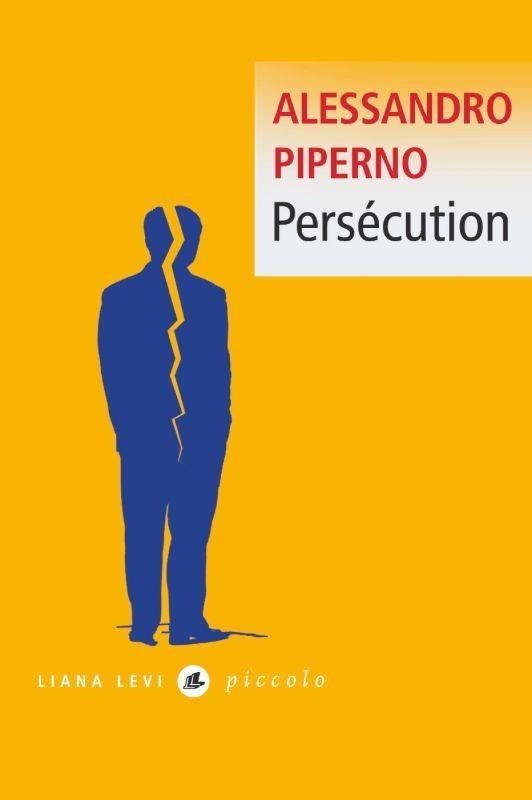Persécution
«Savoir-vivre et discrétion.» Pour Leo Pontecorvo, brillant professeur de médecine et père d'une famille respectée de la bourgeoisie juive romaine, les excès et les incartades ne font pas partie du programme. Mais un soir il apprend, par le journal télévisé, qu'une gamine de douze ans l'accuse d'avoir tenté de la séduire. Un gouffre s'ouvre sous ses pieds. Rien dans sa vie ne l'a préparé à affronter une situation aussi humiliante. Rien ne l'a préparé à se battre en général. Au lieu de clamer son innocence, Pontecorvo se replie sur lui-même et se remémore comment le piège s'est refermé sur lui, entre sa trop raisonnable femme, la fillette mythomane et ses clinquants parents, l'intraitable magistrat, l'avocat pervers... Si la justice est aveugle, l'injustice l'est aussi.
Extrait
C’est le 13 juillet 1986 qu’un désir inconfortable de n’être jamais venu au monde s’empara de Leo Pontecorvo.
Un instant plus tôt, Filippo, son fils aîné, s’autorisait la plus mesquine des lamentations puériles: contester la toute petite portion de frites que sa mère avait fait glisser dans son assiette, en regard de la générosité inouïe qu’elle avait témoignée à l’égard de son petit frère. Et voilà que quelques secondes plus tard le présentateur du journal télévisé de vingt heures insinuait, devant une considérable tranche de la population, que Leo Pontecorvo ici présent avait entretenu une correspondance dépravée avec la petite amie de son fils cadet, âgé de treize ans.
Autrement dit, de ce même Samuel, avec son assiette pleine du trésor doré et croustillant qu’il ne mangerait jamais. Hésitant probablement quant à savoir si la célébrité soudaine que lui apportait la télé serait archivée par ses amis dans la case à ragots rigolos ou dans celle, encore vide, destinée à recevoir l’image la plus irrémédiablement merdique qui puisse être accolée au jeune garçon d’une tribu gâtée et indolente.
Inutile d’espérer que l’âge tendre de Samuel l’ait empêché de deviner ce qui avait instantanément été clair pour tout le monde: quelqu’un à la télé sous-entendait que son père avait baisé sa petite copine. Quand je dis « petite copine », je parle d’un oisillon de douze ans et demi aux cheveux couleur citrouille et au museau de fouine parsemé de taches de rousseur; mais quand je dis «baiser» je parle bien de baiser. Et donc de quelque chose d’énorme, d’extrêmement grave, de trop brutal pour être assimilé. Même par une épouse et deux fils qui se demandaient depuis quelque temps déjà si ce mari et père était réellement le citoyen irréprochable dont il avait toujours été naturel de se sentir fiers.
«Quelque temps déjà» fait allusion aux premières complications judiciaires qui l’avaient assailli, imprimant la marque infamante du soupçon sur la carrière d’un des maîtres les plus novateurs de la cancérologie pédiatrique du pays. Un de ces médecins-chefs qui, lorsque la vieille infirmière en dressait le portrait à une nouvelle collègue, méritait des commentaires tels que: «Un vrai monsieur! Il n’oublie jamais de te dire “merci”, “je vous prie” ou “s’il vous plaît”... en plus, il est tellement sexy ! » Et dans les salles d’attente étouffantes de l’hôpital Santa Cristina, où les mères échangeaient leurs expériences angoissantes du cauchemar qu’était devenue la vie de leurs enfants malades, il n’était pas rare de tomber sur des dialogues tels que :
«Il est tellement disponible. Tu peux l’appeler à toute heure du jour et de la nuit...
– Je le trouve rassurant.Toujours souriant, optimiste. – Et puis, il sait y faire avec les enfants... »
Tandis que la sonnerie du téléphone commençait à donner un rythme de folle frénésie à une honte inconcevable deux secondes plus tôt, Leo, au comble du désarroi, sentit que le repas qu’il venait d’avaler était le dernier que ses proches lui accorderaient. Puis il considéra les milliers d’autres choses qui désormais lui seraient inaccessibles. Et c’est peut-être pour ne pas s’effondrer, pour ne pas succomber sous le poids de la panique ou du sentimentalisme, pour ne pas fondre en larmes comme un bébé devant ses fils et sa femme qu’il se réfugia dans une pensée absurde et haineuse.
Finalement, elle avait réussi : la gamine, que son fils avait fait venir chez eux environ un an plus tôt et que Rachel et lui – le couple le plus ouvert et le plus tolérant de leur milieu – avaient accueillie sans histoires, avait réussi à détruire leur vie. La sienne, et celle des trois personnes qu’il aimait le plus.
Alors, c’est comme ça que ça doit finir? s’était surpris à penser Leo, qui pataugeait de plus en plus dans son désir désespéré de n’avoir jamais existé.
Mauvaise question, mon vieux. À quoi bon parler de fin alors que nous n’en sommes qu’au début ?
Tout cela arrivait à point nommé.
Celui où l’Olgiata – zone résidentielle de grand standing au milieu d’hectares de bois, ponctuée de villas, de jardins perpétuellement fleuris, et délimitée par des murs massifs – se vidait d’un seul coup. Comme une plage au coucher du soleil.
C’était alors comme si on était pris au piège dans un immense parc d’attractions après la fermeture. Des traces de l’énergie athlétique dépensée pendant la journée étaient disséminées partout : le ballon Adidas en cuir coincé dans la haie; le skate-board épuisé renversé sur le revêtement en terre cuite de l’allée; la planche en plastique orange flottant sur le miroir huileux et scintillant d’une piscine; deux raquettes arrosées par les jets intermittents mis en route automatiquement.
Peut-être pouvait-on encore tomber sur le mordu de footing en short, serviette sur les épaules comme Rocky Balboa, ou sur le jeune père qui rentrait essoufflé du supermarché, un paquet de couches-culottes dans une main et une boîte de préservatifs dans l’autre.
Mais en dehors de ces solitaires en permission – ces traîtres à la sieste de l’après-midi –, tous les autres s’étaient terrés presque à l’unisson dans leurs habitations: des villas aux architectures incohérentes et éclectiques, certaines sobres et d’autres tapageuses (le style mexicain supplantait depuis peu la mode chalet des Alpes). En voyant ces maisons de l’extérieur, on pouvait imaginer les sous-sol. Où tout était prévisible: la cheminée, les plinthes rongées par le vert de la moisissure, les napperons au crochet, les piles d’illustrés, les boîtes métalliques pleines de lavande, la table de billard rigoureusement recouverte d’un drap tel un cadavre à la morgue, un téléviseur ventru d’où se dévidait l’enchevêtrement tentaculaire des fils du VHS et de la console Atari. On pouvait sentir le parfum campagnard hypocrite des bûches, des pommes de pin, des tas de journaux non moins jaunis que les balles de ping-pong cachées dans les coins les plus invraisemblables.
Ce n’était qu’un instant. Un instant en dehors de la galaxie. Un instant de détente surnaturelle. L’instant où la gloire de la famille, quotidiennement célébrée dans ces contrées, atteignait son apogée, à une trentaine de kilomètres du centre de Rome. Un moment réellement émouvant, après lequel tout se remettrait à bouger et à dépérir.
Encore quelques minutes et les habitants de l’Olgiata, orphelins de leurs domestiques philippines en congé dominical, allaient se déverser dans les rues pour occuper militairement, avec leurs voitures étincelantes et leur vitalité effrontée, les parkings des pizzerias des alentours. Car malgré l’impression de satiété que provoquait l’odeur de barbecue répandue dans l’atmosphère, tous étaient décidés à terminer la journée en beauté en se gavant de bruschetta à la tomate et de fraises à la crème.